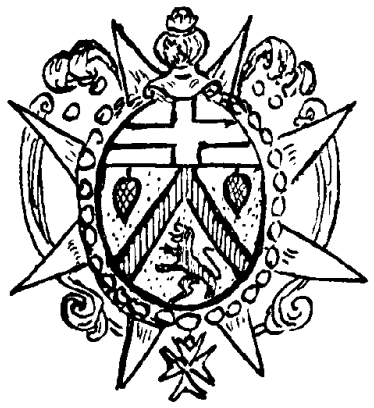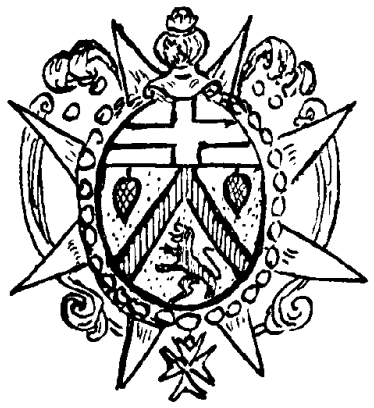Maxime Legrand
La Mine de Chalou-la-Reine en 1740
Annales du Gâtinais, 1922
LA
“MINE” DE CHALOU-LA-REINE EN 1740
|
|
Malgré
l’établissement du système métrique, certains noms d’anciennes
mesures ont continué dans la plupart de nos campagnes à figurer,
soit dans les relations d’homme à homme, soit dans les transactions
journalières. D’ailleurs, la survivance de plus d’une expression
est telle qu’il n’est pas rare dans certains marchés d’entendre encore
parler d’écus et de pistoles. En Beauce, et plus particulièrement
dans le canton de Méréville, on continue encore à se
servir des mots Perche, Boisseau, Mine, Minot, etc. etc.., pour les
mesures agraires, voire pour les mesures de capacité. Pour ne retenir
que les expressions «Mine» et «Minot», ces appellations
s’appliquent à la fois à un récipient et à un
espace de terre labourable qui, pour la Mine, représente ce qu’on peut
ensemencer avec une mine de blé, mesure, et pour le Minot la quantité
de terre pouvant recevoir le minot de céréales, soit un quart
d’arpent environ.
|
|
En
tant que mesure de capacité, la «Mine» n’est plus guère
employée que par les vieux cultivateurs nés à l’aube
du siècle dernier et formés à la vieille [p.268] école par des parents qui comptaient
par pieds et pouces, voire par aunes, et pesaient tout en livres et onces.
Encore devons-nous ajouter, pour être véridiques, que la mesure
qu’ils nomment ainsi, influencée par le système nouveau, ne
répond plus aux données anciennes. La Mine contient tant de
«litres», le Minot tant d’autres, et le tout se rapporte au sac
de grains de X kilogs. Voilà tout. J’ai personnellement connu, à
Angerville, il y a 20 ou 25 ans, un de ces vieux traditionalistes pour lequel
hectare et are étaient encore quelque peu de l’hébreu, mais
qui, par contre, jonglait avec les mines et les minots, se jouant de leurs
différences locales et réduisant ces mesures anciennes avec
la facilité la plus surprenante et parfois la plus déconcertante.
L’arpent seul avait grâce devant lui parce qu’il rapportait l’arpent,
variable lui aussi avec les régions, à son équivalent
ancien.
|
|
C’est à
un autre traditionaliste du canton de Méréville que je dois
le petit objet dont je tiens à conserver le souvenir. C’est une modeste
plaque de laiton, rectangulaire, aux coins arrondis, mesurant 0.14 cent. de
haut sur 0.085 de large; portant à la partie supérieure un
écusson armorié, et au-dessous, une inscription de cinq lignes,
le tout gravé au burin.
|
|
L’écu,
ovale, est posé sur une croix hospitalière dont on ne voit que
les huit pointes, placée elle-même sur un cartouche très
simple, datant du XVIIIe siècle. Il est sommé d’un casque, posé
de face, taré de 4 ou 5 grilles et surmonté d’un minuscule
cimier, tortil ou couronne.
Les armoiries, circonscrites par l’ecu ovale, sont doubles.
Dans le registre supérieur figure la croix [p.269]
de l’Ordre du Temple; une croix appropriée au dessin bien entendu.
Au-dessous, figurent les armoiries personnelles du Commandeur en fonctions
à l’époque. A première vue, ce blason paraît pouvoir
se lire «d’or au chevron de gueules, accompagné en chef de
deux (pommes de pin) de…, et en pointe d’un (écureuil) rampant aussi
de gueules».
Un collier de grosses perles — 27 pour être exact — entoure tout l’ovale et soutient une petite
croix de Malte.
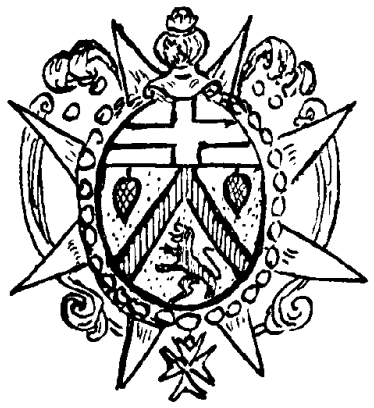
Le texte de l’inscription, en lettres capitales et cursives,
est disposé comme suit:
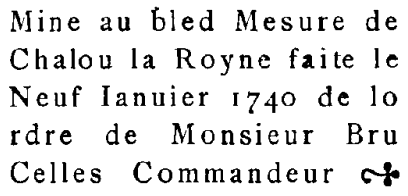
Mine au bled Mesure de
Chalou la Royne faite le
Neuf Ianuier 1740 de lo
rdre de Monsieur Bru
Celles Commandeur +
|
|
| Le
personnage dont il est fait ici mention est le Fr. Nicolas Brucelles, le 26e
(d’après E. Mannier) des Commandeurs de Chalou (1) qui ont depuis 1345 [p.270]
administré cette importante maison du Temple fondée, dit-on,
par la mère de Philippe-Auguste (ce qui la fit nommer Chalou-la-Reine)
et donnée aux Templiers par lettres de 1185. |
(1)
E. Mannier, Les Commanderies du grand Prieuré de France (Paris,
1872), p. 68.
|
Le
domaine de Chalou — rappelons-le
brièvement — comprenait
250 arpents de terre avec maison et ferme touchant l’église, droits
et dîmes à Chalou, Angerville, Chenou-en-Gâtinais, etc.
De cette commanderie dépendaient: le Temple d’Etampes, celui de Ramoulu,
la maison et fief de La Roche-Liphard, le Temple du Perray, de La Boutière,
de la Mignères et du Saussay (1). Son
revenu s’élevait en 1495 à 93 livres, 23 muids de froment et
14 muids d’avoine; en 1788 à 4235 livres et 125 sacs de blé.
|
(1)
E. Mannier, p. 68 et suivantes.
|
Le
«Muid» dont il vient d’être question variait, on le sait,
suivant les pays et suivant les matières à mesurer. Il était
en rapports étroits avec les setiers, les mines et les
minots… et bien d’autres mesures encore, d’une notamment
qui paraît spéciale à notre région, le haveceau,
en patois local havechiau. Un tableau officiel des mesures de capacité
usitées en France en 1330 nous renseigne sur la valeur des mesures
propres, au XIVe siècle, au pays d’Etampes (2).
[p.271]
Stampe.. Modius
bladi Parisiensis valet XXI sextaria et XVI havechiaus; de quibus havechiaus
XXI havecheau res, faciunt Minum; II mine faciunt sextarium, et XII sextaria
faciunt modium apud Stampas.
En d’autres termes: «Le muid de blé de
Paris vaut 21 setiers et 16 haveceaux ras (combles) pour une mine; deux mines
font un setier et douze setiers font un muid à Etampes».
Le document en question donne encore la valeur du muid d’avoine
de Paris et celle du muid d’avoine «mesure du grenier d’Etampes». Il y avait donc deux mesures à Etampes: celle de Paris,
celle du grenier d’Etampes. D’après la «Rapsodie» de
Pierre Plisson (1), la mesure d’Etampes aurait
été un peu plus forte que celle de Paris; la mine à grains
ordinaire se divisait en tous cas en deux minots.
Cette «mesure d’Etampes» est évidemment celle de Chalou (2),
et il est bien fâcheux que nous ne possédions aujourd’hui que
la plaque ornant cette sorte de «modius» des Romains, dont l’image
s’étale sur tant de revers de grands et de moyens bronzes à
l’époque impériale. Quelle était sa forme, sa hauteur,
son diamètre? [p.272]
Si nous en croyons
Larousse (1), la «Mine» pour
matières sèches usitée en France formait la moitié
d’un setier ou 78 litres 0497. Le «Minot» équivalait
à trois boisseaux ou 39 litres, quand il s’agissait de grains: ce
qui est notre cas. La mine de blé contenait donc un peu plus de 78
litres. Un manuel de 1839 (2) nous apprend que
dans les mesures en bois pour matières sèches, la hauteur est
égale au diamètre, et nous lisons dans un tableau dressé
pour les grains les mesures suivantes:
|
MILLIMÈTRES
|
Hectolitre ou nouveau
setier (hauteur et diamètre)
|
503
|
Demi Hectolitre
|
399,3
|
Décalitre ou
nouveau boisseau
|
233,5
|
Mais il s’agit là de nouvelles mesures,
et nous ne trouvons ni la hauteur ni le diamètre de notre ancienne
Mine, puisque l’hectolitre est trop grand et le demi trop petit. Si nous prenons
comme bon le chiffre de 78 litres 0497, un calcul un peu compliqué,
mais facilement vérifiable, nous donne le chiffre de 0m4635 en hauteur
et en diamètre. La mine de Chalou est donc facile à reconstruire,
grâce à ces données.
*
* *
|
(2)
Boutaric, Revue des Sociétés savantes (1860); E. Dramard,
Abeille d’Étampes du 27 février 1875. Dans
cet article très documenté, Dramard explique que le mot
haveceau vient de ce droit de havage qui donnait
faculté, notamment au bourreau de Paris, de prélever dans les
marchés, sur les grains, «autant qu’on en peut prendre avec
la main». Ce droit qui s’exerça avec une cuiller — bien plus
grande bien entendu que la poignée que l’on pouvait saisir — avait
donc, à l’origine, trait à une bien petite mesure. Mesure populaire
et locale, elle n’était en usage qu’à Paris et à Etampes.
Cf. Ch. Forteau, Le dernier exécuteur des sentences criminelles
du bailliage d’Etampes et le droit de havage (Annales de la Société
historique et archéologique du Gâtinais, 1904).
(1) Ch. Forteau, La
Rapsodie de Maître Pierre Plisson, avocat du roi au bailliage d’Étampes
au XVIIIe [Lisez: XVIIe (B.G.] siècle
(Annales de la Sociélé hist. et arch. du Gâtinais,
1909). D’après l’auteur le muid de sel se composait de 48 minots
ou 21 mines.
(2) Nous lisons dans un
manuscrit conservé à Pétrograd: Le Duché d’Etampes
au XVIIe s., la mention suivante: «Le 21octobre 1578, sentence
rendue au Bailliage par laquelle on adjuge au curé de Challo-la-Reine
(nommé Mre Guillaume Picart) oultre et pardessus le muid de bled et
le muid d’avoine qu’il avoit encore la quantité de XX septiers de bled
froment trois septiers d’avoine et trois septiers d’orge, selon la mesure
dudit Challot pour subvenir à sa nourriture».
(1) Nouveau Larousse
illustré (au mot Muid).
(2) Manuel complet du
système métrique appliqué aux nouvelles mesures,
Paris et Versailles, 1839, pp. 46-47. Nous en devons la communication à
M. Hervé, fabricant boisselier à Etampes.
|
A quelle
famille se rattachait le 26e dignitaire de la commanderie de Chalou, M. Brucelle?
Grâce à la précieuse collaboration de M. le comte René
de [p.273] Saint-Périer et de M. le comte Maxime de Sars, nous savons
qu’il s’agit d’une famille de cultivateurs du Laonnois, représentée
encore aujourd’hui par plusieurs branches, et dont l’une était parvenue
à la bourgeoisie au XVIIe siècle et portait: d’or au chevron
de gueules, accompagné en chef de deux pommes de pin versées
de sable, tigées et feuillées de sinople, et, en pointe, d’un
écureuil rampant de gueules (1).
I. — Jean Brucelle épousa (au XVIIe
siècle) Léonore Liégeois, dont il eut au moins deux fils:
|
(1)
La gravure de la plaque concorde évidemment avec l’armorial, sauf que
le graveur a négligé les feuilles de sinople et qu’il
a ajouté un s au nom de Brucelle, ce qui est véritablement
négligeable.
|
II. — 1) Charles Brucelle, fermier à
Clermont-les-Fermes, marié en 1678 à Madeleine Sureau, fille
cadette de Cornil Sureau, receveur du prieuré de Saint-Paul-aux-Bois
et d’Elisabeth Pougeois, auteur d’un rameau qui s’est continué à
Clermont jusqu’au XIXe siècle.
|
|
2) Jean
Brucelle, seigneur de la Petite-Ville-aux-Bois et de Lislet en partie, receveur
général de la commanderie de Boncourt et Seraincourt, naquit
en 1662. D’abord receveur de la terre et seigneurie de Pierrepont (2), il succéda à son beau-père
en 1695 dans la recette de Boncourt (3). Il acquit
en 1720 pour 35000 livres le domaine de la Petite-Ville-aux-Bois (4) avec le neuvième de celui de Lislet; il
s’y fixa et y mourut le 30 décembre 1731; son corps [p.274] fut inhumé dans l’église paroissiale
de La Ville-aux-Bois-lès-Dizy. Il avait épousé en l’église
de Boncourt, le 22 juin 1682, Catherine Aubert, née en 1664, fille
cadette de Nicolas Aubert, sieur de Chauvallon, receveur de la commanderie
de Boncourt, puis conseiller du roi, receveur du grenier à sel de Laon,
et de Marie Blanche, sa seconde femme, dont neuf enfants, qui suivent:
|
(2)
Arrond.t de Laon.
(3) Boncourt, canton de
Sissonne, arrond.t de Laon.
(4) Commune de La Ville-aux-Bois-lè-Dizy,
arrondissement de Laon.
|
III. — Nicolas Brucelle, servant d’armes, puis
chevalier magistral de l’ordre de Malte en 1720, Commandeur d’Etampes en 1724,
résigna cette commanderie en 1749 pour celle de Chevru-en-Brie, mourut
à Laon le 3 août 1752, âgé de 69 ans, et fut inhumé
dans la chapelle de la commanderie de Puisieux (1).
Il avait assisté le 26 novembre 1730 à la bénédiction
de la chapelle du château de la Petite-Ville-aux-Bois.
|
(1)
Puisieux-sous-Laon, comm. de Chambry (Aisne).
|
Voilà
donc notre Commandeur de Châlou-la-Reine retrouvé et son curriculum
vitae connu. A la différence d’autres Commandeurs de l’ordre
qui ont laissé des traces de leur passage dans les registres des paroisses
du canton de Méréville et dont Ch. Forteau nous a conservé
les noms (2), tels que Claude Perrot en 1602,
Henri de Rosnel en 1654, Charles de Rosnel en 1686, Arquier en 1710-1712,
de La Harce vers 1753, frère Nicolas Brucelle ne figure dans aucun
des baptêmes, aucun des mariages ou inhumations relatés aux registres
paroissiaux de [p.275] Pussay. Il n’a pas dû
résider (ou fort peu) à Chalou, ou dut passer la main en 1749
à Henry-Nicolas Foussier de la Harce (1)
(oublié par Mannier qui donne comme successeur à Nicolas Brucelle,
en 1755, frère Libéral-Louis Geouffre) (2).
Nous pourrions nous borner à ces courtes notes,
déjà si concluantes, mais puisque nous avons la bonne fortune,
grâce à M. le comte de Sars, de connaître la famille de
notre Commandeur, nous ne résistons pas au désir de continuer
la communication: |
(2)
Ch. Forteau, Les Registres paroissiaux du canton de Méréville,
Pussay, dans les Annales de la Société hist. et archéol.
du Gâtinais, 1910.
(1) Ch. Forteau, op. cit.
(2) Aux registres de Pussay
il est fait mention de deux simples chevaliers: Robert Desprez, parrain à
Chalou en 1632-1633, décédé en cette paroisse en 1638
et inhumé dans la chapelle de l’Ordre; Jean de Bailly, sieur de Boncourt,
parrain en 1673.
|
2) Jean-Baptiste
Brucelle, prêtre-chanoine de l’église collégiale de Saint-Laurent
de Rozoy, seigneur de La Petite-Ville-aux- Bois et de Lislet en partie,
décédé à Rozoy-sur-Serre le 23 décembre
1753.
|
|
3) Marc-Antoine
Brucelle, sieur de Salon, lieutenant de la grande louveterie, seigneur de
la Petite-Ville-aux-Bois et de Lislet en partie, ancien receveur général
de la châtellenie de Chaourse (3) décédé
sans alliance au château de la Petite-Ville-aux-Bois en 1766 et inhumé
dans l’église paroissiale.
|
(3) Canton de Rozoy, arrondissement
de Laon.
|
4) Simon
Brucelle, seigneur de la Simonne, porte-manteau de la petite écurie
du roi, né en avril 1692, vétéran en 1748, marié
à Epernay en 1717 à Anne Aubert, fille d’Aimé Aubert
de Derrieux, assesseur en l’hôtel de ville d’Epernay, et de Marie-Anne
Bertin, dont cinq enfants qui suivent: [p.276]
a) Simon-Adam Brucelle, né le 27 mars 1720,
se destina d’abord à l’Église et fut tonsuré; il entra
ensuite aux gendarmes et eut un cheval tué sous lui à Fontenoy;
b) Jean-Baptiste-Simon Brucelle, seigneur de la Simonne, ne
le 5 septembre 1723, lieutenant au régiment de Lyonnais, puis capitaine,
chevalier de Saint-Louis en 1748, aide-major en 1752;
c) Marie-Anne Brucelle, née le 8 novembre 1718;
d) Marie Brucelle, née le 11 juillet 1732;
e) Antoinette Brucelle.
5) Henry-François Brucelle, seigneur de la Petite-Ville-aux-Bois
et de Lislet en partie, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de grenadiers
au régiment de Lyonnais, naquit le 27 avril 1703; cadet en 1722, lieutenant
en 1726, il leva une compagnie en 1733 et reçut celle des grenadiers
le 26 novembre 1745, la croix de Saint-Louis en 1745; sa mauvaise santé
et un coup de fusil dans le bras l’obligèrent à quitter le service
en 1748. La mort de ses deux frères aînés lui ayant laissé
l’ensemble du domaine de la Petite-Ville-aux-Bois, il y mourut le 28 novembre
1776 et fut inhumé dans l’église paroissiale. Il avait épousé
en l’église d’Avesne, le 5 décembre 1758, Anne-Thérèse-Ignace-Joseph
de Sars, née à Valenciennes le 3o novembre 1727, décédée
à Laon le 23 octobre 18o8, fille cadette de Denis-Joseph de Sars,
écuyer, seigneur de Beaussart, Curgies, Auhec, Haveluy, etc., et de
Marie-Thérèse-Joseph Veltom, sa seconde femme. [p.277]
Sa veuve se remaria en la chapelle du château
de la Petite-Ville-aux-Bois, le 4 mars 1778, à Pierre Léonard
de Castres, chevalier, seigneur en partie de Vaux-lès-Rubigny, chevalier
de Saint-Louis, capitaine au régiment provincial de Soissons, né
en 1742, mort à Laon le 8 novembre 1794.
6) Marie-Madeleine Brucelle, mariée à
Charles Jongleur, conseiller du roi, élu en l’élection de Laon,
fils d’Antoine Jongleur, bourgeois de Laon, et de Marguerite Tucien; elle
mourut à Laon le 1er juillet 1765; âgée de 80 ans, et
fut inhumée en l’église Sainte-Geneviève de cette ville;
dont deux filles;
7) Élisabeth Brucelle, femme d’Antoine Boucher,
avocat en Parlement et receveur général de la commanderie de
Boncourt, y demeurant, dont un fils et trois filles;
8) Marie Brucelle,
baptisée en l’église de Boncourt le 1er septembre 1701, morte
jeune;
|
|
9)
Catherine-Elisabeth Brucelle, morte jeune (1).
Concluons: 1° La «Mine au blé de Chalou
la Royne» en 1740 était un récipient qui devait mesurer,
s’il était cylindrique comme nos mesures actuelles, 0 m. 4635 de hauteur
sur autant de diamètre;
2° Le commandeur Brucelle appartenait à une
de ces familles terriennes de Picardie qui ont laissé dans le sol de
l’Aisne de si profondes racines que des rameaux sains et vigoureux s’y propagent
encore.
MAXIME LEGRAND.
|
(1)
Renseignements empruntés aux Dossiers bleus de la Bibliothèque
nationale, aux registres paroissiaux et aux titres de propriété
du domaine de La Petite-Ville-au-Bois, dus à l’obligeance de M. le
comte Maxime de Sars auquel nous offrons nos plus sincères remerciements.
|
|