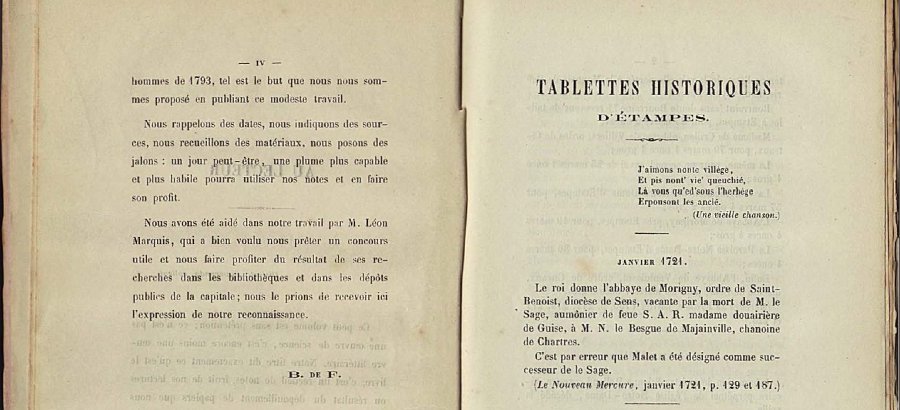|
|
TABLETTES
HISTORIQUES
D’ÉTAMPES ET DE SES ENVIRONS
Par B. de F.
*
ÉTAMPES
IMPRIMERIE DE AUGUSTE ALLIEN
3, RUE AU PONT QUESNEAUX, 3
1876
|
|
Disjecta, quærendo,
collegi.
Ce petit volume est sans prétention; ce
n’est pas une œuvre de science, c’est encore moins une œuvre littéraire.
Notre titre dit exactement ce qu’est le livre; c’est un recueil de note,
fruit de nos lectures ou résultat du dépouillement de papiers
que nous avons eus entre les mains. Tirer de l’oubli des faits peu connus
et souvent inédits; soustraire à la destruction du temps des
pièces uniques se rattachant à l’histoire du pays d’Étampes,
de ses anciennes institutions, de ses monuments, de ses illustrations, etc.;
mettre au jour des documents authentiques sur les différentes époques
de notre histoire locale; montrer, pièces en mains, ce qu’ont fait
dans notre pays les [p. IV] hommes de 1793, tel est le but que nous nous sommes proposé
en publiant ce modeste travail.
Nous rappelons des dates, nous indiquons des sources,
nous recueillons des matériaux, nous posons des jalons: un jour
peut-être, une plume plus capable et plus habile pourra utiliser nos
notes et en faire son profit.
Nous avons été aidé dans
notre travail par M. Léon Marquis, qui a bien voulu nous prêter
un concours utile et nous faire profiter du résultat de ses recherches
dans les bibliothèques et dans les dépôts publics
de la capitale; nous le prions de recevoir ici l’expression de notre reconnaissance.
B. de F.
|
|
|
TABLETTES HISTORIQUES
D’ÉTAMPES
J’aimons nonte villège,
Et pis nont’ vie’ queuchié,
Là vous qu’ed’sous l’herbège
Erpousont les ancié.
(Une vieillle chanson.)
|
|
[001]
|
JANVIER 1721.
Le roi donne l’abbaye de Morigny, ordre de Saint-Benoist,
diocèse de Sens, vacante par la mort de M. le Sage, aumônier
de feue S. A. R. madame douairière de Guise, à M. N. le Besgue
de Majainville, chanoine de Chartres.
C’est par erreur que Malet a été
désigné comme successeur de le Sage.
(Le Nouveau Mercure,
janvier 1721, p. 129 et 187.)
|
|
[002]
|
JANVIER 1760.
Le roi et la famille royale ayant jugé
à propos d’envoyer à la Monnaie de Paris, leur vaisselle
d’argent pour subvenir aux besoins actuels de l’État, les princes
du Sang, les seigneurs de la Cour..., les citoyens riches ont donné
dans cette occasion les plus grandes marques de zèle en envoyant
leurs bijoux et leur argenterie.
Dans la liste des
donateurs, mentionnant en même [p. 2] temps l’état
de la vaisselle portée à la Monnaie de Paris, nous voyons
figurer:
Bourraint (sans doute Bourraine?) receveur de tailles à
Étampes, pour 25 marcs 2 onces;
Madame de Crillon, abbesse de Villiers,
ordre de Citeaux, pour 79 marcs 1 once 1 gros;
La même, pour un second envoi
de 25 marcs 1 once 1 gros;
La Congrégation de Notre-Dame
d’Étampes, pour 57 marcs 4 onces 2 gros;
L’Abbaye de Morigny, près Étampes,
pour 49 marcs 4 onces 4 gros;
La Paroisse Notre-Dame d’Étampes,
pour 30 marcs 4 onces;
Enfin, l’Abbaye de Vauluisant, ordre
de Citeaux, diocèse de Sens, pour 26 marcs 1 once 5 gros.
(Mercure de France,
janvier 1760, p. 242, 244, 217 et 223.)
|
|
[003]
|
JANVIER 1701.
Inhumation de maistre Etienne Rolland, prestre,
vicaire perpétuel de l’église Notre-Dame, décédé
la veille.
|
|
[004]
|
9 JANVIER 1794 (20 NIVOSE
AN II).
Une députation de la Société
républicaine de la commune d’Étampes, demande à la
Convention nationale:
1° Que le district d’Étampes soit compris
comme les autres districts du département de Seine-et-Oise, dans
1a répartition des secours accordés pour la subsistance des
pères, mères et femmes des défenseurs de la patrie
qui combattent aux frontières; [p. 3]
2° Qu’il ne soit plus employé d’orge
au brassage des bières, ni à la fabrication des cuirs, amidon
et poudre à poudrer;
3° Que les prisonniers répandus dans
les districts d’Étampes et de Dourdan, maintenant logés
dans les églises, où ils meurent de froid, soient logés
de manière à pouvoir soutenir les rigueurs de la saison;
et qu’une commission soit chargée de prendre les informations nécessaires
sur les délits de ces prisonniers, et qu’ils soient incessamment
jugés.
Un membre appuie ces propositions, et la Convention
décrète:
Sur la première, que le Ministre de l’Intérieur
est chargé de faire exécuter la loi; et que l’Administration
du département rendra compte des motifs qui l’ont déterminée
à ne pas faire participer le district d’Étampes aux secours
accordés aux pères, mères et veuves des défenseurs
qui combattent aux frontières, comme il en a usé pour les
autres districts.
Elle renvoie la seconde au Comité d’Agriculture
pour en faire un rapport incessamment.
Et la troisième au Comité de Salut
public, pour en faire aussi un prompt rapport.
(Procès-verbaux
de la Convention nationale, volume 29, p. 91 et 92.)
|
|
[005]
|
13 JANVIER 1791.
Le curé d’Estouches adresse an Directoire
du district d’Étampes, la pétition suivante:
«Messieurs,
Le curé d’Estouches en le département
de Versailles, district d’Estampes, soussigné, a l’honneur de vous
[p. 4] représenter que, le 20 mars 1790, un vent du Nord soufflant
avec impétuosité a renversé un espace et plus de
l’église, que c’est la partie du cœur, (sic) que, d’après
les loix, les décimateurs sont tenus à ces réparations,
mais que le curé soussigné n’étant point en 1790
décimateur, mais simplement régisseur, il ne doit pas être
tenu à cette réparation, c’est pourquoi, il vous supplie,
Messieurs, de vouloir bien dans le compte qu’il vous rend du produit de
la dîme, lui allouer les dépenses qu’a occasionnées
cet accident.
«On objectera peut-être contre cette
requête que le Gouvernement ne reconnaît point de réparations
faites sans son ordre.
«A cela, Messieurs, le suppliant vous prie
de considérer: 1° qu’à l’époque de cet accident,
les départements et districts n’étaient point encore en exercice,
que l’on ne savait à qui s’adresser; en second lieu, que cet espace
de 20 à 25 pieds de long donnait davantage prise an vent, et mettait
toute l’église en péril. Ainsi, d’un côté,
la chute certaine de toute l’église si on ne s’occupait promptement
de réparer; de l’autre, l’ouverture des Pasques qui n’était
que dix jours après, ont déterminé le suppliant à
réparer le jour même de l’accident, espérant que l’Etat
voudra bien lui tenir compte du Mémoire de dépenses ci-joint;
c’est dans cette espérance qu’il a l’honneur d’être avec le
respect le plus profond, Messieurs,
«Votre très-humble, très-obéissant
serviteur,
«FOLLYE,
«Curé d’Estouches.»
MÉMOIRE des réparations
faites à l’église d’Estouches.
Premièrement
trois milliers de tuiles et quelqu’enfaiteaux, [p.5]
comme il paraît par la quittance.
|
102 liv.
|
" sols.
|
Pour deux pannes
|
15
|
"
|
Six bottes de
lattes
|
6
|
12
|
Sept livres de
doux
|
3
|
10
|
Deux chevrons
|
7
|
"
|
Quatre berouetées
de chot.
|
5
|
"
|
Pour le charpentier
|
12
|
"
|
Pour le masson
|
18
|
"
|
Pour quinze clavettes
de fer
|
3
|
15
|
De plus pour le
lambris
|
75
|
"
|
Total
|
247 liv.
|
17 sols
|
|
|
|
Certifié véritable dans tout son
contenu par nous Officiers municipaux de ladite, paroisse, ce 13 janvier
1791.
Signé: Merlet, maire, Degouillous,
Pillias, Gillotin, Bouchet, greffier.
Au dos de cette pétition se trouve l’arrêté
du Directoire du district d’Étampes suivant:
Le Directoire vu le certificat de la Municipalité
contenant attestation des faits contenus de l’autre part;
Considérant l’embaras dans lequel le sr
curé s’est trouvé et l’impossibilité en laquelle il
était de recourir, au 20 mars 1790, à aucuns corps administratifs
pour être autorisé à faire les réparations dont
il s’agit;
Estime et est d’avis, ouï sur ce M. le Procureur
syndic, qu’il y a lieu sans tirer à conséquence d’ordonner
que ladite somme de 247 livres 17 sols sera rendue aud. sr curé qui,
en 1790, n’était que régisseur de son bénéfice
à la charge toutefois de déposer au Secrétariat du
district les quittances de paiement des ouvriers et fournisseurs.
Fait au Directoire du district d’Étampes,
le 18 janvier 1791, séance du matin.
Signé: Charpentier, président,
Sagot, Duverger. Venard, et Grosnier, secrétaire
[p. 6]
|
|
[006]
|
17 JANVIER 1579.
Lettres-patentes de Henry III, roy de France
et de Pollogne, données à Paris et enregistrées en
la Chambre des Comptes, le 24 du même mois, par lesquelles, pour garantir
sa cousine Catherine de Lorraine, dame de Montpensier, du prêt qu’elle
lut avait fait «en ses pressez et récens affaires de la somme
de trante-troys mil troys cent trente-troys escus ung tiers, faisant
cent mil livres, pour subvenir à partie de grandes sommes deues
aux sieurs des Lignes de Suisses. Il reconnaît que les gens de son
Conseil d’état, ont par contrat devant les Notaires au Chatelet
de Paris consenti engaigement de noz duché d’Estampes et conté
de Senlis, affîn de joyr par nostre dite cousine, ses fermiers, receveurs
ou entremetteurs, par ses mains, jusques à la concurrence de la somme
de deux mil sept cent quarante escuz, vingt-six solz trois deniers, à
quoy revient la rente dud. Prest…» «Et ce selon l’évalluation
qui en seroit faicte par les commissaires qui à cest effect seraient
par nous commis et ordonnez.»
Et il commet Anthoine Nicolay, président
de la Chambre des Comptes, Anthoine de Coigneux et Bernard de Kerquifinem,
conseillers en ladite cour, pour faire «les évalluations,
estimations et prisées des maisons, chasteaux, édiffices
et lieux deppendans des-dits duché et conté, sur la valleur
du revenu desdites terres.»
Les Commissaires dressèrent leur procès-verbal
d’évaluation le 24 janvier 1579.
|
|
[007]
|
19 JANVIER 1638.
Par un jugement rendu ce jour, les Commissaires
de [p. 7]
la réformation des hôpitaux et maladreries de France accordent
aux religieux Barnabites établis à Étampes, les
revenus de l’hôpital Saint-Jacques-de-l’Epée, de ladite ville.
La démolition de cet hôpital fut ordonnée
par un jugement des mêmes commissaires, du 15 mars 1656, à
la suite de la visite des bâtiments faite par le Lieutenant-général
du bailliage d’Étampes, le 22 mai 1657.
|
|
[008]
|
23 JANVIER 1790.
Les sieurs Crosnier, substitut du Procureur du
roy au bailliage d’Étampes, Heme de Maison-Rouge, échevin,
Baudry de Lapoterie, conseiller-assesseur, et Hugo, orfèvre vérificateur,
préposés par le Corps municipal à la recette de l’argenterie
déposée à la municipalité d’Étampes,
adressent au Directeur des monnaies de la ville de Paris quatorze marcs
six onces six gros d’argenterie, représentant en argent une valeur
de 794 livres 14 sols, et provenant d’offrandes faites, savoir:
Par M. Pierre Hureau, curé de St-Cir-la-Rivière;
Par madame Marie-Catherine Charpentier, veuve
d’Etienne-Louis Gérosme, bourgeoise d’Étampes;
Par M. Jean-Baptiste Martin, curé d’Adonville;
Par Pierre-Innocent Gérosme-Poussin, marchand
à Étampes;
Par Jean Champigny, conseiller du roy et son
Procureur au grenier à sel;
Par Jacques Crosnier, substitut du Procureur
du roy au bailliage d’Étampes;
Et par Jean Chevallier, bourgeois, demeurant
à Étampes. [p. 8]
|
|
[009]
|
8 PLUVIOSE AN II (27 JANVIER
1794)
Les communes de Milly, Courances, Moigny et Oncy,
district d’Étampes, envoient à la Patrie à titre d’offrande:
249 Chemises; 17 Draps;
10 Paires de souliers; 27 Paires de guêtres;
8 Paires de bas de laine;
2 Mouchoirs;
2 Chapeaux;
3 Gibernes; 1 Havre-sac;
5 Paires de boucles en argent;
1 Boucle de col et 1 cachet en argent;
1 Epée à poignée d’argent;
2 Epaulettes en or;
1 Epaulette en argent; 1 Dragonne en or;
332 liv. 10 s. en argent.
La commune de Mondeville a offert en don pour
les défenseurs de la Patrie:
25 chemises et 25 paires de bas neufs.
(Table des Procès-verbaux
de la Convention, p. 181 et 213.)
|
|
[010]
|
13 PLUVIOSE AN III
(1er FÉVRIER 1795).
Les citoyens composant les Autorités constituées
et la Société populaire de La Ferté-Alais, district
d’Étampes, département de Seine-et-Oise, à la Convention:
«La nuit du 9 au 10 thermidor, fut le tocsin
salutaire [p. 9] que sonna votre
invincible énergie, sur celui de l’heure dernière de nos
tyrans. La France, depuis ce temps, ressent l’heureux passage des horreurs
de la mort à la douceur inappréciable de l’égalité.
Le 21 brumaire vous avez renversé la cour du tyran Robespierre,
en terrassant des satellites qui vouloient rivaliser de pouvoir avec vous.
«Aujourd’hui, citoyens-législateurs,
vous avez rappelé dans votre sein des sénateurs, victimes
de leur courage, vous avez par là rempli le vœu général
de la Nation.
«Grâces immortelles vous soient rendues:
vous avez encore une fois sauvé la Pairie, en rétablissant
le règne de la justice, de la vérité et des lois. Nous
vous jurons, citoyens-représentans, dévouement sans bornes,
fidélité inviolable, et vous déclarons ne jamais
reconnoître d’autre autorité que celle que le peuple vous
a confiée.»
(Procès-verbaux
de la Convention, vol. 54).
|
|
[011]
|
VENDREDI 10 FÉVRIER
1513.
Passage à Étampes du convoi de MADAME
ANNE, deux fois royne de France, duchesse de Bretagne, comtesse de Montfort,
de Richement, d’Estampes et de Vertus.
Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII et seconde
femme de Louis XII, mourut au château de Blois, le 9 janvier 1513,
âgée seulement de trente-sept ans.
«Ceste reyne, dit un historien du temps
cité par Brantôme, estoit une honorable et vertueuse reyne
et fort sage, la vraye mère des pauvres, le support des gentilshommes,
le recueil des dames et damoiselles et honnestes filles, et le refuge
des savants hommes: aussy [p.10] tout le peuple de France ne se peut saouler de la plorer et regretter.
Rien n’avait encore égalé la pompe
des funérailles qu’on lui fit. Son corps fut porté à
Saint-Denis et son cœur enfermé dans un vase d’or en forme de cœur
fut déposé aux Chartreux du faubourg de Nantes.
Bretaigne, le héraut d’armes de la reine,
décrit ainsi dans le récit des funérailles de cette
princesse le passage du convoi à Étampes: (Paris, Aubry, 1858.)
«Le lendemain, qui fut le vendredi, ariva
la royale princesse en sa conté et ville d’Estampes, où
moult estoit aymée, et bien le montrèrent à sa réception.
Il vint à une lieue hors la ville grant nombre d’officiers, tant
de justice que autres, tous vestuz de deul, lesquels, après avoir
fait la révérance au corps, pleurant moult tendrement, vindrent
joindre avec les gens d’église, comme chanoynes, cordeliers et autres
en grant nombre.
«An cette ville fut faict entrée
comme à Orléans, et y estoient messeigneurs et dames du
sang avec toute la triomphe du deul. Et oultre les quatre cens torches
armoyées aux armes de la dicte dame et les cinquante de Bloys armoyées
aux armes de la ville, il y avoit bien trois cens torches, partie aux armes
de la ville, qui sont de gueulles à ung chasteau d’or masonné,
fenestré et crénellé de sable; sur le tout ung escu
escartellé, le premier de France, le second, de gueulles à
une tour portée, fenestrée et crénellée de sable.
«Les parties des autres torches qui se montoint
bien deux cens, estoient armoyées d’ung escu, escartellé,
le premier, de Jhérusalem, le second, de sinople à ung escu
de gueulles soustenu d’or sur une fueille de chesne d’argent. Je m’enquis
pourquoi ils portoient ce quartier des armes de Jhérusalem; l’on
me dit qu’ils estoient yssuz d’un noble homme, nommé Hue le Maire,
sieur de Chaillou, lequel estant adverti que le roy Phelipes le [p.11] Bel devoit ung voyage
en Jhérusalem, à pié, armé, portant ung cierge,
et que le bon roy ne peult pour quelque maladie qui lui survint; et entreprinst
le dict sieur de Chaillou le voyage, ce qu’il fist et accomplit. Et pour
partie de sa rémunération, celluy roy luy octroya ung quartier
des armes de Jhérusalem, et franchit et exempta de tous sucides luy,
ses successeurs et héritiers et ceulx qui d’eulx viendront. Et ainsi
sont peuplés depuys en grant nombre. Pour ce, sont-ilz tenuz de
venir au-devant du corps des princes à leur entrée d’Estampes,
et où ilz y reposent mors sont tenuz de garder et veiller le corps;
ce qu’ils ont fait ce voyage à la dicte dame, et s’apellent la Franchise.
Ainsi entra la dicte dame soubs ung poisle, qui fut de damas, armoyé
de ses armes, et fut mise à repoz à l’église collégiale;
à l’entrée de laquelle y avoit ung grant drap noir, sur
lequel estoit ung grant escusson de ses armes, garny et enrichy de agréez
et cordelières. Aussi fut tout le cueur garny et paré de
deul bien armoyé, et la chappelle ardant et toute l’église
bien parée de lumynaire. Les vigilles et service du soir et du matin
fut beau; et officia ledit abbé de la Roue.»
A ESTAMPES
Estampes, las! sans à
jamais te faindre,
La magnanime et royalle duchesse,
De ton enclos souveraine contesse,
En grant doulleur tu doibs pleurer et plaindre.
RONDEAU.
Pleurez, humains, la douloureuse
perte
Qui venue est, par dolléance experte,
D’un dart mortel prins au lac de souffrance,
De tous vivans, mesmement, dessoubs France.
En puissent voir leur dolléance experte:
Sachez que plus ne sera recouverte
Celle dame que la terre a couverte : [p.12]
Puys qu’en ses faiz n’y a plus d’espérance,
Pleurez, humains.
Soubz noir blason, en veue descouverte,
Soit vostre cueur, de lerme blanche ou verte,
Mys et posé, regrettant l’excellence
De la royne, qui en grant habonde
Pour vous donner eut toujours bourse ouverte;
Pleurez, humains.
|
|
[012]
|
11 FÉVRIER 1755.
Louis d’Étampes, Marquis d’Étampes,
fils de Louis Roger, Marquis d’Étampes et de Marguerite-Lydie de
Becdelièvre de Cany, épouse Adélaïde Godefroy-Julie
de Fouilleuse de Flavacourt.
(Mercure de France,
mai 1755).
|
|
[013]
|
6 FÉVRIER 1147.
Assemblée d’Étampes.
L’ouverture du parlement se fit le 16 février
1147. Louis le Jeune le présida en personne, et proposa les diverses
questions sur lesquelles il appelait les délibérations des
conseillers. L’enthousiasme semblait un peu refroidi; mais à l’aspect
de saint Bernard «qui venait de conférer pour la milice
de la Croix, avec le monarque et les grands du royaume des Teutons!»
les visages s’épanouirent, et l’Assemblée ressentit une émotion
de fierté chrétienne qui ranima l’énergie des résolutions.
La première journée fut employée
à entendre les ambassadeurs de Conrad et les députés
de Geisa, roi de Hongrie, annonçant que leurs souverains accordaient
[p.13] aux Croisés le libre passage sur leurs terres. On lut aussi
les lettres de l’empereur grec, Manuel Comnène, contenant les plus
emphatiques protestations d’amitié, en réponse à la
notification que le roi de France lui avait faite de la croisade. Le style
oriental et hyperbolique de ces épîtres choqua le bon sens
français. «L’évéque de Langres, Godefroy, prenant
compassion du roi qui rougissait de se voir encensé de tant de flatteries;
et ne pouvant supporter les interminables phrases du lecteur, les interrompit:
Mes frères, leur dit-il, veuillez ne pas parler si souvent de la
gloire, de la celsitude, de la piété et de la sagesse du roi!
Il se connaît, et nous le connaissons aussi. Dites-lui tout brièvement
et droitement ce que vous avez à lui dire.»
Le lendemain, l’Assemblée s’occupa de tracer
l’itinéraire pour gagner la Palestine. Les ambassadeurs de Roger,
roi de Sicile, proposèrent le chemin de la mer comme le plus sûr
et le plus favorable au transport des troupes dans les ports de la Syrie.
Ils insistèrent vivement sur les avantages de cette voie, sans
oublier les nombreux inconvénients, les périls et les difficultés
inévitables d’un long trajet par terre, au milieu des pays barbares.
Mais le principal motif qu’ils alléguèrent à l’appui
de leur opinion, fut le souvenir de l’ancienne, trahison des grecs, à
l’époque de la première croisade. La prudence de ces normands-siciliens
ne fut cependant pas goûtée ; et soit que la haine qu’ils
portaient aux grecs, leurs agresseurs, rendît leur témoignage
suspect, soit que la navigation n’offrit point assez d’attraits à
l’esprit aventureux des guerriers français, les conseils de Roger
ne prévalurent malheureusement point dans l’Assemblée. On
s’arrêta au projet de descendre la vallée du Danube, pour
diriger le gros de l’armée vers Constantinople.
Toutes les dispositions étant prises, et
les conseillers portant leur attention sur les intérêts de
la France, durent [p.14] aviser à la garde du royaume et à son administration
pendant l’absence du roi.
«Donc, après que l’abbé de
Clairvaux, dit la chronique, eut fait son oraison pour invoquer les lumières
du Saint-Esprit, le roi Loys, refrénant sa puissance par la crainte
de Dieu, suivant sa coutume, abandonna le choix des gardiens du royaume
aux prélats et aux seigneurs Ceux-ci se retirèrent pour en
délibérer, et rentrèrent au bout de quelque délai,
après avoir décidé ce qu’il y avait de mieux à
faire. Bernard marchait à leur tête; et désignant du
doigt l’abbé Suger et le comte Guillaume de Nevers, il dit: Voilà
les deux glaives que nous avons choisis; cela suffit!...»
«Ce double choix, poursuit le chroniqueur,
aurait plû à tout le monde, s’il avait été agréable
à l’un des élus. Mais le comte de Nevers protesta qu’il
avait fait vœu de se retirer chez les Chartreux; et, en effet, il s’ensevelit
peu de temps après dans le cloître, malgré les fortes
remontrances du roi, et sans que nulle prière pût le détourner
de son pieux dessein.»
Il fallut des instances non moins vives pour déterminer
l’abbé Suger à accepter une fonction qu’on regardait comme
une charge et un fardeau plutôt qu’une dignité.
Il s’en défendit longtemps; mais enfin, vaincu par les sollicitations
du roi et par les ordres du pape lui-même, il accepta la
régence; et la postérité sait avec quel désintéressement,
avec quelle noble intégrité ce ministre fidèle dirigea
les affaires du royaume.
L’Assemblée ayant terminé ses travaux,
on se sépara, pour ne plus s’occuper que des préparatifs
du départ. De tous côtés, en France, en Allemagne, dans
presque toutes les contrées de l’Europe, les populations se mirent
on mouvement; on ne voyait que des croisés, on ne rencontrait sur
tous les chemins que des guerriers, des pèlerins et des troubadours.
Les temps héroïques semblaient renaître; une espèce
de honte s’attachait [p.15] aux chevaliers qui n’avaient point arboré la Croix: on
leur envoyait, en signe de flétrissure, une quenouille et des fuseaux.
(Vie de saint Bernard,
par le P. de Ratisbonne).
|
|
[014]
|
3 VENTOSE AN III
(21 FÉVRIER 1795).
Sur le rapport du Comité des secours publics
et sur la pétition du citoyen Philippe Delîsle, d’Étampes,
capitaine de grenadiers du 1er bataillon d’Eure-et-Loir, blessé
à l’affaire du fort de Commines, la Convention décrète:
«La Convention nationale, après avoir
entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition
du citoyen Philippe Delisle, d’Étampes, capitaine de grenadiers
du 1er bataillon d’Eure-et-Loir, blessé et estropié à
l’affaire du fort de Commines, le 22 juillet 1793, décrète
que la trésorerie nationale mettra à la disposition du district
d’Étampes, la somme de 300 livres, pour être comptée
au citoyen Philippe Delisle, à titre de secours provisoire, imputable
sur la pension à laquelle il peut avoir droit.»
(Procès-verbaux
de la Convention, vol. 56, p. 48).
|
|
[015]
|
27 FÉVRIER 1722.
Passage à Étampes de l’infante-reine,
Marie-Anne-Victoire d’Espagne, âgée de cinq ans, venant à
Paris pour épouser Louis XV, qui n’en avait que douze. Elle logea
à l’hôtel des Trois-Rois. Cette union ne se réalisa
pas, et la jeune princesse ne devint pas reine de France, mais elle retourna
en Espagne en 1725.
M. de Mont-Rond a donné dans son ouvrage
une relation [p.16] du passage de la princesse à Étampes; à l’occasion
de ce passage, le Mercure, dans le numéro d’avril 1722, a consacré
une assez longue notice à la description de la ville. On y trouve
la liste des seigneurs d’Étampes depuis la reine Blanche jusqu’au
duc de Vendôme. Cette notice se termine par de curieux renseignements
sur le commerce d’Étampes dans ce temps déjà éloigné,
qui nous fixent sur l’époque à laquelle a cessé la
navigation sur la Juine:
«Cette ville fournit à Paris quantité
de bled, et aux marchands d’Orléans et de Béarnais, beaucoup
de laines. Il y a 70 ans qu’elle était beaucoup plus marchande qu’elle
n’est aujourd’huy, à cause que sa petite rivière était
navigable par le moyen de plusieurs écluses qui en faisoient grossir
les eaux; tellement qu’on y voyoit continuellement trente ou quarante
balteaux de dix muids de bled chacun, qu’on transportait de là
au port de la Tournelle de Paris; mais les écluses ayant été
rompues, les marchands de la Beausse sont obligez de faire porter leurs
bleds à Paris par terre, ce qui porte un très-grand préjudice
à Étampes; car les voitures ne font qu’y passer, au lieu
qu’autrefois les marchands faisoient de cette ville leur entrepôt."
Il résulte de ce qui précède
que la navigation aurait cessé à Étampes vers l’année
1652.
|
|
[016]
|
MARS 1095.
La charte de la franchise octroyée à
Eudes le Maire, seigneur de Challo-Saint-Mard (c’est Saint-Médard)
et chastellin d’Estampes, à luy, ses enfans et descendans par ledict
roy Philippes premier du nom, donnée eu son palais au chasteau d’Estampes,
au mois de mars mil quatre vingts el quinze, est soubzsignée de
Hugues, sénéchal, de Gaston de Poissy, chambrier, de Payen
[p. 17] d’Orléans, bouteillier, et d’un Guy, frère de Galeran,
qu’il est vrayesemblable de croire avoir tenu la place du connestable, car
autrement n’y eust-il soubzsigné. Et ut hæc
Libertas, et omnia firma et inconvulsa permaneant, memoriale istud fieri,
Nominis sui caractere et sigillo signari et præsente propria manu
sud cruce sancta corrobari præcepit. Adstantibus de palatio ejus quorum
nomina subtitulata sunt, et signa S. Hugonis. DAPIFERI. S. Gastonis de
Pistiaco, BUTICULARII. S. Pagani de Aureliis, BUTICULARII. S. Guidonis,
fratris Galeranni.
Actum STAMPIS in palatio, mense martio anno ab incarnatione millesimo
quater vigesimo, decimo quinta, regni ejus trigesimo septimo.
(André Favyn, parisien,
Traictez des premiers officiers de la Couronne de France).
|
|
[017]
|
MARS 1663.
On lit dans une lettre de Guy-Patin de cette époque:
Par arrêt de la Chambre de Justice, un nommé
Pompardin, receveur des tailles à Estampes, a été
condamné de faire amende honorable dans la cour du palais, à
10,000 livres d’amende et à un bannissement pour plusieurs malversations
en sa charge, dont il a été convaincu: Il eût été
pendu si plusieurs de ses parens et amis n’y eussent employé tout
leur crédit.
(Guy-Patin, Lettres,
6 mars 1663).
|
|
[018]
|
DU LUNDY 7 MARS 1649.
Ce jour quantité de bleds et farines arrivèrent
à Paris en charettes et sur des chevaux, que l’on avait amenés
[p.18] des environs d’Estampes, et d’antres bourgs et villages sur ce
chemin.
(L’histoire du temps, ou le véritable
récit de ce qui s’est passé dans le Parlement de Paris,
depuis le mois d’août 1647, jusques au mois de novembre 1648. Augmentée
de la seconde partie qui vient jusques à la Paix).
1649, sans lieu ni nom d’imprimeur.
|
|
[019]
|
11 MARS 1791.
La Municipalité d’Étampes, sur la
proposition du Procureur de la commune, a pris l’arrêté suivant:
Le Procureur de la commune ayant représenté que l’Assemblée
nationale par son décret du 4 décembre précédent,
a provisoirement décerné une somme de 125,000 livres au département
de Seine-et-Oise, pour venir au secours des malheureux et être employée
à des ateliers de charité; que plusieurs grands chemins
d’une utilité indispensable, tels que celui de Dourdan et celui
de Pithiviers, sont demeurés inachevés faute de fonds; que,
même en cette ville d’Étampes, le pont dit d’Orléans,
situé sur la grande route, a besoin d’être réparé,
même d’être reconstruit entièrement; qu’en conséquence,
il serait urgent de demander au Département d’allouer une certaine
somme pour faire exécuter ces ouvrages au plutôt.
Sur quoy, le Corps municipal:
Considérant que, le bruit s’est répandu
que, desd. 125,000 livres, sept ont été accordées
au District d’Étampes, que de ces 7,000 livres, quatre ont été
destinées a la confection du chemin d’Étampes à Châlo-St-Mars,
et qu’il serait important de donner la préférence aux routes
de Dourdan et de Pithiviers, qui sont d’une [p.19] nécessité
indispensable, tant pour l’approvisionnement du marché de cette
ville que pour l’abordage des bois de chauffage et l’entretien des communications
avec Chartres; qu’il serait important d’entrer dans l’esprit de la loi
en proportionnant la répartition des travaux, en raison des moyens,
des besoins et de la population des Municipalités qui composent le
District;
Que, les besoins sont beaucoup plus pressants
dans In ville où les artisans sont sans travail, que, dans les
campagnes où les travaux vont ouvrir incessamment et offrir des
ressources considérables aux journaliers:
A arrêté, qu’expédition de
la présente sera adressée à Messieurs les Administrateurs
du département, à l’effet d’obtenir qu’une partie desdits
fonds proportionnée aux besoins et à la population de la
commune d’Étampes, sera attribuée à la Municipalité
et employée sous ses ordres, à la réparation des routes
d’Étampes à Dourdan et d’Étampes à Pithiviers.
|
|
[020]
|
13 MARS 1720.
«Madame de Roussillon, sœur de Mgr l’évêque
de Laon, nommée abbesse de Villiers, Ordre de Citeaux, proche La
Ferté-Aleps, prit possession de cette abbaye: elle était accompagnée
de M. le marquis de Clermont, son autre frère, capitaine des gardes-suisses
de Mgr le duc d’Orléans, et de madame de Grillon, religieuse bénédictine,
nièce de Mgr l’archevêque de Vienne. La nouvelle abbesse
fut reçue et complimentée par dom Moreau, bachelier de Sorbonne,
directeur de l’abbaye, ancien prieur de Citeaux, et visiteur général
de son ordre; il était frère de M. Moreau de Mantour, de
l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres.»
(Nouveau Mercure, mars
1720, p. 176). [p.20]
|
|
[021]
|
23 VENTOSE AN II (13 MARS
1794).
L’agent national près le district d’Étampes
écrit an président de la Convention que, depuis le 22 frimaire
dernier, il n’a pas donné avis du succès des ventes des émigrés,
parce que le prix ne faisait que doubler l’estimation.
Il annonce quatre parties de vente:
L’une, estimée 300 liv., adjugée
à 1805 liv.;
Une autre — 348 —
— 1840 —
—
— 615 — —
3500 —
—
—1200 — —
3700 —
Il ajoute que la Société populaire
d’Étampes a armé, équipé et fait partir un
cavalier, et qu’un second partira au premier jour.
Mention honorable, insertion au Bulletin, renvoi
au ministre de la Guerre.
(Procès-verbaux
de la Convention, 33e volume.)
|
|
[022]
|
27 MARS 1792.
L’abbé le Cerf, curé de Saint-Clément
de la ville d’Arpajon, prononce l’Eloge funèbre de Henry Simonneau,
maire de la ville d’Étampes. Il prit pour texte de son discours,
les paroles suivantes du livre des Machabées:
«Il quitta la vie en laissant à l’univers
dans le souvenir de la vie un modèle de vertu et de courage à
suivre.»
Dans ce discours imprimé à Paris,
à l’Imprimerie de la Société des Amis du commerce,
(8 pages in-4°), on lit:
«Henry Simonneau, voilà le grand
homme qui fut [p. 21] capable de préférer son devoir à son existence
et la mort la plus glorieuse à une vie qu’il eût fallu acheter
par la honte et l’opprobre.»
«Si je n’avais à vous présenter
que les vertus privées de Henry Simonneau, il me suffirait d’être
l’écho du cri public et de répéter avec ceux au milieu
desquels il a vécu, avec ses ennemis mêmes qu’il fut un
bon mari, un tendre père; le soutien de l’ouvrier indigent, le
bienfaiteur du pauvre; mais lorsque cette mort, si terrible dans ses coups,
ensevelit avec elle sous la tombe les vertus publiques d’un magistrat
servant fidèlement son pays, la loi à la main et dans le
cœur, c’est alors que le regret devient plus amer et que l’état
tout entier doit prendre le deuil.»
Malgré le ton emphatique de ce discours
qui est dans le goût du temps, nous reproduisons ce qui est relatif
à la mort de Simonneau; le jugement que porte l’orateur, sur les
auteurs du crime confirme nos appréciations précédentes:
«Des intrigants, des factieux, des hommes
de trouble et de discorde, cachés dans la profondeur des ténèbres,
dans l’obscurité du mystère, sonnent l’alarme de tous côtés,
les paisibles habitants des campagnes séduits par de perfides conseils,
abandonnent leurs maisons, leurs travaux. Ils prennent les armes, ils s’assemblent
en tumulte, ils courent effrayer par le son calamiteux de la cloche, des
voisins tranquilles...
«Que demandez-vous? du pain. — Vous en aurez,
mais pourquoi ces instruments homicides? La subsistance de l’homme s’obtient-elle
les armes à la main? les victimes que vous dévouez à
la mort vous nourriront-elles?...
«Votre aspect alarmant va faire enfouir
le reste du grain, les marchés déserts ne vont plus offrir
à vos yeux que l’affamant spectacle de la stérilité,
le cultivateur [p.22] menacé va abandonner pour toujours le soin d’une charrue
qui ne doit plus payer ses sueurs.
«Étampes est le théâtre
où se consommera un grand crime!
«Ils y arrivent guidés par l’erreur:
le maire est mandé, Henry Simonneau paraît! il leur parle
le langage d’un magistrat ami de l’ordre; il leur peint l’influence dangereuse
de leur rassemblement sur la chose publique; il les invite à considérer
qu’il n’est pas le propriétaire des grains qui se trouvent à
Étampes; que sa place est celle de protecteur d’un commerce déclaré
libre... Il ne sera pas entendu; la taxe du blé ou la mort, voilà
l’alternative pour Henry Simonneau. — Ce que vous exigez de moi, la loi
le défend, prenez ma vie!»
|
|
[023]
|
7 GERMINAL AN II (27 MARS
1794).
Un député de la société
populaire des sans-culottes d’Étampes, se présente à
la Convention et dépeint l’indignation des membres qui composent
la société au nom de laquelle il parle contre les derniers
conspirateurs, et sollicite leur châtiment; «que leur vengeance
soit terrible, dit-il, que son bruit fasse trembler les vils despotes sur
leurs trônes déjà ébranlés, et que la
renommée leur apprenne quelle est l’énergie d’un peuple libre.»
Le président répond et invite le
pétitionnaire à la séance. La mention honorable de
son adresse et son insertion au Bulletin sont décrétées.
(Procès-verbaux,
34e volume).
|
|
[024]
|
9 GERMINAL AN II (29 MARS
1794).
Dans le tableau nominatif des citoyens présentés
à la [p.23] Convention nationale par le comité des décrets,
procès-verbaux et archives, pour remplir les places de préposés
au triage des titres, conformément à l’article 19 de la loi
du 7 messidor de l’an II de la République, l’un des trois préposés
pour le département de Seine-et-Oise est: Jean Gérard Geoffroy,
à Étampes, ex-juge au tribunal du district d’Étampes.
(Procès-verbaux
de la Convention, 38e volume).
|
|
[025]
|
29 MARS 1746.
Arrêt du Conseil d’État du roi, ordonnant
que dans un mois, les seigneurs particuliers des villes et lieux dans l’étendue
de 20 lieues des environs de Paris, qui prétendraient avoir droit
de marché aux bestiaux à pied fourché, représenteront
devant M. de Marville, nommé commissaire en cette partie, les lettres
de concession et autres pièces justificatives de ce droit de propriété,
pour en connaître l’état et sur son avis, leur être
fait droit...
|
|
[026]
|
31 MARS 1763.
«Louis de Talaru, marquis de Chalmasel, comte de Chamarande,
chevalier des ordres du roi, brigadier de ses armées, gouverneur
des villes et châteaux de Phalsbourg et Sarrebourg, conseiller d’État,
premier maître d’hôtel de la reine, est mort à Versailles,
le 31 mars, âgé de 82 ans.» Il avait été
nommé gouverneur de Phalsbourg, au mois d’octobre 1736, en remplacement
de son père.
(Mercure de France,
1756, octobre, et 1763, juillet). [p.24]
|
|
[027]
|
1er AVRIL 1746.
Jugement souverain, qui condamne le nommé
Gilles Breton, facteur du bureau de la poste aux lettres d’Étampes,
à être attaché et mis au carcan pendant trois jours
de marché consécutifs, avec écriteau portant ces mots:
Facteur de lettres, fabricant de fausses taxes, et à
un bannissement de la généralité de Paris, pendant
trois ans.
|
|
[028]
|
1er AVRIL 1754.
«Messire des Mazis, chevalier, brigadier
des armées du roi, de la promotion de 1740, lieutenant-général
de l’artillerie au département général de Lyonnois,
servant depuis 67 ans dans le corps de l’artillerie, est mort à
Lyon, le 1er avril, dans la 85e année de son âge. Il était
fils d’Henri des Mazis, chevalier, seigneur de Brières-les-Scellées
et d’Elisabeth le Roux. Il était issu de Jean des Mazis, sénéchal
du Hurepoix, gouverneur des villes et châteaux d’Estampes et de Dourdan,
en l’an 1429»
(Mercure de France,
juin 1754, p. 201).
|
|
[029]
|
4 AVRIL 1502.
Décès à Paris, au monastère
des Filles-Dieu, religieuses de l’abbaye de Fontevrault, de Cantien Hüe,
un des savants et saints personnages de l’Ordre de Fontevrault; il était
né à Étampes, en 1442. Il fit ses études au
collège de Navarre, où il passa vingt-quatre ans, d’abord
comme disciple et ensuite en qualité de maître. Au mois de décembre
1470, il fut élu procureur, et au mois d’octobre 1473, il fut nommé
recteur de l’Université [p.25] de Paris. L’amour de la retraite le porta à entrer dans
l’Ordre de Fontevrault, il avait alors 32 ou 34 ans. Il eut toutes les vertus
d’un parfait religieux et tout le zèle d’un vrai savant. En 1485,
Guillaume Roger, prieur de l’Encloître en Gironde, fut remplacé
en ce prieuré par Cantien Hüe, et en 1491, Cantien Hüe fut
fait visiteur de l’Ordre; il remplissait encore ces fonctions en 1501.
Il mourut au monastère des Filles-Dieu
de Paris, et fut inhumé dans une chapelle de ce couvent. On lui
avait consacré une épitaphe en vers latins avec une espèce
de traduction en vers français contenant son éloge. Cette
double épitaphe nous a été conservée par Piganiol
de la Force, dans la Description historique de la ville de Paris et de
ses environs; elle nous apprend quelques circonstances concernant
Cantien Hüe, que n’ont pas rapportées ses
biographes. Voici la version française:
Cy gist Cantien Hüe, digne
de mémoire,
Du monde, de la chair, du diable ayant victoire.
De louable vie et céleste conversation…
… Lequel à mil cinq cens et deux, de Saint-Ambroise
Le jour et feste,
Sexagénaire et vertueux, rend l’esprit, élève
la teste.
Delaunay, dans son Histoire
du Collège, de Navarre, cite un Jean Hüe, d’Etampes,
docteur en théologie de la maison de Navarre, curé de Saint-André-des-Arts,
à Paris, qui rendit de grands services à l’Université
et qui mourut vers l’an 1482. Il y a lieu de croire qu’il était parent
de Cantien Hüe.
|
|
[030]
|
12 GERMINAL AN II (2 [Lisez en fait 1er (B.M.)] AVRIL 1794).
Les Administrateurs du district d’Étampes
envoient, à la suite des cloches et des Saints de leur arrondissement,
[p. 26] des objets d’équipement,
un don en chemises de 1,990 fr.; plusieurs autres effets, tels que souliers,
bas, guêtres, draps, cols noirs, habits, sacs de peaux, manteaux; en
numéraire 48 livres, en assignats 1,349 liv. 5 sols, 1 épaulette
d’or, 1 dragonne, 4 médaille en argent, 1 cachet pareillement en argent,
1 paire de boucles d’argent, 4 croix ci-devant de Saint-Louis.
|
|
[031]
|
16 GERMINAL AN II (5 AVRIL
1794).
Le Directoire du district d’Étampes fait
part à la Convention, que le citoyen Pierre-Louis-Joseph Laumonnier
donne, pour les frais de la guerre et pour tout le temps qu’elle durera,
la moitié d’une pension de 1,800 liv., dont il jouit sur l’Etat.
|
|
[032]
|
16 GERMINAL AN II (5 AVRIL
1794).
A. Crassous, représentant du peuple dans
les départemens de Seine-et-Oise et Paris, écrit qu’un petit
fil de la conspiration s’est manifesté dans le district d’Étampes,
qu’il a donné des ordres pour faire arrêter les coupables,
et que le district d’Étampes a pris des mesures fermes et vigoureuses
contre les malveillans.
|
|
[033]
|
19 GERMINAL AN II
(8 AVRIL 1794).
Le commandant des volontaires du bataillon d’Étampes,
en garnison à Trégnier, envoie, au nom de son bataillon,
2,308 liv. pour les frais de la guerre.
|
|
[034]
|
11 AVRIL 1718.
Madame Marie Anne de Bourbon, princesse du sang,
[p.27] veuve de Louis-Joseph, duc de Vendosme, de Mercœur et d’Étampes,
meurt sans postérité, âgée de 40 ans.
|
|
[035]
|
15 AVRIL 1772.
Naissance à Étampes d’Etienne-Geoffroy-Saint-Hilaire.
Il fut successivement professeur au Jardin des
Plantes, fit partie de la Commission scientifique attachée à
l’expédition d’Egypte, reçut de Napoléon en 1807 une
nouvelle mission pour visiter les collections d’histoire naturelle de l’Espagne
et du Portugal, à son retour fut nommé de l’Académie
des sciences, il fut, en 1809, appelé le premier à enseigner
la Zoologie à la Faculté des sciences, enfin il fut nommé
représentant d’Étampes à la Chambre des Cent-Jours.
Après une vie remplie d’actions généreuses et
dévouées, Etienne-Geoffroy-Saint-Hilaire s’éteignit
le 19 juin 1844.
|
|
[036]
|
23 AVRIL 1664.
Le Lieutenant général au bailliage
d’Étampes, conformément à son ordonnance du 19 mars
précédent, se transporta au Couvent des Capucins pour constater
l’état des bâtiments du monastère. Les religieux refusèrent
l’entrée de leur couvent.
|
|
[037]
|
5 FLORÉAL AN II
(24 AVRIL 1794).
Dans la liste des districts, tribunaux, etc., «qui expriment
leurs félicitations à la Convention nationale, sur l’anéantissement
de la conspiration qui a menacé [p. 28] un instant la liberté,»
nous trouvons le tribunal du district d’Étampes.
|
|
[038]
|
MÊME JOUR.
«Une députation de la commune de
Chalo-la-Raison (Chalo-Saint-Mard), district d’Étampes, assure
la Convention nationale de son inviolable attachement, de son dévouement
et de son entière obéissance aux lois, et l’invite à
rester à son poste; elle offre, pour les défenseurs de la
patrie, de nombreux effets d’habillement.»
La Convention admet la députation aux honneurs de la séance.
|
|
[039]
|
25 AVRIL 1684.
Le clergé de la ville d’Étampes
notifie aux religieux Capucins en lad. ville un acte par lequel il déclare
s’opposer à ce que lesd. religieux transfèrent leur couvent
du faubourg Evezard dans l’intérieur de la ville.
|
|
[040]
|
6 MAI 1794.
Etienne-Geoffroy-Saint-Hilaire, à peine
âgé de vingt-un ans, ouvre en France le premier cours de Zoologie,
dans l’une des salles du Muséum du Jardin-des-Plantes.
|
|
[041]
|
7 MAI 1613.
Acte fait devant le Lieutenant général
au Bailliage d’Étampes et le Procureur du roi aud. siège,
par lequel les Maire et Echevins nomment pour Principal du Collège
d’Étampes, en remplacement de Nicolas Charrier, [p. 29] décédé,
Jean Albert, maître ès-arts et licencié.
Par cet acte il fut réglé que:
«Nul maître de pension ne pourroit
dans Estampes y établir maison et y tenir pensionnaires ailleurs
qu’audit collège ou grandes écoles, si ce n’étoit pour
apprendre aux petits eufans l’A, B, C, D et l’escriture.» |
|
[042]
|
15 MAI 1794 (26 FLORÉAL
AN II).
Le Conseil-général de la commune
d’Étampes se plaint à la Convention des abus qui se glissent
dans l’exécution de la loi du maximum. |
|
[043]
|
16 MAI 1804 (26 FLORÉAL
AN XII).
Un rapport de Pioche, ingénieur en chef
des ponts-et-chaussées au département de Seine-et-Oise, constate
que plusieurs parties de la grande route de Paris en Espagne sont dans
un état de dégradation tel qu’il offre des dangers, particulièrement
dans le faubourg de St-Martin de la ville d’Étampes, où une
voiture très-chargée a été brisée et
a tué un enfant de six ans; que ces réparations sont tellement
urgentes pour la sûreté du passage qu’il n’est pas possible
d’attendre pour les effectuer; et il demande au Préfet d’autoriser
de refaire par anticipation dans le faubourg Saint-Martin d’Étampes,
5,935 mètres 80 cent, superficiels de pavage.
|
|
[044]
|
16 MAI 1829.
Les Autorités et les personnes notables
de la ville ouvrent une souscription «afin d’obtenir des secours
[p.30] pour alimenter de pain à a un prix raisonnable les familles
en état de gêne.»
M. Boivin-Chevallier était à la
tête de cette œuvre de bienfaisance.
|
|
[045]
|
LUNDI DE LA PENTECÔTE
1702.
On lit dans le Mercure Galant, de juin
1702, ce qui suit:
«Messieurs les Chevaliers de l’Arquebuze
d’Estampes ayant obtenu de Sa Majesté plusieurs beaux privilèges
qui font la gloire de leur compagnie, par les bontez et les soins de M.
le duc de Vendôme, leur seigneur et protecteur, ont voulu luy donner
des marques sensibles d’une sincère reconnoissance en faisant chanter
le lundi de la Pentecôte, une Messe solennelle dans l’église
de Notre-Dame de la même ville, pour la conservation et santé
de Sa Majesté, et pour la prospérité de ses armées
en Italie dont ce Prince est Généralissime. Toute la compagnie
magnifiquement vêtue et toute en plumets blancs assista à celle
cérémonie, et entra dans l’église au bruit des tambours,
des grosses cloches et des fanfares de l’orgue, et au milieu d’une innombrable
foule de peuples, ensuite de quoy, ils tirèrent le Papegault qui
ne fut abbatu que le lendemain à sept heures du matin, par M. Chaudé,
troisième sergent de la compagnie.»
«On chanta ensuite le Te Deum avec
le psaume Exaudiat, dans la même église.»
|
|
[046]
|
LUNDI DE LA PENTECÔTE
1790.
Première cérémonie de
la Rosière à Étampes.
Les renseignements suivants sont extraits de l’Almanach
[p.31] historique et politique du district et de la ville d’Étampes,
pour l’année 1791:
Dès l’année 1790, il existait dans
notre ville une Société dite philanthropique, composée
d’un certain nombre de personnes bienfaisantes et charitables qui se cotisaient
chaque année pour réunir une somme destinée à
être distribuée en faveur des pauvres les plus vertueux de
la ville, sans distinction de sexe. C’est sur le produit de ces cotisations
qu’il fut prélevé une somme de 4,000 livres pour l’établissement
d’une Rosière. Depuis, madame Delort née Charlotte de Viart,
a, par des dispositions testamentaires très-précises, assuré
l’existence de cette institution, et réglé les conditions
que doit réunir toute jeune fille pour prétendre à
être Rosière.
Il faut être âgée de 22 ans
au moins ou de 40 ans au plus, être pauvre, être née
dans la ville ou y être domiciliée depuis dix ans au moins,
n’avoir donné aucun scandale soit sur les mœurs, soit sur
la religion, l’intention des fondateurs ayant pour but de former de bonnes
mères, qui par leur exemple porteront leurs enfants à la vertu.
Dans chaque paroisse, Messieurs les Curés
et Marguilliers en charge et les Dames de Charité doivent faire ensemble
et à la pluralité des voix le choix de trois filles de leur
paroisse dont ils auront scruté scrupuleusement les mœurs.
Les noms de ces quinze filles avec les notes des motifs de leur choix
sont remis au Secrétaire de la ville.
Un mois après la remise de ces noms, ceux
qui ont droit d’assister aux Assemblées générales
de la Ville, se réunissent pour admettre ou refuser les quinze filles
présentées, par la voix du scrutin et par billets qui ne
contiennent que les seuls mots: admise ou refusée.
L’admission faite, les noms de celles admises
doivent [p.32] être inscrits sur un bulletin séparé pour
chacune; ces bulletins vérifiés et pliés par le Président
sont mis et brouillés dans un vase, il doit en être tiré
un que le Président proclame en déclarant ROSIÈRE
celle dont le nom est porté sur ce bulletin.
Les autres bulletins doivent être brûlés.
C’est aux bienfaits de madame la baronne d’Escars que la ville fut redevable
en |’année1790, de la somme nécessaire pour cette cérémonie.
|
|
|
N
… (1), de la
paroisse de Notre-Dame, ayant réuni par la voix du scrutin les suffrages,
a été choisie comme la fille la plus vertueuse pour obtenir
le prix de la sagesse et a reçu en conséquence le trousseau
qui lui était destiné.
Cette cérémonie a été
annoncée la veille par une salve de boîtes: le jour même,
la Rosière, vêtue de blanc et tenue d’une main par madame
d’Escars et de l’autre par M. Picart, ancien maire de la ville, a parcouru
la ville, au milieu de la garde nationale sous les armes, au bruit des tambours
et de la musique, pour se rendre à l’église de Saint-Basile.
M. le Curé de cette église, revêtu d’une chappe et accompagné
de son clergé, l’a reçue à la grille principale du
chœur, où, après un petit discours apostolique, il a célébré
une Messe solennelle. Après l’Evangile, un chanoine régulier
trinitaire a prononcé un discours.
Un carreau avait été dressé
pour la Rosière au milieu du chœur; à côté
d’elle était madame d’Escars et de l’autre M. Picart. Le reste
du chœur était occupé par les membres de la Société
philanthropique. Une haie de gardes nationaux en grande tenue et des ci-devant
arquebusiers bordaient le chœur et la nef jusqu’au bas de l’église.
La quête a été faite par mademoiselle
de la Borde, [p. 33] de Méréville, conduite par M. le comte de Noailles,
son époux; elle était suivie d’une seconde quêteuse,
mademoiselle de Poilloüe de Bonnevaux, conduite par M. le comte de
l’Aigle.
Après la Messe, la Rosière a été
conduite dans le même ordre à un dîner qui lui était
préparé.
Le soir on a dansé à l’Arquebuse.
|
(1)
Notre almanach a laissé en blanc le nom de la Rosière.
|
[047]
|
17 MAI 1794 (28 FLOREAL
AN II).
L’Agent national près le district d’Étampes,
annonce la plus grande activité dans l’exploitation du salpêtre.
|
|
[048]
|
21 MAI 1549.
Par lettres patentes de ce jour, Henri II, roi
de France, autorise l’établissement à Étampes d’une
compagnie de l’arquebuse.
Ces lettres furent successivement confirmées
par Henri IV, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV.
La compagnie de l’arquebuse d’Étampes était
une des plus nombreuses de France; elle avait pour dicton: les Écrevisses;
et pour devise les quatre vers suivants qui se chantaient sur l’air: Ne
v’la-t-il pas que j’aime?
Nous n’allons point à
reculons
Comme les Écrevisses;
Vaincre et mourir pour les Bourbons,
Voilà tous nos délices.
Le 15 août 1790, la compagnie
de l’arquebuse d’Étampes se réunit en corps pour la dernière
fois pour assister à la procession en mémoire du vœu de Louis
XIII.
Après la cérémonie, les officiers
de l’arquebuse firent [p.34] la remise de leurs drapeaux qui furent immédiatement suspendus
à la voûte de l’église Notre-Dame.
|
|
[049]
|
30 MAI 1842.
Rose Chéri dont le véritable nom
était Rose-Marie Cizos, née à Étampes, au mois
d’octobre 1824, débute au Gymnase-Dramatique dans Estelle
ou le Père et la Fille, de Scribe.
Eugène de Mirecourt, raconte ainsi ces
premiers débuts dans la notice qu’il a consacrée à
notre artiste:
«Il est rare que la fortune se laisse enlever
du premier coup ses faveurs. Timide, modeste, assez pauvrement vêtue,
Rose ne produisit aucun enthousiasme sur le parterre. Deux artistes en
vogue, mademoiselle Nathalie et madame Volnys, aimées des spectateurs
du Gymnase leur imposaient alors un goût exceptionnel. Au théâtre
on ne l’ignore pas, le succès ne relève jamais de lois fixes.
L’engouement et la mode y établissent presque toujours leur empire.
Bien que douée d’une intelligence véritable et d’une
grande pureté de diction, Rose ne fut pas appréciée
à sa valeur. On eût voulu sans doute plus de brillant et moins
de solide. Le nom de la débutante disparut de l’affiche, après
y avoir figuré seulement deux fois. Elle était remerciée.»
Après avoir inutilement frappé à
la porte du Vaudeville, Rose était parvenue à obtenir au
Gymnase un engagement d’un an, aux modestes honoraires de soixante-quinze
francs par mois; elle devait jouer ce qu’on nomme en argot de coulisses les
en cas. Elle attendait qu’une circonstance favorable
vînt la mettre en relief, et se préparait à rendre à
l’administration tous les services dont elle était capable, en étudiant
en double les [p. 35] rôles des pièces nouvelles. Six semaines après,
cette circonstance se présenta.
Dans un de ses derniers numéros, Paris-Journal
raconte les seconds débuts de la jeune artiste au Gymnase:
Personne ne voulait lui confier un rôle,
lorsqu’un soir mademoiselle Nathalie, qui jouait alors dans Une jeunesse
orageuse, de MM. Charles Desnoyer et Emile Pages, fit dire au dernier
moment qu’elle était indisposée.
Il était trop tard pour changer le spectacle.
Que faire? Monval, le régisseur, pense à la petite Rose et
l’envoie chercher.
— Savez-vous le rôle d’Henriette? lui demande-t-il.
— Oui, répond la jeune fille.
— Eh bien, habillez-vous et dépêchez-vous
de descendre en scène; vous le jouerez dans dix minutes.
Pendant ce temps, la salle s’impatientait.
Monval paraît et annonce au public l’indisposition
subite de mademoiselle Nathalie et son remplacement par une débutante.
Puis, le rideau se relève au milieu de
protestations presque unanimes, et la pièce commence.
Deux minutes ne s’étaient pas écoulées,
que le tapage avait complètement cessé. La douce voix de
Rose, son maintien, sa distinction avaient conquis le public. Un murmure
d’approbation court dans la salle, et bientôt des applaudissements
se font entendre. Excitée par ce bon accueil, Rose s’anime et déploie
ses moyens. Tout à fait rendue à elle-même par la bienveillance
de la salle, elle tire de certains mots et de certaines situations des effets
complètement inattendus. L’actrice de talent se révèle.
Un enthousiasme unanime éclate, et, quand le rideau tombe sur la
dernière scène, les spectateurs se livrent à un tapage
aussi complet que celui [p.36] qui a procédé l’annonce de Monval; mais ce n’est
plus, cette fois, Nathalie qu’on réclame.
— Henriette! Henriette!
— La débutante!
— Son nom! dites-nous son nom!
— Vite, chère enfant, dit le régisseur
derrière la toile: comment vous appelez-vous?
— Rose Cizos.
— Cizos! ce n’est pas un nom. Je n’annoncerai
jamais Cizos. Trouvons autre chose et dépêchons-nous. On
casse les banquettes.
— En province, mon père se faisait appeler
Chéri.
— A la bonne heure, j’aime mieux cela; superbe!
superbe!
Et Monval court jeter au public ce nom gracieux
de Rose Chéri, que tant de succés devaient plus tard rendre
célèbre.
|
|
[050]
|
MAI ET JUIN l566.
Processions pour obtenir
de la pluie.
«Ne fault laisser à dire le debvoir
que le dévost peuple chrestien et catholique feit en ce pays de
France de prier Dieu par dévostes prières et grandes processions,
tant en une province qu’en l’aultre, pour demander à Dieu sa miséricorde
et de l’eau sur la terre; et commença-on dès la my-may,
en continuant jusques au jour de la Feste-Dieu, que le bon Seigneur envoya
de la pluye assez compétamment, dont en plusieurs lieux fut chanté
le Te Deum laudamus. Les villages de 7 et 8 lieues de Paris alloient
en procession audit Paris en l’église de madame S’e Geneviefve.
Ceux de ladite ville souvent faisoient procession généralle
d’une église à l’aultre. Ceux de la ville et villages de Melun
alloient [p.37] en procession en la ville de Corbeil, au corps sainct de mons.
St Spire. Ceux du Gastinois et pays de Beauce alloient à Estampes
de 5 et 6 lieues à l’entour, en l’honneur des corps saincts messieurs
Sts Cantien et Cancianille; ceux de Champagne, les ungs alloient a Troyes,
aux vierges Ste Marie et Ste Hélène; aultres alloient à
madame Ste Syre; aultres à Nogent-sur-Seine, à la Belle-Dame.
(Mémoires
de Claude Haton.)
|
|
[051]
|
1er JUIN 1736.
On enlève pendant la nuit huit religieuses
d’Étampes, au diocèse de Sens, et elles sont conduites par
le Prévôt de la maréchaussée, Janelle, chez
les religieuses de Saint-Charles d’Orléans. Leur crime est d’avoir
refusé de reconnaître pour supérieure, celle que M.
de Sens avait fait élire contre les règles.
(Le Calendrier ecclésiastique pour
l’année 1742. Utrecht, aux dépens de la Compagnie, 1742,
in-32. Almanach janséniste.)
Les sœurs conduites à Orléans se
nommaient: Boirvaux de Saint-Basile, Boirvaux de Saint-Augustin, Descoutures,
Panet, Devidal, Boudon, Pichonnat et Rioux. (Nouvelles ecclésiastiques.)
|
|
[052]
|
JUIN 1686.
Le Père Dominique Gavinet est nommé Procureur du Collège
d’Étampes. Il exerça ces fonctions pendant trente-sept ans
de suite, phénomène qui ne s’est peut-être jamais vu
ailleurs, dit le Chroniqueur auquel nous empruntons ce renseignement. Dans
ce long espace de [p.38] temps, il cumula quatre
fois avec l’emploi d’économe les fonctions de Supérieur; de
1701 à 1707 d’abord, et ensuite de 1716 à 1722.
Le Père Gavinet était de Montargis, il cessa d’être
Procureur le 22 mai 1723, probablement â l’époque de sa mort.
|
|
[053]
|
5 JUIN 1792.
Palloy (1) adresse a Gorsas (2), rédacteur du
Courrier des départements et député
de Seine-et-Oise à la Convention, la lettre suivante, pour rendre
compte de ce qu’il a fait à l’occasion de la fête de la Loi.
Nous reproduisons cette lettre avec son orthographe:
«Mon amis je vous envoyent le détaille
du cortège de la Bastille, jai fait un repossoir tous en feuillage
est j’ait mit Labastille. du département qui y a passé la
nuit, je les gardé, avec des amis de la liberté pour l’inscription
des droits de l’homme qui avoit été obmis dans la marche,
à chaque arbre étoit une statue, qui représentois;
l’union, légalité, la vertu, la prudence, la justice, l’abondance,
a l’entré, il y avoit le drapeau tricolore, des pique et le bonnet
de la liberté, maintenu par trois statu, la liberté, la force,
la victoire. [p.39]
Voici ce qui étoit écrit au dessus
de la porte, n° 1, n° 2 et le discour que j’ai prononcé n°
3 et ce qui est inscrit sur la pierre de la Bastille que j’ai présenté
à la famille SIMONEAU.
J’aurai beaucoup de plaisir si Gorsa fait mention
de cella, ainsi ji conte.
Cest de la part de cellui qui embrasse Madame
et Mademoiselle et qui est bien leur sincère ami.
Signé: PALLOY patriote.
J’oubliai de dire que ji ai planté un mas
de 96 pied de haut, avec le bonnet de la liberté dans le millieu
des Rhuines de la Bastille et que je le laissé jusqu’au moment ou la
collonne sera élevée.
J’observe à Gorsas que jai fait le tout
gratis et qu’il est essentiel qu’il parle fort du monument.»
|
(1)
Maçon qui avait démoli la Bastille et qui eût de même
démoli les Tuileries si on l’avait laissé faire. Ce fut ce
même Palloy qui se chargea de disposer dans la tour du Temple le
logement de la Famille Royale. Il fit abattre tous les bâtiments qui
entouraient l’édifice, exhausser le mur d’enceinte, et boucher toutes
les fenêtres ouvrant sur l’enclos du Temple.
(2) Gorsas, était
en 1788 a la tête d’un pensionnat à Versailles, et fut à
celle époque enfermé à Bicêtre, comme accusé
d’avoir corrompu les mœurs de ses élèves. Irrité des
rigueurs dont il avait été l’objet, Gorsas manifesta une
grande exaltation dès les premiers jours de la Révolulion;
il fut l’un des plus ardents provocateurs des journées du 20 juin
et du 10 août 1792, et fut l’un des chefs des colonnes qui assiégèrent
le château de Versailles et massacrèrent les gardes du corps.
|
[054]
|
13 JUIN 1792.
Les Administrateurs du Directoire du district
d’Étampes, adressent les observations suivantes aux Administrateurs
du département de Seine-et-Oise:
«Depuis plus de trois mois il a été
présenté au Directoire des Mémoires tendans à
faire des réparations de tous genres, tant aux presbitères
des curés, qu’aux murs de clôture de leurs jardins.
«M. Gosser, ingénieur, représente
qu’il ne lui est pas possible de se transporter dans les paroisses pour
dresser les devis et estimations, dont partie ne présente pas assez
d’importance pour exiger son transport qui le distrairait d’ouvrages plus
utiles et plus liés à l’intérêt public.
«Cette difficulté met des entraves
nuisibles à la chose publique, parce que les réparations
s’aggravent et elle donne [p. 40] lieu à diverses questions sur lesquelles vous êtes
priés de statuer.
«I. Est-il du devoir de l’ingénieur
de faire ces devis, comme compris dans son traitement?
«II. En cas de négative, qui des
Municipalités des lieux, ou du Directoire, ou du réclamant
doit faire choix de l’expert?
«III. Si le Mémoire tendant à
obtenir des réparations certifié par la Municipalité,
et accompagné d’un devis signé d’un ouvrier, suffit pour
être soumis à l’avis du Directoire et avoir votre authorisation?
«IV. Si ces actes doivent être sur
papier timbré, ou seulement la délibération deffinitive?
«V. Qui doit payer les experts?
«VI. Quel sera le mode du payement?
«Pour qu’il soit correspondant à
l’ouvrage, sera-t-il à raison de l’adjudication et à quel
fur?
«Ou par aproximation de journées?
«VII. Ce salaire sera-t-il charge de l’adjudication?
«VIII. Enfin dans les réparations
qui doivent être à la charge des propriétaires et paroissiens,
celles usufruitières, y seront-elles comprises?
«Ou ne seront-elles pas supportées
par les curés?»
Ces questions sont signées: Préaux,
Bonneau, Le Camus, Grosnier, secrétaire.
|
|
[055]
|
14 JUIN 1674.
Mort à Paris de Marin Le Roi de Gomberville,
l’un des beaux esprits de son temps, choisis par le cardinal de Richelieu
pour former l’Académie française.
Les biographes le font naître les uns à
Paris, d’autres à Étampes, d’autres enfin à Chevreuse:
l’Abeille [p. 41] d’Étampes, dans un article inséré
au numéro du 23 septembre 1871, a établi d’après la
légende latine qui se lit au bas d’un portrait de Gomberville se
trouvant en tête d’un de ses ouvrages, que ce personnage doit être
né à Gomberville, écart de Chevreuse.
L’indication de ce document a soulevé la
bile de l’auteur de l’Essai de Bibliographie étampoise*, qui prétend que
les mots: Thalassius Basilides à Gombervillâ, qui se
lisent au bas du portrait en question, n’indiquent nullement l’extraction,
mais le rapport seigneurial de l’homme avec sa terre.» «Prétendre
que le rapport de seigneurie s’exprimait par le génitif Gombervillæ,
c’est tout simplement alléguer un solécisme.»
|
* Il s’agit de
Paul Pinson, à qui l’Abeille faisait la guerre, estimant sans raison
bien claire avoir été maltraité par cette publication
(B.G., 2012).
|
|
N’en
déplaise au Bibliographe étampois, Dominus Gombervilliæ,
loin d’être un solécisme serait conforme à l’une
des règles les plus élémentaires de la Grammaire
latine, en effet, selon L’Homond:
«Pour joindre ensemble deux noms en français
nous mettons de entre les deux; le Livre de Pierre, le Maître
de la maison, en latin on met le second au génitif, Liber
Petri, Dominus convivii.» Mais ce dont nous
avons lieu de nous étonner, c’est de lire dans cette brochure que
la préposition a indique le rapport seigneurial de l’homme avec sa
terre. «La préposition a, dit Quicherat,
signifie de (désignant la «patrie).»
En latin, celle préposition indique l’éloignement, et nous
ne voyons pas comment une semblable particule pourrait désigner
des droits de puissance seigneuriale, nous avons vainement cherché
dans les auteurs latins de l’ère nouvelle, des exemples où
la préposition a eût une semblable signification et nous n’avons
rien trouvé indiquant son emploi dans ce sens; nous avons vu ce qui
est encore conforme à la grammaire, que souvent au lieu du génitif
on se sert d’un adjectif qui a la même valeur. [p.42]
Enfin, voici un passage extrait de l’ouvrage
d’un jurisconsulte célèbre, Charles Loyseau (Traité
des ordres et simples dignitez, chap. XI, art. 59), qui nous paraît
justifier complètement notre opinion:
«Il y a un peu plus d’excuse en la vanité
de nos modernes traîneurs d’espée, qui n’ayant point
de seigneurie dont ils puissent prendre le nom, ajoutent seulement un de
ou un du devant celuy de leurs pères: ce qui se fait en guise de seigneurie,
car c’est pour faire un génitif possessif au lieu du nominatif:
ainsi que les Italiens nous font bien connoistre et pareillement les Gascons,
ès-noms des gens de lettres qu’ils terminent communément
en i, les mettant au génitif latin, comme
par exemple, on appeloit de mon temps à Tholose ce docte président
du Faur qui a si bien écrit, le président Fabri. Or,
comme Fabri en latin, aussi du Faur en français est
un génitif, et quand on dit Pierre du Faur, il faut sous-entendre
par nécessité le nom de seigneur, ou quelqu’autre qui se puisse
lier à ce génitif, comme quand en latin on dit Petrus
Fabri, il faut suppléer ce mot Dominus; autrement ce seroit
une incongruité contre cette règle de Grammaire, qu’on appelle
la règle d’apposition.»
Si Gomberville était d’Étampes,
il est probable qu’il se nommait tout simplement Marin, nom que portent
encore plusieurs familles à Étampes et dans les environs.
Gomberville était un bel esprit, il était
l’un des habitués de l’hôtel de Rambouillet, dans la Société
des Précieuses il portait le nom de Gobrias; dans beaucoup de ses
ouvrages il semble vouloir mystifier ses lecteurs, ce Roman de Polexandre
qui à chaque édition changeait de personnages, de scène
et de sujets, n’a-t-il pas l’air d’une mystification?
Gomberville a publié un certain nombre
d’ouvrages [p.43] sous le nom d’Orile, anagramme de Le Roi; on peut voir
beaucoup d’ouvrages signés de ce nom à la Bibliothèque
de l’Arsenal. Combien de noms sous lesquels il se déguisait sont
peut-être inconnus, et échapperont à la sagacité
des critiques!
|
|
[056]
|
23 JUIN 1821.
Première représentation à
Paris sur le Théâtre du Gymnase du Comédien d’Étampes,
comédie en un acte, mêlée de couplets par Moreau
et Sewrin.
L’action se passe à trois lieues d’Étampes
dans une maison de campagne appelée Champigny, située sur
la grande route. Cette pièce a été composée
pour procurer à Perlet, qui remplissait le rôle du Comédien
d’Étampes, le moyen de montrer la facilité avec laquelle
il changeait de physionomie et presque de figure aux yeux mêmes du
spectateur. Ainsi, il arrivait avec la figure et les manières d’un
jeune homme et devenait vieux à l’instant même et sans quitter
la scène, en posant sur sa tête une perruque de vieillard.
Quelques instants après il empruntait le costume du jardinier de la
maison et sous ses traits il faisait au bel esprit d’Étampes, au prétentieux
Maclou de Beaubuisson, sur ses fredaines de jeunesse, des révélations
auxquelles il ne s’attendait guère dans la maison où il venait
chercher une femme.
Dans la même pièce encore, Perlet
paraissait sous les traits et les vêtements d’une riche anglaise,
et imitant l’accent étranger avec une perfection de vérité
â laquelle nos voisins d’outre-mer eux-mêmes applaudissaient,
il entreprenait de nouveau le fat Beaubuisson et à l’aide d’une supercherie
le faisait renoncer à ses vues sur Mlle Corbin.
Le Comédien d’Étampes est
une pièce à tiroirs; c’est [p. 44] surtout une amusante bouffonnerie
qui n’a de rapports avec Étampes que par le lieu où l’action
se passe, et par quelques personnages qui sont d’Étampes comme ils
pourraient être de tout autre pays.
|
|
[057]
|
24 JUIN 1562.
Dérangement des
saisons. — Grande mortalité.
«Advint que, le jour de la teste de mons.
sainct Jehan-Baptiste, qui est au 24e jour de juing, il plut et neigea
tout ensemble pluie et neige si froides que les mieux vestus ne pouvoient
durer de froict par les rues et hors des maisons; et fut contrainct tout
ce jour de faire feu pour se chauffer es maisons qui ne voulut endurer
beaucoup de froict. Cela fut cause de faire couler les vignes, qu’il ne
demeura pas une tierce partie. Les bleds pareillement en ceste année
coulèrent, pour lesdittes pluies froides qu’il fit au temps de la
fleur. Toutesfois, il fut des grains assez compétamment, mais furent
germez aux champs et gastez an temps îles moissons, de sorte qu’ilz
ne rendirent à farine comme par beau temps. Les saisons de l’année
se trouvèrent toutes changées en ceste présente. Le
beau temps du printemps se trouva estre en yver, au printemps l’esté,
en esté l’automne et en automne l’yver. Toutesfois, quasi toute l’année,
les eaues furent grandes et dérivées; elles furent plus grandes
l’esté que l’yver, et recueillit-on sur la prairie de la rivière
de Seine du foin assez, quand on put le saulver et fanner. Et advint le
tout en punition de Dieu, pour l’orgueil et péchez, qui de longtemps
régnoient en France, et ne se voulurent amender les mondains du
royaume, tant des villes que des villages, pour prédications et remonstrances
que leur faisoient les prédicateurs et curez, et se vouloit chascun
estat [p. 45] excuser sur ung aultre. Le commung peuple, comme aussi plusieurs
aultres qui présumoient d’eux-mesmes, rejectèrent les maux
causés par le renversement des saisons de l’année et par le
meschant recueil que l’on fit de vins et d’aultres biens, sur ceste nouvelle
gabelle d’entrée de vins et vendanges ès villes, et bailla-on
plusieurs malédictions au roy et à la royne, sa mère,
et à leur conseil, qui avoient mis en avant ceste nouvelle imposition.
«L’éternel Dieu omnipotent, voulant
démonstrer à la Franco l’yre de son courroux, oultre les
guerres qu’avons dict ci-dessus, le renversement des saisons de l’année,
la diminution des biens de la terre, qui fut ung présage de cherté,
permist régner encores ung aultre fléau, qui fut la mortalité
qui advint quasi en toutes les villes de France, par maladie pestilencieuse
et contagieuse; qui fut cause de les despeupler et de grandement diminuer
le nombre des habitans desdittes villes, et nommément en celle de
Paris, où laditte maladie eut cours plus d’un an entier, et rapporta-on
qu’en laditte ville de Paris y en morut plus de vingt-cinq milles.
«Les villes où laditte. maladie contagieuse
eut cours furent Paris, Pontoise, Gisors, Rouen, Beauvais, Meaux, Compiengne,
La Ferté-soubz-Jouarre, Chasteau-Thierry, Soissons, Reims et Chaslons
en Champaigne, Troyes, Ch.aslillon sur-Seine, Langres, Dijon, Tournu, Chaslons-sur-la-Saône,
Beaune, Mascon, Lyon, La Charité, Bourges en Berry, Gien, Auxerre,
Sens, Bray-sur-Seine, Melun, Corbeil, Estampes, Orléans, Tours,
Vendosme, Potiers, La Rochelle, Molins en Bourbonnais, Sancerre, Vezelay
et Montargis, et ainsi quasi toutes les aultres villes de France. Provins
fust pour ceste année exempté de ceste maladie contagieuse,
mais en avoit esté ung peu agité l’an dernier passé,
ainsi que nous l’avons dict, et estoit une chose fort dangereuse que d’aller
par les champs, et avoit-on milles peines de [p.46] trouver logis par
les villages et les villes mesmes dans lesquellesavoit cours ceste maladie,
qui dura jusques
après la Sainct-Remy de ceste année.»
(Mémoires de
Claude Hatton, t. Ier, p. 331.)
|
|
[058]
|
JUILLET 1789.
Jean-François Perrier, curé
de Saint-Pierre d’Étampes, né le 18 septembre 1740, à
Étampes selon les uns, à Grenoble selon d’autres;
Jacques-Auguste de Poillowe, marquis de
Saint-Mars;
Dom Alexis Davoust, bénédictin,
prieur de l’abbaye de Saint-Ouen de Rouen, né à Étampes
en 1727;
François-Louis-Joseph de Laborde-Méréville,
garde du trésor royal;
Sont admis à l’Assemblée nationale,
comme députés:
L’abbé Perrier, du clergé du
bailliage d’Étampes;
Le marquis de Saint-Mars, de la noblesse;
Dom Davoust, du clergé du baillage
de Rouen;
Et Laborde-Méréville, du
tiers-état du bailliage d’Étampes.
L’abbé Perrier prêta le serment
ecclésiastique le 4 janvier 1791, fut nommé évêque
constitutionnel de Vaucluse, la même année; démissionnaire
en 1801, il fut nommé de nouveau en 1802, résigna ses pouvoirs
en 1819, fut nommé chanoine de Saint-Denis en 1820, et mourut à
Avignon, le 30 mars 1824.
Laborde-Méréville mourut
à Londres 1801.
|
|
[059]
|
6 JUILLET 1751.
Jean de Selve, chevalier, seigneur de Cerny,
haut châtelain de Villiers, seigneur de Tanqueux, de Boissy [p.47] et Cuti-Chaudevaux,
du fief de péage de La Ferté-Aleps, etc., mourut dans son
château de Villiers, province de Hurepoix, à 73 ans; il était
fils aîné de Jean-Baptiste de Selve, seigneur des mêmes
lieux, et de dame Marie-Thérèse Moret, son épouse.
|
|
[060]
|
16 JUILLET 1793.
«Des députés de la
commune d’Estréchy sont admis dans l’intérieur de la salle
pour présenter l’acceptation de la Constitution par les citoyens
de cette commune. Le président rend justice au patriotisme des citoyens
de la commune d’Estréchy et invite les députés il assister
à la séance.»
(Procès-verbaux
de la Convention, 16e volume.)
|
|
[061]
|
JUILLET 1740.
On découvre à Étampes
le corps de M. Nicolas Glasson, vicaire de la paroisse de Saint-Germain
(aujourd’hui Morigny), et enterré depuis 102 ans; on le trouva sans
aucune corruption aussi bien que la bière et le suaire, quoique
les autres corps inhumés à côté de lui soient
consumés. Il était mort le 11 mai 1637, âgé
de 35 ans, qu’il avait passés dans une grande pénitence.
Mgr l’archevêque de Sens instruit de cet événement
permet un culte particulier, et l’on parle de quelques miracles que ce
prélat est disposé à croire, sans épuiser tous
les doutes de l’incrédulité.
(Extrait
du Calendrier ecclésiastique pour l’année 1742. A
Utrecht, 1742, in-32. Almanach janséniste.)
De nos jours encore, les bonnes femmes
de Morigny et des environs, vénèrent la mémoire de
saint Nicolas Glasson, auquel elles attribuent de don de pouvoir faire
[p.48] marcher les petits enfants. Pour intercéder saint Nicolas
Glasson, la tradition veut que l’enfant et ses parents assistent trois
fois à la messe dans l’église de Morigny et un jeudi, et
que, pendant l’office, on dépose les petits enfants sur une pierre
tombale qui se trouve dans cette église derrière le ban
d’œuvre et que la croyance populaire considère comme couvrant le
corps de Nicolas Glasson.
D’après la source à laquelle nous
avons puisé notre citation, la sainteté de Nicolas Glasson
doit être suspecte aux catholiques; ajoutons aussi que la tombe vénérée
n’est pas celle de Nicolas Glasson, mais celle d un membre de la
famille de Viard, et enfin que Nicolas Glasson qui était vicaire
de Saint-Germain, a dû être inhumé dans son église
dont l’emplacement fait aujourd’hui partie du cimetière de Morigny.
|
|
[062]
|
20 JUILLET 1740.
L’abbé Arnaud, prédicateur, est
envoyé par Mgr Languet, archevêque de Sens, aux religieuses
de la Congrégation de N.-D. d’Étampes, pour convertir au
nouveau catéchisme les religieuses insoumises. La retraite de ce
prédicateur dura huit jours.
|
|
[063]
|
2 THERMIDOR AN III (20
JUILLET 1795).
La Convention renvoie:
Au Comité des Finances, un ouvrage du citoyen
Prunelé, transmis par le district d’Étampes, sur l’extinction
des assignats;
Au Comité de Législation; des observations
du citoyen [p. 49] Gillot, de la commune d’Étampes, sur le rapport du 23 fructidor
concernant le Code civil.
(Procès-verbaux
de la Convention, vol. 66.)
|
|
[064]
|
21 JUILLET 1562.
Un arrêt du Parlement de Paris enjoint au
Bailly d’Estampes de surseoir l’exécution des lettres à
lui adressées par le Roy, au sujet des Rebelles jusqu’à
ce qu’il en ait été parlé au Roy de Navarre.
(Mémoires de Condé,
t. III, p. 555.)
Au nombre des Rebelles étaient:
… Cassegrain, lieutenant général
d’Étampes:
Et maîstre Pierre Le Conte,
advocat audit Estampes.
Par arrêt du Parlement de Paris,
du 21 novembre 1562, Cassegrain a été condamné à
«estre pendu et estranglé à potences
croisées, qui seront mises et plantées en la place des Halles
de cette ville de Paris.»
(Même ouvrage,
t. IV, p. 94 et 142.)
|
|
[065]
|
26 JUILLET 1467.
Passage à Étampes du Roi Louis XI.
(Pièces fugitives pour servir à l’histoire de France,
par le marquis d’Aubais, t. 1er, p. 96.)
|
|
[066]
|
28 JUILLET 1817.
Le maréchal de camp, aide-de-camp du prince
de Condé, commandant le département de Seine-et-Oise informe
M. de la Boulinière, sous-préfet d’Étampes, que:
[p.50]
«La plus grande tranquillité régnant
dans l’arrondissement, la mendicité de nuit ayant cessé,
celle de jour se trouvant restreinte aux enfants et aux non valides, le
Ministre de la Guerre a prescrit de rappeler à son corps le détachement
de grenadiers à cheval de la Garde royale stationné à
Étampes, Milly et Angerville.
«Il est nécessaire, dit-il en terminant,
que les gardes nationales et la gendarmerie reprennent toute leur action
sur la police du pays, afin de prévenir le retour du vagabondage
qui vient d’être dissipé et qui cherchera sûrement à
se renouveler au commencement de l’automne prochain.»
|
|
[067]
|
29 JUILLET 1625.
Un orage épouvantable
éclate à Étampes. — La foudre tombe sur l’église
Saint-Basile.
Nous reproduisons ici le seul récit qui
existe à notre connaissance de ce terrible événement.
Il est extrait d’un petit volume excessivement rare dont la Bibliothèque
Mazarine possède un exemplaire. (N° 21450).
Voici le titre et la description de ce petit volume:
OPUSCULES CHRESTIENNES contenant l’éloge
des trois Martyrs, ensemble quelques élégies et stances sur
divers sujets.
A Paris, par Rob. Sara, rue de la Harpe, au Bras
d’Hercule. MDCL.
Avec privilège et approbation.
Le privilège du Roy, du 11 mars 1650, nous
fait connaître que ce volume de format, petit in-8°, est de
Jean Chauvuin [sic].
Ce volume comprend, outre le titre rapporte plus
haut:
Un avant-propos en quatre pages non numérotées;
Le privilège du Roy;
Et quatre-vlngt-quatorze pages donnant:
Pages 1 à 31: Éloge en français
des saints Martyrs divisé en cinq parties; [p.51]
Pages 31à 51 inclus: Prevves et
éclaicissemens tirez de divers autheurs tant anciens que modernes,
sur le sujet des bienheureux Martyrs;
Pages 86 à 87: Élégies
et stances sur divers sujets, élégie sur l’orage de l’an
1625, précédée d’une remarque sur cette tempête,
et portant en sous-titre: Les habitans d’Estampes se plaignent d’un accident
si funeste;
Enfin, pages 91 à 94: Hymne des
Martyrs, en vers français.
Ce petit volume est indiqué dans l’Essai
de Bibliographie étampoise sous le n° 101; l’auteur de cette
bibliographie annonce que cet ouvrage ne nous apprend rien de nouveau;
cependant l’extrait suivant que nous en donnons, nous donne la relation
d’un événement ignoré jusqu’ici, et sur lequel nous
avons vainement cherché ailleurs des renseignements.
Remarque sur la pièce
suivante.
L’autheur de tout, qui est Dieu, n’est pas moins
redoutable par ses foudres, qu’aimable par ses graces. Il scait que la
trop grande confiance en sa miséricorde est le sommeil des pécheurs;
que c’est par là qu’ils tombent dans une funeste léthargie,
et que pour les provoquer au réveil, il est nécessaire de
faire éclater sa justice. Si les anges battent des ailes par un respectueux
mouvement et s’ils tremblent dans un lieu d’assurance que feront ceux qui
sont au milieu, des écueils et des precipices? Entre les histoires
lamentables de nos jours on peut compter la tempeste arrivée à
Estampes, le vingt neufiesme de juillet, mil six cens vingt cinq. Ce fut
un accident des plus remarquables de ce lieu et peut-estre le plus rude
choc dont les nues soient capables. Bien que l’air eust été
calme tonte la journée il y eut tant de changement sur le soir, que
la seule pensée est capable de donner de la crainte. En effet la tempeste
fut si forte, qu’il s’en void peu de semblables; et l’on peut dire qu’elle
eut du rapport à la dernière, mais
[p. 52] véritable
tragédie du monde, qui est la venue du grand jugement.
Quelques personnes m’ayant invité de donner
cette pièce au public; et m’en ayant plusieurs fois réitéré
leur prière, j’ay creu que je pouvois contenter leur souhait; et
qu’il y avoit moins de retenüe à cacher mon travail, que de
resistence à rendre celle prière inutile.
ÉLÉGIE SUR L’ORAGE
DE 1625.
Les habitans d’Estampes
se plaignent d’un accident si funeste.
Un secret mouvement nous contraint
de décrire,
Ce qu’on ne peut sans trouble, et sans crainte redire,
La nuit, l’affreuse nuit qui tomba sur nos yeux,
Quand le bruit du tonnerre éclata dans ces lieux.
C’estoit lorsque le ciel favorable à nos plaines,
Rompoit de l’aquilon les plus fières haleines,
Et que l’onde changeant sa première froideur,
S’échauffoit aux rayons qui faisoient notre ardeur;
Que la faux occupée à lentour des rivages
Abatoit dans les prez la hauteur des herbages,
Et que les laboureurs dans les champs assemblez,
Preparoient leur attente à la coupe des blez,
Mesurant de leurs yeux la grandeur des richesses,
Dont les astres benins leur faisoient des largesses.
Le calme estoit partout, et les petits zephyrs
A peine osoient lascher leurs plus foibles souspirs;
Lors qu’en moins d’un moment la céleste lumière
Se derobe aux regards de l’humaine paupière.
Les tenebres dans l’air entendent la noirceur,
Qui couvre nos vallons d’une sombre espaisseur.
Un bruit sourd et confus fait là haut des ravages,
Et donne place au feu pour sortir des nuages.
Les vents les plus mutins soufflent de tous costez,
Qui font que les mortels ne sont plus escoutez; [p. 53]
Que la parole meurt en sortant de leur bouche;
Et qu’ils plaignent déjà l’accident qui les touche.
Le soleil effrayé se cache dans la nuit,
Et s’il reste du jour, c’est l’éclair qui nous luit.
Le ciel lasche la bride à toutes les furies:
Il pleut dans les marets, il noircit les prairies,
Il remplit les chemins, il abat les sillons,
Et fait en mille endroits élever des bouillons.
Les ravines d’en haut à mesme heure descendent;
Et les ruisseaux enflez dans la Juine se rendent:
On ne distingue plus les chanvres des roseaux,
Et les joncs, et les blez sont noyez dans les eaux.
O Dieu, de qui la main est maistresse du foudre,
Qui peux, quand il te plaist, réduire tout en poudre,
Et faire des péchez un juste chastiment,
Qui pourroit résister à ton embrasement?
L’homme n’est devant toy qu’une paille chetive,
Et que l’image vain d’une ombre fugitive,
Indigne de porter la fureur de tes coups;
Et cependant, ô Dieu, tu t’armes contre nous!
Tu fais tomber d’en haut ta colere allumée,
Et par toi nostre vie est réduite en fumée!
La terre sur son poids ne se peut arrester,
Et l’orage est si fort qu’on ne peut résister.
Il n’est point de muraille, il n’est point d’édifice,
Qui ne semble pancher au bord du précipice,
Et croit-on que l’ardeur des foudres allumez
Doive rendre à l’instant tous les corps consumez.
Entre les sacrez lieux qu’honore nostre ville,
Est un temple conu sous le nom de Basile;
Au travers du clocher les flammes s’élançoient,
Et la foudre et la mort dans les voûtes passoient.
Les yeux en regardant devenoient insensibles
Pour avoir devant eux des objets trop visibles;
Un murmure plaintif s’élevoit là dedans, [p. 54]
Où l’on ne sentoit plus que des soufres ardens;
Les feux, la nuit, les eaux se trouvoient pesle mesle
Et partout resonnoit la tempeste et la gresle.
Un de nos habitans s’estoit mis à genoux
Pour tascher d’amollir le céleste courroux:
De souspirs redoublez il prioit saint Basile,
Afin que dans son temple il trouvast son asyle,
Que l’orage cessant, cessast aussi la peur,
Et que le tout enfin fust réduit en vapeur.
Mais pour mesler sa voix parmy d’autres semblables,
Pour élever en l’air des accens pitoyables,
Et remplir de sanglots les voûtes de ce lieu,
Il n’eut pas le bonheur d’estre écouté de Dieu.
Il receut de la mort une atteinte subtile,
Qui rendit sa parole et sa voix inutile.
Un autre dont le poil esloit à demy blanc
Dedans ce mesme lieu fut couché sur le flanc;
Esprouva la rigueur d’un si grand orage,
Qui lui ravit la forme et les traits du visage.
Dirons-nous qu’une fille à quatorze ou quinze ans
Sentit l’effort cruel de ces foudres luisans;
Perdit en un moment la lumière et la vie,
Et que sa triste fin de regretz fut suivie?
Les images des saints qu’honoroient les mortels,
(Hélas qui l’eust pensé ?) tombèrent des autels
;
Des lettres sur la pierre avaient esté gravées,
Qui furent par l’orage aussitost enlevées;
D’autres efets divers que l’on void de nos jours,
Servirent de matière aux tragiques discours;
Et si Dieu regardant la tempeste, et les vents
N’eust arresté le cours de tant de faux mouvans,
Qui sifloient, qui bruyoient avec tant de furie,
Des chrestiens affligez la race fust périe.
Les tonnerres subtils, qui couroient au dedans,
Enfin sortent du temple horriblement grondans ; [p. 55]
Les vents impétueux remontent dans les nues,
Et marquent en passant des routes inconnües.
A peine les esprits en tel estonnement
Commencent à reprendre un nouveau sentiment;
Les gosiers affaiblis retiennent la parole,
Qui contrainte parfois de la bouche s’envole.
Afin de tesmoigner par de tristes accens
Combien d’un si grand choc les malheurs sont pressans,
Le ciel en mesme temps découvre tous ses voiles:
On void luire la joîe avecque les étoiles.
Cependant on ne scait si l’on veille, ou l’on dort;
On doute également si l’on est vif ou mort:
L’un pleure amèrement le trespas de son père,
Et l’autre est incertain s’il luy reste une mère.
L’un avec des regrets demande son amy,
L’autre dans la frayeur ne parle qu’à demy:
Chacun est estonné, chacun souspire et tremble;
On n’est vivant ny mort, mais tous les deux ensemble.
|
|
[068]
|
31 JUILLET 1791.
Le Conseil Général de la commune
d’Étampes, composé de: MM Boullemier, Meunier-Pineau, Simonneau,
Péehard, Constance-Boyard, officiers municipaux, et de MM.
Portehault, le Cerf, Voizot, Fontaine, Pommeret, Baudat, Nasson, Villemaire,
Langevin, Paris, Houllier, Vanault, Chanon, notables, et Baron-Delisle,
secrétaire greffier, prend la délibération
suivante relative aux comptes présentés par les sieurs Delaitre
et de la Borde, directeur et receveur de la régie du droit de tarif,
perçu sur les boissons pendant les années 1789 et 1790, et
les quatre premiers mois de 1791.
«Le Conseil Général s’étant
fait représenter la délibération du Directoire du
département, du 21 janvier [p. 56] dernier, portant que: «attendu
que les sieurs Delaitre et de la Borde, directeur et receveur, n’ont mis aucune
activité dans la perception des droits qui leur est confiée,
qu’ils ont au contraire affecté de la négligence.»
«Le Directoire arrête qu’ils répondront
des deniers desdits droits à leurs risques périls et fortunes.»
«La délibération du Directoire
du District, du 22 février, qui enjoint aux régisseurs de
continuer la perception.»
«Rend les sieurs Delaitre et de la Borde,
directeur et receveur, garans de la rentrée des deniers.»
«Et enfin, la proclamation de la Municipalité,
du 24 février dernier, qui enjoint aux sieurs Delaitre et de la
Borde, de veiller incessamment au rétablissement et recouvrement
des perceptions arriérées;
«Comme aussi recommande à tous redevables
la soumission aux lois, ordonne qu’en cas de refus de paiement force sera
donnée à la Loi, et à cet effet, seront tenus les
officiers de la garde-nationale et le commandant de la maréchaussée
de prêter toutes assistances et main-forte à toutes réquisitions
qui leur seront adressées par le Corps municipal.
«Considérant que le traité
fait avec les sieurs Delaitre et de la Borde, par lequel sur leurs propositions
ils se sont obligés de compter de net moyennant la gratification
annuelle qui devoit leur être passée, étant un traité
particulier, ne peut nullement être assimilé à celui
de la ferme générale.
«Que les sieurs Delaitre et de la Borde
n’ont jamais constaté de résistance des redevables, ni requis
le Corps municipal de les faire soutenir dans leur perception, que même
il est à la connoissance du Conseil Général, que plusieurs
des redevables s’étant présentés pour entrer en pourparler
sur les droit dans les derniers mois d’exercice du sieur de la Borde,
il les a écartés en leur [p. 57] annonçant que, leur débet
ne le regardoit plus, mais le Corps municipal.
«Qu’ils ont d’autant plus de tort de présenter
leurs reprises, qu’il s’y trouve compris plusieurs des citoyens aisés
de la commune d’Étampes à l’égard desquels il n’a
jamais été fait de poursuites, malgré les injonctions
des Corps administratifs, et que les droits étoient perceptibles à
l’entrée sans aucune forme d’exercice, rien ne pouvoit leur être
plus aisé que de les faire acquitter, qu’ils ont couru une chance
adoptée sur leur proposition de laquelle ils ont eu le profit depuis
1766.
«Que s’ils avoient prévenu le Corps
municipal du refus de paiement, celui-ci auroit été en demeure
de faire exercer par des employés à sa disposition et y auroit
pourvu.
«Que la facilité des Corps administratifs
à l’égard des sieurs Delaitre et de la Borde, auroit outre
l’inconvénient de leur assurer l’impunité de leur négligence
dans leur perception, le vice de faire refluer sur la commune d’Étampes,
un remplacement des droits non perçus, le tarif des boissons étant
commutatif de la taille; et de faire supporter aux bons citoyens le mal
résultant de la résistance ou négligence des mauvais.
«Enfin, qu’il n’est plus à la possibilité
du Corps municipal de faire des diligences pour des droits dont le dû
n’est constaté par aucun titre authentique, et n’a d’autre garant
que la déclaration des sieurs Delaitre et de la Borde, dont les subordonnés
n’ont d’ailleurs placé sur leurs registres que les citoyens qu’il
leur a plu, ce qui est aisé à constater d’après la
modicité de la recette de leurs comptes comparée avec les
années précédentes quoique la consommation n’ait nullement
diminué.
«Qu’enfin, il est de principe en matière
de comptabilité que les receveurs des deniers publics sont comptables
de tontes les sommes consignées sur leurs registres, [p. 58] et que c’est ainsi
que doit s’entendre la facilité de compter de clerc à maître
accordée par la loi du 27 mars dernier, ce qui ne comprend que la
dispense de remplir le montant des sommes annuelles, dont les fermiers et
régisseurs généraux dévoient faire bon au-dessous
des excédens aux termes de leur traité: ce qui s’explique
formellement par la loi du 30 avril dernier, qui porte que: «les fermiers
et régisseurs généraux continueront provisoirement
à poursuivre le recouvrement des sommes qui pourront être dues
par divers redevables ainsi que les débets des comptables.»
«Sur quoi délibéré,
il a été arrêté, que Messieurs les Administrateurs
du Directoire du département seront priés, jusqu’à
la décision du Comité des finances, d’ordonner provisoirement
que la proclamation à l’occasion du retard de la perception des
droits de tarif sortira son plein et entier effet, jusques et y compris
ce qui étoit dû au dernier décembre 1790; et qu’à
l’égard des mêmes droits dus depuis le 1er janvier 1791, jusqu’au
1er mai dernier, il seroît compté de clerc à maître
avec les percepteurs desdits droits conformément au décret
du 20 mars dernier.
«Persistant le Conseil Général,
sous le bon plaisir du Directoire et jusqu’à ladite décision,
dans les oppositions qui ont été ci-devant formées
sur les sieurs Delaitre et de la Borde.
«Comme aussi a été arrêté,
qu’expédition de la présente délibération,
et de celles des trois et treize mai dernier, sera dans le plus court délai
possible, attendu l’urgence du recouvrement, adressée à
Messieurs les Administrateurs du Directoire du département, que
pareille expédition sera adressée à M. Delaitre, directeur,
à son domicile.
«Enfin, que pareille expédition sera
adressée au Comité des finances de l’Assemblée Nationale
pour le [p.59] prier de prononcer sur la question
relative à la différence qui existe entre la perception
générale confiée à la régie générale
et la perception particulière confiée aux sieurs Delaitre
et de la Borde.»
(Pièce sur six
pages in-4°, imprimée à Étampes chez Dupré,
s. d.)
|
|
[069]
|
AOUT 1825.
Tout le temps que la famille de Viart fut propriétaire
de la terre de Brunehaut, l’accès du parc était facile aux
visiteurs, et les habitants d’Étampes s’y rendaient souvent en partie
de plaisir.
Dans le courant de l’été 1823, une
société de jeunes garçons et de jeunes filles d’Étampes,
après avoir parcouru les allées du parc, s’avisèrent
de faire sur le lac une promenade en bateau. Les garçons, par malice,
débarquèrent les jeunes filles dans l’île, puis les
y abandonnèrent. Déjà le jour baissait, et ces jeunes
imprudentes se croyant perdues jetaient des cris qui furent entendus du
château: M. de Viart vint les délivrer.
C’est à l’occasion de cette aventure que
le propriétaire de Brunehaut composa la chanson suivante;
Chanson nouvelle
Dédiée aux jeunes écoliers d’Étampes
1er COUPLET.
A Brunehaut un certain jour,
Je vis venir troupe jolie.
Conduite par le dieu d’amour
Ayant près de lui la folie;
Le dieu Priape y présidait
Plein du gaieté, levant la tête
A sa bonne humeur on voyait
Qu’il était roi de cette fête.
2e.
Dans ces jardins délicieux
Le groupe avance à l’aventure. [p. 60]
On voyait briller dans leurs yeux
Tous les effets de la luxure.
Il ne manquait à leurs besoins
Qu’un lieu sauvage et solitaire.
Pour pouvoir donner tous leurs soins
A leur trop lubrique mystère.
3e.
Soudain s’offrit à leurs regards
Un lac à surface tranquille,
Qui de ses eaux de toutes parts
De l’Amitié entourait l’île.
Un temple dans ce beau séjour
Etait dédié à la Déesse;
C’est là que Priape et l’Amour
Conduisent la folle jeunesse.
4e.
Dans l’Ile, ils débarquent chantant.
La pudeur s’enfuit éperdue;
Ils étaient si monstrueux leurs chants
L’humble sagesse en fut émue,
Le Zéphir s’en mit en courroux;
Car d’un petit coup de son aile,
De ce rivage tout à coup
Fit disparaître la nacelle.
5e.
L’Amour change, capricieux,
De la société s’échappe;
Il ne reste plus avec eux
Que le lâche et triste Priape.
Ce dieu ne sentant plus l’Amour
Ne prit plus de goût à la fête.
Si bien que vers la fin du jour
Il fallut sonner la retraite.
6e.
En pensant à se rembarquer,
Vite, on avance vers la rive,
Mais j’entends soudain s’écrier,
Une voix sinistre et plaintive:
Nous n’avons plus notre bateau,
O mes amis, qu’allons nous faire?
Il faut pourtant traverser l’eau.
Mon Dieu, quelle terrible affaire!
7e.
On entendît sonner le cor,
D’un ton qui demande assistance,
Du fond du bois, de l’autre bord.
Un Satyre vers eux s’avance; [p. 61]
L’un d’eux dit à l’hôte des bois:
Venez finir notre disgrâce.
Voyez ces beautés aux abois,
A deux genoux demander grâce.
8e.
Je pourrais en venir à bout.
Leur dit-il d’une voix Sauvage,
Mais il faut promettre avant tout
De bien payer votre passage,
Soudain à l’unanimité
Ils lui ont fait cette promesse,
Et Satyre à leur liberté,
Alors travaille avec adresse
9e.
Enfin, la honte sur le front.
De la liberté ils profitent,
Et depuis ce temps-là dit-on,
Le regret jamais ne les quitte.
Jeunesse! ô vous qui m’écoutez,
Sur la leçon, prenez exemple
Et de la divine Amitié,
Ah! n’allez pas souiller le Temple.
Autographie de Colliard,
rue Saint-Denis, à Paris.
|
|
[070]
|
15 THERMIDOR AN II (2
AOÛT 1794).
Le Comité révolutionnaire de la
commune d’Étampes félicite la Convention nationale sur le
courage et l’énergie qu’elle a déployés en foudroyant
les nouveaux conspirateurs Robespierre et ses complices.
|
|
[071]
|
17 THERMIDOR AN
II (4 AOUT 1794).
La commune d’Étampes félicite les
fondateurs de la liberté d’avoir fait triompher la Justice nationale
en terrassant la cohorte infâme des modernes Catilins.
|
|
[072]
|
17 THERMIDOR AN
III (4 AOUT 1795).
Le Procureur syndic du District d’Étampes
informe [p. 62] la Convention nationale que la ferme appelée le
Prieuré de Saint-Pierre, plus cent onze arpents de terre, cinq arpents
de pré et cinq arpents de courtils, estimés 124,257 livres,
ont été vendus 702,100 livres.
(Procès-verbaux
de. la Convention, t. 43 et s.)
|
|
[153]
|
6 AOÛT 1793 (AN II DE LA RÉPUBLIQUE).
|
Voir
le n°153 (cliquez ici) dans le Supplément
en fin d’ouvrage..
|
[073]
|
9 AOÛT 1792.
Envoi à la Monnaie de Paris par les membres
composant le Directoire du District d’Étampes, qui étaient:
Charpentier, président, Héret, Sagol, Venard et Crosnier,
de l’argenterie provenant des chapitres Notre-Dame et Sainte-Croix, des
couvents des ci-devant Mathurins, Barnabites, Cordeliers et Capucins de la
même ville, et de la ci-devant abbaye de la Joie-Villiers de la paroisse
de Cerny, pesée par le sieur Hugo, orfèvre à Étampes,
après en avoir séparé le bois, le fer, le verre et
les pierres fausses au nombre de vingt.
Chapitre
Notre-Dame: Un bâton cantoral dont la tête de vermeil s’est
trouvé peser 4 marcs 3 onces, et le manche non doré 5 marcs
1 once 4 gros
|
4m
|
3on
|
" gr
|
5m
|
1on
|
4gr
|
Chapitre
Sainte-Croix: Un bâton cantoral, une grande croix sans le manche,
le Christ et les agréments de ladite croix, deux autres petites croix,
deux calices, deux patènes et un soleil, le tout en vermeil, pesant
ensemble 28 marcs 3 onces 2 gros.
|
28
|
3
|
2
|
|
|
|
Plus
deux calices, deux patènes, un ciboire, une tasse à quêter. [p.63] Deux encensoirs,
deux navettes garnies, deux cuillères et chaînes, et le manche
de la grande croix, le tout non doré pesant 25 marcs 6 gros
|
|
|
|
25
|
"
|
6
|
Mathurins:
Un soleil de vermeil, pesant 2 marcs 5 onces 5 gros
|
2
|
5
|
5
|
|
|
|
Plus
un calice, une patène, un ciboire, une custode, une navette, neuf
couverts, quatre cuillères à ragoût et six cuillères
a café, le tout non doré, pesant ensemble 14 marcs 3 onces
|
|
|
|
25
|
"
|
6
|
Barnabites:
Un calice, une patène, un soleil, un ciboire.et une custode, le
tout de vermeil, pesant ensemble 8 marcs 1 once
|
8
|
1
|
"
|
|
|
|
Cordeliers:
Un calice, une patène, un soleil, le tout en vermeil, pesant 8 marcs
1 once
|
8
|
1
|
"
|
|
|
|
Plus
une grande croix de procession, deux calices, deux patènes, un
ciboire, une custode, une navette garnie d’une cuillère et chaîne,
un encensoir et dix couverts, le tout pesant ensemble 33 marcs 1 once 5
gros
|
|
|
|
33
|
1
|
5
|
Capucins:
Deux calices, deux patènes, un soleil, un ciboire, une petite custode,
pesant ensemble 11 marcs 7 onces 2 gros [p.64]
|
|
|
|
11
|
7
|
2
|
Abbaye
de la Joie-Villiers: Une crosse et son manche, pesant 9 marcs 2 onces
4 gros
|
|
|
|
9
|
2
|
4
|
TOTAL
|
52 m
|
" on
|
7 gr
|
99 m
|
" on
|
5 gr
|
Montant de l’argenterie dorée et non dorée:
151m 1on 4gr
|
|
[074]
|
13 AOUT 1796.
Louis Poilloüe de Bierville, né à
Étampes le 28 septembre 1770, lieutenant d’artillerie à l’armée
de Condé, favorise par son courage et sa présence d’esprit
la retraite de l’armée à la suite de l’affaire d’Ober-Kamlack.
Nous empruntons à l’Histoire de l’armée de Condé,
par Théodore Muret, le récit de ce brillant fait d’armes:
«Deux pièces de canon des bataillons
nobles avaient été jointes à l’artillerie de la légion
Roger de Damas. Au moment de la retraite, l’une de ces pièces, nommée
l’Hysope, du calibre de quatre, et dirigée par un jeune
lieutenant, M. de Bierville, resta tout à fait en arrière,
son avant-train s’étant trouvé embarrassé dans les
obstacles d’un terrain boisé. A la sortie du fourré, tout
près de là, se déployait une éclaircie en forme
de plateau où l’on arrivait par une pente rapide, au moyen d’un
ravin et d’un chemin creux qui en contournaient les flancs. M. de Bierville
était occupé à faire dégager son avant-train
pour atteler sa pièce et suivre le mouvement rétrograde, quand
une forte tête de colonne paraît vis-à-vis de lui. Aux
premiers rangs, M. de Bierville reconnaît des uniformes condéens.
Trompé par cet aspect, il s’avance de quelques pas, plein de confiance;
[p. 65] mais une fusillade dirigée sur lui, sans l’atteindre,
dissipe aussitôt son erreur. Cette colonne est ennemie; ces uniformes
condéens sont portés par quelques déserteurs des troupes
de ligne, qui, passés depuis peu aux républicains, ont voulu,
pour leur donner un gage, marcher en avant.
«Par une inspiration subite, M. de Bierville
conçoit le hardi projet d’arrêter l’ennemi avec sa seule pièce.
Il ne lui reste que deux canonniers: il en met un à
l’écouvillon, l’autre aux leviers de pointage; un adjudant sous-officier
de l’infanterie de la légion, nommé Collignon, vient se
joindre à eux. M. de Bierville pointe lui-même sa pièce
chargée à mitraille et fait feu à demi-portée.
Cette volée, donnant en plein dans une masse, y creuse une brèche
large et profonde. Sur-le-champ, M. de Bierville, qui voit ce résultat,
recharge et tire avec le même succès, dirigeant alternativement
son pointage à droite et à gauche, sur les colonnes qui des
deux côtés abordent le plateau. A cause de la disposition
des lieux, elles ne s’aperçoivent de leur perte qu’à mesure
que leurs rangs pressés viennent s’offrir au feu qui les balaie.
Déjà le plateau est couvert de morts et de blessés.
Au bruit de la canonnade, les soldats condéens en retraite ont
tourné la tête: ils ont reconnu que c’est leur artillerie
qui tire encore. Quelques-uns rebroussent chemin et se jettent en tirailleurs
dans le fourré. Les républicains croient que cette seule
pièce, qui semblait destinée à devenir inévitablement
leur proie, a derrière elle des forces imposantes masquées
par le terrain couvert. Ils s’arrêtent, ils se mettent en bataille,
tandis que M. de Bierville multiplie toujours ses coups, dont aucun n’est
perdu. Il en tire ainsi jusqu’à vingt-huit, tous à mitraille.
Pendant ce temps l’avant-garde a pu effectuer sa retraite. M. de Bierville
se retire enfin, emmenant sa pièce. Le duc d’Enghien s’empressa
de reconnaître l’important service rendu par cet [p.66] officier, en lui
disant, avec chaleur, au milieu d’un groupe nombreux: — «Mon cher
Bierville, vous venez de sauver l’armée!» A l’instant il demanda
pour lui la croix de Saint-Louis et le grade de capitaine. Peu après,
M. de Bierville fut nommé commandant de l’artillerie de la légion.
L’adjudant d’infanterie Collignon, qui l’avait secondé avec tant
de zèle et d’intelligence, eut l’épaulette d’officier.»
(Théodore Muret,
Histoire de l’armée de Condé, t.1er, p. 339.)
Plusieurs pièces de poésies inséres
dans les Troubadours modernes (Constance, 1797, in-8°), ont
chanté le combat d’Ober-Kamlack. Voici deux stances d’une ode composée
par M. le chevalier de Quérelles:
Ober-Kamlack, ma main tremblante
Doit te graver en traits sanglans.
En vain l’histoire frémissante
Me dit: Ils furent triomphans!
De Baye, Nollent, victimes chères!
Si l’amitié, par ses chimères,
Vient rassurer mes sens émus!
J’entends les muses éplorées,
Et les grâces décolorées
Me dire que vous n’êtes plus.
Muse, sur des tables funèbres,
Ne retrace plus, en ce jour,
Les noms de ces héros célèbres
Que pleurent et Mars et l’amour...
Viens sous des palmes immortelles,
Cacher les blessures cruelles
Qui pourraient attrister nos cœurs!
Louis formait leur existence,
Louis mourait de leur souffrance:
Jette un crêpe sur nos douleurs. [p. 67]
|
|
[075]
|
26 THERMIDOR AN III (13
AOÛT 1795).
Le citoyen Crespin, géomètre praticien
à Chamarande, district d’Étampes, département de Seine-et-Oise,
soumet à la Convention nationale quelques réflexions sur
les inconvénients du nouveau calendrier; il demande le rapport du
décret qui a assis un impôt sur les cheminées, et que
la Convention chasse du sol de la France, les agioteurs, ces hommes atroces
qui se répandent dans les campagnes, accaparent les grains et les
farines et s’enrichissent des dépouilles du malheureux.
(Procès-verbaux de
la Convention, t. 67).
|
|
[076]
|
17 AOÛT 1653.
Naissance à Étampes de Michel Godeau,
auteur d’une traduction médiocre en vers latins de partie des Œuvres
de Boileau; il fut professeur au collège des Grassins, en 1684,
et deux fois recteur de l’Université en 1714 et en octobre 1716;
il fui aussi curé de Saint-Cômes [sic] à Paris.
D’après Moreri, édition de 1759,
Michel Godeau est mort, le 25 mars 1736, à Corbeil, où il
avait été exilé comme appelant de la bulle Unigenitus.
Le célèbre Coffin succéda
à Godeau dans les fonctions de recteur de l’Université;
en l’installant Godeau lui recommanda «de poursuivre avec zèle
et ardeur ce qui avait été commencé pour l’établissement
de l’instruction gratuite, non pas tant pour le bon plaisir de l’Université,
que pour le bien de tout le royaume.»
(Archives de l’Univ., Reg.
42, fol. 142.)
Les biographes ne s’accordent pas sur la date
exacte de la naissance de Godeau, nous donnons ci-après son acte
de baptême que nous avons retrouvé sur les registres de la
paroisse Notre-Dame: [p. 68]
«Du 17e août 1653, a été
baptisé Michel, fils de Michel Godeau et de Jeanne le Sour; le
parain qui a tenu et nommé, Thomas le Sour, maistre boulanger de
cette ville d’Estampes; la maraine Magdeleine Vrament, femme de honorable
homme maître Percheron, exempt de la maréchaussée dudit
Étampes, et ont signé: Magdelaine Vrament; A. le Sourd; Guisenot,
chantre.»
Son portrait a été gravé
par Desrochers, à Paris, sans date.
On lit au bas de ce portrait les quatre vers suivants:
Les muses dans leur sein l’ont
nourri des l’enfance.
De leurs leçons il tient mille dons excellents;
Mais son profond savoir et sa haute éloquence
Ont toujours pour le ciel employé leurs talents.
Godeau a traduit deux ouvrages de piété,
et ses poésies latines ont été publiées après
sa mort, Parisiis sumptibus Bartholomœi ALIX, 1737, 1 vol. in-12;
ce volume contient en outre des poésies de Godeau, la traduction
en vers latins de quelques poésies de Boileau par divers auteurs,
enfin il se termine par des pièces de vers de Godeau, intitulées:
l’une, Rus Torigniacum, Thorigny près de Lagny,
et l’autre, Rus Suciacum, Sucy-en-Brie, maison de campagne
près Corbeil, que fréquentait Godeau.
On cite encore de Godeau deux pièces de
vers latins, signées: Michaël Godeau, publiées
séparément et sans date, de format in-fol., à l’occasion
des thèses de philosophie, soutenues: l’une, par Claude-Henri Vincent,
l’autre, par Jean-Baptiste Testu, de Balincourt.
On attribue encore à Michel Godeau, un
opuscule de 12 pages, intitulé: Hymnes latines, par M. G.,
dédiées au doyen d’Étampes. In-12, 1725. [p.69]
|
|
[077]
|
18 AOÛT 1774.
Naissance à Étampes de Marc-Antoine
GEOFFROY-CHATEAU, officier du génie, frère d’Etienne
Geoffroy-Saint-Hilaire: il se distingua dans la campagne
d’Egypte, et mourut à Augsbourg, le 23 février 1806, à
l’âge de trente-un ans.
On l’appelait Geoffroy-Château pour
le distinguer de ses frères, parce qu’il demeurait à Étampes,
rue du Château.
Un troisième frère de Geoffroy-Saint-Hilaire
qui demeurait à Étampes, près du Port, s’appelait
Geoffroy-du-Port.
Geoffroy-Château avait un fils né
à Étampes, le 11 mai 1803, et qui mourut à Paris,
le 11 juillet 1858. Il était juge au Tribunal de la Seine, et il
a publié plusieurs ouvrages, notamment:
Napoléon apocryphe, 1837, in-8°;
Et l’une des meilleures éditions de la
Farce de Pathelin (Paris, Amyot, in-18, 1853), précédée
d’une savante introduction et d’un recueil des monuments de l’ancienne
langue française depuis son origine jusqu’à l’an 1500.
Dutertre a gravé un portrait de profil
de Marc-Antoine Geoffroy.
On trouve aussi son portrait dans l’Histoire
scientifique et militaire de l’expédition d’Egypte.
|
|
[078]
|
19 AOÛT 1781.
Un orage affreux éclata à Milly
en Gâtinais et aux environs.
Plusieurs fermes furent inondées et les
bestiaux noyés par les torrents de 25 toises de large qui se formèrent
[p. 70] subitement; les maisons du faubourg Saint-Pierre submergées
et écroulées; les grains perdus dans les granges; les chemins
rompus.
Quelques personnes auraient été
noyées si des hommes courageux n’étaient montés à
cheval pour les sauver du milieu des eaux.
Le 17 septembre suivant, à quatre heures
du soir, on orage plus terrible que le premier acheva de dévaster
le canton en détruisant ce qui avait été préservé.
(Mercure de France)
|
|
[079]
|
22 AOÛT 1715.
A propos de la mort de Claude de Longüeil,
président à mortier du Parlement, arrivée à
Paris, le 22 août 1715, dans la quarante-huitième année
de son âge, le Mercure donne la généalogie de la famille
de, Longüeil; nous trouvons notamment parmi les membres qui la composaient:
Jacques de Longüeil, chevalier seigneur de
Sèvres, Maisons, Lavaudoire et Cerny, premier maistre d’hôtel
du roi Henri III, en 1575.
Sa fille aînée Denise de Longüeil,
épousa Lazare de Selve, baron de La Ferté-Alais et Cromier,
président ès-ressorts de Metz, Toul et Verdun, etc., etc.,
etc.
(Nouveau Mercure galant,
septembre et octobre 1715.)
|
|
[080]
|
24 AOÛT 1721.
Arrest du Conseil d’Etat, par lequel:
«Le Roy voulant prévenir les suites
dangereuses qui pourraient résulter par la communication de la maladie
contagieuse, dont quelques lieux du Gévaudan et de [p. 71] la Provence se
trouvent affligez... Ordonne ce qui suit:
«ART. 1er. — Tous maistres de carosses et
autres voitures publiques..., seront tenus pour aller de Paris dans le
Bas-Languedoc, et venir du Bas-Languedoc à Paris, de suivre les
routes de Paris à Montpellier..., par Lyon ou par Clermont en Auvergne.
«ART. 2. — Sont pareillement lesdits maistres
de carosses..., tenus pour aller de Paris dans le Haut-Languedoc, et venir
du Haut-Languedoc à Paris..., de suivre la route de Paris à
Toulouse..., passant par Bourg-la-Reine, Longjumeau, Estampes, Anger-ville,
Toury, Artenay, Orléans, etc., etc., etc.»
(Le Mercure, août
1721, p. 127.)
|
|
[081]
|
24 AOÛT 1721.
Fêtes célébrées en
France au sujet de l’heureuse convalescense [sic] du Roy.
«...Les prières et les réjouissances
publiques ont été faites à Estampes, le dimanche 24
août, en l’église royale et collégiale Notre-Dame.
«Le lendemain 25, fête de Saint-Louis,
les bourgeois de la rue de la Juiverie se sont aussi signalés en
particulier à leur ordinaire; car après avoir assisté
au Te Deum chanté dans l’église de Saint-Basile leur paroisse,
et avoir mis des illuminations aux fenêtres, ils ont fait tirer un
feu dressé au milieu de la rue, précédé d’un
petit discours prononcé par l’un d’eux, au sujet de la convalescence
du Roy, qui fut suivi des acclamations de Vive le Roy, et de toutes les
autres marques de joie que peuvent donner de bons et fidelles sujets.»
(Le Mercure, octobre
1721, p. 165) [p.72]
|
|
[082]
|
9 FRUCTIDOR AN XII (27
AOUT 1804).
Un arrêté, signé: Montalivet,
alors préfet du département de Seine-et-Oise, et contresigné
par le secrétaire général de la préfecture,
Peyronet, commet le Sous-Préfet d’Étampes à l’effet
de se transporter dans les trois jours chez le Receveur particulier de l’arrondissement,
pour vérifier et constater par procès-verbal l’existence
dans sa caisse des pièces de 3 livres, 24 sols, 12 et 6 sols, ayant
une empreinte, mais dont les traces sont trop imparfaites pour qu’on puisse
distinguer si elles sont d’une fabrication postérieure à 1726,
en ayant soin de distinguer le nombre de chaque espèce différente,
leur dénomination, leur poids en masse.
Cet arrêté avait pour objet l’exécution
de différents décrets concernant le retrait des monnaies
anciennes dont l’empreinte était effacée.
A l’occasion de ces décrets sur le retrait
des anciennes monnaies, Dieulafoy, l’un des vaudevillistes le plus en
renom dans ce temps-là, composa une chanson intitulée: Réclamation
des pièces de cinq liards, et qui lui attira les persécutions
de la police.
|
|
[083]
|
SEPTEMBRE 1776.
Le Mercure de France publie les couplets
suivants adressés
A LA PLUS BELLE DES ESTAMPOISES.
Air: Dans ma cabane obscure.
Aimez, aimez Bergère,
Aimez d’autres amans,
Qui, désirant vous plaire,
Vous font mille sermens!
Leur adresse est extrême [p. 73]
Pour paroître charmans:
Pour moi je dis que j’aime...
Voilà tous mes sermens.
Lorsqu’ils vantent sans cesse
Vos grâces, vos appas,
Ils offrent leur tendresse
Et ne la donnent pas.
A Lise, ils font encore
Les aveux les plus doux:
Pour moi je vous adore...
Et ne le dis qu’à vous.
Craignez, jeune Bergère,
Leur esprit séduisant;
Surtout dans l’art de plaire
Redoutez leur talent.
Ils ont un doux langage,
Un langage flatteur:
Ils ont tout en partage...
Mais ils n’ont pas mon cœur.
Par M. Bougin, bachelier
en droit.
L’auteur de cette pièce de vers se nommait
Baugin; une personne méritant toute confiance
nous a fait connaître qu’il est mort dans les premiers mois de l’année
1829, et qu’il a institué l’Hospice d’Étampes son légataire
universel.
Quant à la Belle Estampoise qui
faisait battre son cœur, son nom est demeuré inconnu.
|
|
[084]
|
1er SEPTEMBRE 1694.
Un arrêt du Parlement décide contrairement
à l’opinion émise par dom Fleureau (Antiquités
d’Étampes, [p. 74] p. 394), que le Chapitre de Sainte-Croix est de fondation royale.
|
|
[085]
|
1er SEPTEMBRE 1808.
M. Laumond, conseiller d’Etat, préfet du
département de Seine-et-Oise, assisté de M. Bouraine, sous-préfet,
du général Romanet, maire d’Étampes, de M. Sergent,
procureur impérial, de M. Héret, juge de paix, préside
la distribution des prix de l’Ecole secondaire communale d’Étampes.
L’enseignement comprenait alors:
L’écriture et les éléments
de mathématiques, enseignés par M. Prévost;
La septième dont le professeur était
M. Nicot;
La sixième et la cinquième,
professées par M. Lefortier;
La quatrième, professée par
M. Dubos, qui était en même temps directeur de l’établissement.
Les élèves nommés le plus
souvent sont:
Dans la classe de quatrième:
Joseph-Etienne Delanoue et Auguste
Grandmaison, tous deux nés à Étampes;
En cinquième:
Eloi Angiboust et Victor Constance,
aussi nés à Étampes;
En sixième:
François Dejean el Antoine
Sédillion, nés à Étampes;
Et Louis Quinton, né à
Brières;
En septième:
Aimable Maugars, né à
Étampes;
Enfin, en mathématiques:
Romain Vallet, né à
Étampes. [p.75]
M. le général de brigade, Romanet,
maire d’Étampes, a ouvert la séance par un discours dont
nous citerons le début, parce qu’il nous fixe sur l’époque
à laquelle les études classiques ont été reprises
à Étampes, depuis la suppression du collège des Barnabites:
«Messieurs, a dit le général,
le système d’éducation dans cette ville a reçu tout
l’accroissement dont il étoit susceptible. Par l’établissement
d’une Ecole secondaire, il a reçu son complément. Les citoyens
sont rassurés sur l’éducation de leurs enfans. Elle a été
jusqu’ici l’objet d’une inquiétude légitime; ils sont délivrés
de ce pénible sentiment. L’année qui a vu se former cet établissement
n’est pas encore achevée, qu’il se présente déjà
dans un état florissant. C’est un enfant qui ne vient que de naître;
mais c’est un enfant bien constitué, et qui par cela ne peut que
prospérer...»
(Distribution des prix de l’Ecole secondaire
communale d’Étampes. Paris, imprimerie bibliographique, septembre
1808. Brochure in-8° de 46 pages.)
Le discours du général occupe les
pag. 3 à 40 incluses, il est, il faut bien le dire, un peu long;
sous prétexte de traiter du bonheur que procurent les lettres et
des avantages d’une éducation publique, il parle de beaucoup de choses;
après avoir vanté l’éloquence du second César
qui fait des héros, le général a parlé
de l’obéissance, de l’égalité, de la règle,
de l’ordre, de la méthode, de l’égoïsme, de l’orgueil,
de la modestie, de la vanité et de l’amour-propre, du caractère
et du naturel, de la Société et de la solitude, de l’émulation,
des exercices et des jeux, de l’amitié de collège et de bien
d’autres choses encore.
Quant à la distribution des prix proprement
dite, elle occupe les pages 41 à 46 incluses. [p. 76]
|
|
[086]
|
2 SEPTEMBRE 1792.
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, alors âgé
de 20 ans, porteur de la carte et des insignes d’un commissaire des prisons,
pénètre sous ce faux titre dans la prison de Saint-Firmin,
et fait connaître à ses anciens professeurs qui y sont détenus
les moyens d’évasion qu’il leur a préparés. «Tout
est prévu, leur dit-il. et vous n’avez qu’à me suivre.»
Tout avait été prévu en effet; tout, sinon le dévouement
sublime de ces vénérables prêtres: «Non, répond
l’abbé de Kéranran, proviseur du collège de Navarre;
non! nous ne quitterons pas nos frères. Notre délivrance
rendrait leur perte plus certaine!»
Les supplications de Geoffroy Saint-Hilaire ne
purent vaincre leur résolution. Il sortit, plein de regrets, suivi
d’un seul ecclésiastique qu’il ne connaissait pas.
Dans la même journée, le massacre
qui, vers trois heures, avait commencé aux Carmes et à l’abbaye,
devint général. De sa fenêtre, Geoffroy Saint-Hilaire
vit frapper plusieurs victimes: il vit, et cet horrible spectacle lui
est toujours resté présent, il vit précipiter d’un
second étage un vieillard qui n’avait pas répondu a l’appel,
soit qu’il eût voulu se cacher, soit peut-être qu’il fût
sourd!
Et pourtant, il restait à sa fenêtre,
ne pouvant détacher son esprit de la pensée d’être
utile aux ecclésiastiques de Navarre et du cardinal Lemoine, et toujours
prêt à saisir les chances favorables qui pourraient naître
des circonstances. Il attendit en vain toute la soirée; mais dès
que la nuit fut venue, il se rendit avec une échelle à Saint-Firmin,
à un angle de mur qu’il avait, le matin même, afin de tout
prévoir, indiqué à l’abbé de Kéranran
et à ses compagnons. Il passa plus de huit heures sur le mur sans
que personne se montrât. Enfin, [p. 77] un prêtre parut et fut bientôt
hors de la fatale enceinte, plusieurs autres lui succédèrent...
Douze victimes avaient été ainsi arrachées à
la mort, lorsqu’un coup de fusil fut tiré du jardin sur Geoffroy
Saint-Hilaire, et atteignit ses vêtements. Il était alors
sur le haut du mur, et tout entier à ses généreuses
préoccupations, il ne s’apercevait pas que le soleil était
levé!
(Vie d’Etienne Geoffroy
Saint-Hilaire, par son fils.)
|
|
[087]
|
5 SEPTEMBRE 1713.
Messire Claude le Doulx, baron de Melleville,
seigneur d’Outrebois, conseiller de la Grand’chambre du Parlement de Paris,
mourut le 5 septembre 1713, âgé de 79 ans.
Il fut enterré au collège de Boissy,
paroisse Saint-André-des-Arcs. Il était de la famille des
fondateurs de ce collège;
… Messires Godefroy-Jacques-Pierre de Boissy,
qui mourut en 1354, Estienne de Boissy-le-Sec, son neveu, et l’un des exécuteurs
de son testament.
«… Cette fondation a été faite
pour cinq boursiers choisis d’entre les plus pauvres, descendus de leur
famille tant du côté des mâles que des femelles. C’est
ce qui a fait que pour mieux reconnoître les prétendans à
ce droit, le principal qui doit être aussi de la même famille,
comme choisi entre les boursiers, a fait faire et graver la généalogie
de tous les descendans de Michel Chartier, seigneur d’Alainville, et de
Catherine Paté, qui étoit descendue des anciens fondateurs
de ce collège…»
(Mercure galant, septembre
1713.) [p.78]
|
|
[088]
|
6 [Lisez en fait: 5 (B.M.)] SEPTEMBRE 1799 (19 FRUCTIDOR
AN VII)
Sur la demande des habitants de Bouray tendante
à obtenir aux frais publics la reconstruction des ponts et du chemin
conduisant aux moulins de Bouray et de Beaulne,
L’ingénieur en chef du département
de Seine-et-Oise, émet l’avis que la réparation de ce pont
étant extrêmement urgente, elle doit être faite aux frais
de la République qui représente l’émigré Valory,
si la recherche des titres constate que l’émigré Valory, à
raison de ses propriétés en la commune de Bouray, était
chargé de l’entretien de ce pont ou de sa reconstruction;
Et que dans le cas où l’émigré
Valory n’aurait pas été tenu à l’entretien et à
la réparation du dit pont, elle devra être faite aux frais
des propriétaires et habitants de la commune de Bouray.
|
|
[089]
|
6 ET 7 SEPTEMBRE
1792.
Séjour à Étampes des prisonniers
d’Orléans, conduits par Fournier, l’Américain, à Versailles,
où ils ont été massacrés, le 9 septembre,
à leur arrivée.
A la fin d’août 1792 les prisons d’Orléans
renfermaient cinquante - trois accusés qui attendaient leur comparution
devant la Haute Cour.
Les principaux de ces accusés étaient:
Le duc de Cossé Brissac, en dernier lieu
commandant de la garde constitutionnelle de Louis XVI, poursuivi pour
avoir, disait-on, fomenté parmi ses soldats un esprit incivique
et contre révolutionnaire;
Delessart, ancien ministre de l’intérieur,
puis des affaires étrangères; [p. 79]
D’Abancourt, ministre de la guerre pendant les
dix derniers jours qui avaient précédé la catastrophe
du 10 août;
Etienne Larivière, juge de paix de 1a section Henri IV, accusé
d’avoir voulu porter atteinte à l’inviolabilité des représentants
Chabot, Bazire et Merlin,
Jean-Armand de Castellane, évêque
de Mende;
Vingt-huit officiers du régiment de Cambrésis,
alors en garnison à Perpignan, et sept bourgeois ou artisans de
la même ville, étaient aussi déférés à
la Haute Cour, comme ayant livré la citadelle aux Espagnols.
Fournier, l’Américain, à la tête
d’une bande de cinq à six cents patriotes armés de
sabres et de fusils, étaient partis de Paris pour Orléans,
sous le prétexte de «s’opposer à l’exécution
d’un prétendu complot royaliste qui tendait à forcer les prisons
d’Orléans et à enlever les accusés.»
A Orléans, sans tenir compte d’un décret
de l’Assemblée ordonnant que les prisonniers seraient transférés
au château de Saumur, et de l’engagement qu’il avait pris d’exécuter
ce décret, malgré les protestations des Magistrats de la
Haute Cour, Fournier fit diriger les prisonniers sur la route de Paris.
A Étampes, Fournier et sa troupe séjournèrent
deux jours, les prisonniers y furent assez bien traités et obtinrent
la faveur d’écrire à leurs proches et à leurs amis.
Ces lettres que Fournier avait promis de faire parvenir à leur destination,
furent soustraites par lui et envoyées au Comité de surveillance.
L’arrivée à Étampes d’un émissaire de la
commune de Paris, décida Fournier â modifier son itinéraire
et à conduire les prisonniers à Versailles. Les soins et les
attentions que Fournier leur témoignait n’étaient que de
l’hypocrisie, et le retard dans la marche avait pour seul de faire concorder
l’arrivée des prisonniers à Versailles avec un jour de dimanche,
[p. 80] jour favorable pour un mouvement populaire.
Les prisonniers arrivèrent en effet à
Versailles, le dimanche 9 septembre; le maire Hippolyte Richaud fit des
efforts inutiles pour diriger le convoi et protéger les prisonniers,
il voulut les couvrir de son corps. Le convoi était coupé,
Fournier et ses complices impassibles ne faisaient aucun effort pour rétablir
la communication interrompue entre eux et leurs soldats. Les assassins
comme s’ils obéissaient à un signal s’étaient rués
sur tous les chariots à la fois et avaient égorgé
presque au même instant ceux qu’ils portaient. Neuf prisonniers,
quoique grièvement blessés, parvinrent à s’échapper
sans qu’on ait pu découvrir ni leurs noms, ni leurs traces. Quarante-quatre
cadavres restèrent sur le terrain.
|
|
[090]
|
9 SEPTEMBRE
1797 (23 FRUCTIDOR AN V).
Barthélémy, membre du Directoire
et dix-sept autres personnes parmi lesquelles était Tronçon-Ducoudray,
membre du Conseil des Anciens pour le département de Seine-et-Oise,
tous déportés sans jugement par le Directoire à la
suite du coup d’état du 18 fructidor an V, traversent Étampes
sous la conduite du général de brigade Dutertre.
«Les dix-huit déportés, dit
le général Dutertre, dans sa brochure Départ du
Temple pour Cayenne des déportés des 17 et 18 fructidor
an V, étaient montés dans cinq chariots en forme de
cages de fer, fermés avec des cadenas...
«Nous allions an petit pas et sur la terre
pour éviter les cahots, ces voitures étaient fort dures;
elles étaient plutôt faites pour conduire des animaux que pour
des hommes.
«Au moment de partir de Paris, on me fit
part qu’il [p. 81] y avait un projet de faire assassiner ces dix-huit déportés
à douze lieues de Paris, que les mesures étaient prises,
qu’un rassemblement à portée s’en chargerait.
«En arrivant à Étampes, mes
inquiétudes sur la sûreté des déportés
commençaient à paraître fondées, des attroupements
se formaient, des cris à la guillotine se firent entendre: je n’oubliais
pas que cette ville fut dès le commencement de la révolution
le théâtre d’une scène sanglante. Je fis mes dispositions,
d’accord avec les autorités pour mettre en lieu sûr ceux qui
m’avaient été confiés. Le lendemain 24, nous partîmes
pour Orléans.»
Déjà l’Abeille d’Étampes
dans le numéro du 13 septembre 1873, a rapporté d’après
le journal de Barbé-Marbois, le passage à Étampes
des déportés du 18 fructidor.
Barbé-Marbois fixe ce passage à
Étampes au 25 fructidor, le général Dutertre le met
au 23 fructidor. Barbé-Marbois commet une autre erreur en indiquant
le général Hochereau, comme chargé de la conduite
des prisonniers. Le général Dutertre tenait sa commission
et ses instructions du général Augereau, il avait dans l’escorte
sous ses ordres un adjudant général nommé Hochereau
que Dutertre fit arrêter à Artenay «d’après des
preuves d’incivisme et des moyens qu’il employait pour jeter la division
dans les chefs de l’escorte.
Le premier jour complémentaire (17 septembre)
quelques heures après son arrivée à Lusignan, le général
Dutertre fut remplacé dans son commandement et reçut l’ordre
du Ministre de la Guerre de se rendre de suite à Paris. En même
temps il était arrêté et remis à la gendarmerie.
II fut traduit devant un Conseil de guerre qui l’acquitta. [p.82]
|
|
[154]
|
9 SEPTEMBRE 1690.
|
Voir
le n°154 (cliquez ici) dans le Supplément
en fin d’ouvrage.
|
[091]
|
11 SEPTEMBRE 1795 (25 FRUCTIDOR
AN III).
Les Administrateurs du District d’Étampes
instruisent la Convention nationale du prix des grains sur les marchés
publics, afin de prévenir les dilapidations des fournisseurs de
la république; ces Administrateurs demandent que les achats pour
l’approvisionnement de Paris et des armées ne soient confiés
qu’à des gens probes, et que leurs signalements soient portés
sur leurs commissions.
(Procès-verbaux de
la Convention, vol. 69, p. 157.)
|
|
[092]
|
13 SEPTEMBRE 1712.
Le Chapitre de l’église de Notre-Dame d’Étampes
fait célébrer un service solennel pour le repos de l’âme
de S. A. Monseigneur le duc de Vendôme et d’Étampes, prince
d’Anet, son bienfaiteur, décédé à Vinaroz (Espagne),
le 11 juin précédent. Il était fils de Louis duc de
Vendôme et de Laure Mancini, et arrière petit-fils de Henri
IV et de Gabrielle d’Estrées.
La messe a été dite par Mgr l’évêque
de Waterford et de Limerik en Irlande: l’oraison funèbre du prince
a été prononcée par le P. Gramain, jésuite;
tout le Clergé de la ville et du duché ainsi que les Magistrats
d’Étampes ont assisté à la cérémonie.
|
|
[093]
|
14 SEPTEMBRE 1735.
Mgr Languet, archevêque de Sens, se rend
à Étampes au couvent des Dames de la Congrégation,
dans le dessein de leur faire reconnaître la bulle Unigenitus et de
faire procéder à l’élection des officières
du couvent. [p.83]
|
|
[094]
|
15 SEPTEMBRE 1735.
La sœur Rivet est élue supérieure,
malgré la protestation des opposantes.
|
|
[095]
|
16 SEPTEMBRE 1735.
Mgr Languet tient un chapitre pour faire admettre
à profession la sœur Lefebvre que les religieuses avaient refusé
de recevoir.
Les religieuses opposantes protestèrent
contre la profession de la Novice et se retirèrent aussitôt
après en avoir demandé acte.
Elles remirent en même temps entre les mains
de la sœur Rivet, un acte pour l’assurer de leur disposition à ne
jamais la reconnaître pour supérieure.
Elles prétendirent justifier leur opposition
dans un Mémoire imprimé sous ce titre:
Mémoire pour les Religieuses de la Congrégation
d’Étampes, au sujet de l’élection nulle et irrégulière
de la Mère Marie de Jésus à la supériorité
de leur monastère, et de la profession de la sœur Marie-Louise Lefebvre,
pour servir de réponse à une Requête au Roi de lad.
Marie de Jésus et de seize autres religieuses dudit monastère.
Factum de 40 pages in-4° suivi de 16
pages comprenant les pièces justificatives au nombre de quatorze.
Le refus par certaines opposantes de reconnaître
pour légitime l’élection de la sœur Rivet, subsistait encore
en 1758. Au mois de mai de cette année, le cardinal de Luynes, archevêque
de Sens, visita de nouveau le monastère; quatre religieuses étaient
encore opposantes, le cardinal dans l’imposibilité [sic] où
il se trouva d’obtenir leur soumission obtint du Roi un ordre pour [p. 84] les faire transférer
an couvent de Saint-Charles d’Orléans (juillet 1758).
|
|
[096]
|
14 SEPTEMBRE 1807.
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire est élu
membre de l’Académie des sciences. En le félicitant Cuvier
lui dit: «Je suis d’autant plus heureux que je me reprochais d’occuper
une place qui vous était due.»
|
|
[097]
|
15 SEPTEMBRE 1793.
Sur un rapport adressé à la Convention
nationale par les commissaires Roux et Bonneval, Lavallery et deux autres
membres du Directoire de Seine-et-Oise, sont destitués et décrétés
d’arrestation.
|
|
[098]
|
19 SEPTEMBRE
1645.
Les Religieuses de la Congrégation de Notre-Dame
d’Étampes, malgré l’opposition des Cordeliers, obtiennent
de la Duchesse de Vendôme la permission de renfermer la rivière,
dans l’étendue de leurs héritages.
|
|
[099]
|
22, 23, 24, 25, 26, 27
ET LUNDI 28 SEPTEMBRE 1556.
Lecture et publication en la salle du plaidoyer
du séjour d’Étampes, des coutumes des bailliages et prevosté
d’Étampes et autres ressorts d’iceluy bailliage, arrestées
par les Trois-Estats, en présence de:
Christophe de Thou, président, Barthélémy
Faye et Jacques Viole, conseillers du roi en la Cour de Parlement, commissaires;
[p.85]
Des officiers du roi à Étampes;
Et des gens des Trois-Estats pour ce faire
assemblés. |
|
[100]
|
24 SEPTEMBRE 1825.
M. Tullières, maire d’Étampes, chevalier
de Saint-Louis et de l’Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare,
Adresse une circulaire aux habitants pour appeler
leur compassion en faveur des habitants de Salins, réduits à
la misère par suite d’un incendie qui a dévoré toute
la ville.
Deux mille cinq cents habitants étaient
sans asile, et les pertes constatées s’élevaient à
7,042,925 francs.
M. Tullières donne avis à ses concitoyens
qu’une souscription est ouverte à l’Hôtel de la Mairie et
les invite à y déposer leur offrande.
|
|
[101]
|
7 OCTOBRE 1820.
Première séance publique de la Société
d’Agriculture de l’arrondissement d’Étampes.
Dans cette séance, M. de la Boulinière,
sous-préfet d’Étampes et président honoraire de la
société, et M. Hénin, de Longuetoise, président
titulaire, ont prononcé chacun un discours;
M. de Brun a lu un mémoire sur la culture
du blé de Smyrne; et M. Sevestre sur la statistique des bêtes
à grosses cornes de l’arrondissement.
(Brochure in-8° de 20 pages,
imprimée à Étampes, chez Dupré fils.)
A la fin de cette brochure se trouve la liste
des membres de cette société qui paraît avoir été
dissoute vers 1825. [p.86]
|
|
[102]
|
6 OCTOBRE 1821.
Seconde séance publique de la Société
d’agriculture de l’arrondissement d’Étampes.
Après une allocution de M. Laboulinière,
sous-préfet d’Étampes, président d’honneur, M. Hénin,
de Longuetoise, président titulaire, a prononcé un discours
sur les avantages que présentait pour le pays la Société
d’agriculture.
Ensuite, M. Glachant, receveur des contributions
directes à Angerville, secrétaire archiviste, a lu le compte-rendu
des travaux de la Société pendant la seconde année.
Il a signalé, l’établissement récent d’une sucrerie
de betteraves chez M. de Prunelé, à Chalo-Saint-Mars, et d’une
autre à Toury qui était alors, probablement en France
celle construite sur la plus grande échelle.
M. Glachant a ensuite entretenu la Société
de la découverte de débris d’animaux fossiles faite à
Chevilly, près d’Orléans; des différents ouvrages
offerts à la Société; des récompenses accordées
par elle; des causes de la destruction des grains d’automne dans les hivers
de 1819 à 1820 et de 1820 à 1821.
Ce compte-rendu se termine par une courte notice
sur le comte de Balivière, membre de la Société, décédé
dans le courant de l’année.
Dans les mémoires de la Société
pour la seconde année imprimés à Paris, chez madame
Huzard (1821, in-8° de 108 pages), on trouve encore:
Un rapport de M. Delafoi, sur les
avantages que présente l’emploi des juments aux travaux de culture;
Une notice sur le pommier du Japon cultivé à Champrond,
par M. de Brun des Baumes;
Un mémoire de M. Louis Rousseau, sur l’utilité des
frictions à la peau des bestiaux à l’engrais; [p.87]
Une dissertation de M. Glachant, sur le commerce extérieur
des grains;
Les encouragements accordés aux agents inférieurs
de la culture;
Enfin, la liste des membres et correspondants.
|
|
[103]
|
6 OCTOBRE 1822.
Troisième séance publique de
la Société d’agriculture de l’arrondissement d’Étampes.
Le baron Gaussard, maréchal des camps
et armées du roi, président titulaire, a ouvert la séance
en rendant hommage au mérite de son prédécesseur; il
a ensuite soumis à la Société des observations sur les
avantages que procurent à l’agriculture les clôtures de haies
vives.
M. Glachant, secrétaire archiviste, a
lu le compte-rendu des travaux de la Société pendant la troisième
année.
Il a signalé d’abord l’usage par M. Armand
Rousseau, d’Angerville, de différents instruments aratoires perfectionnés;
puis, il a entretenu la Société d’une méthode en usage
en Allemagne, pour la récolte des fourrages; des ouvrages envoyés
à la Société. Enfin, il donne quelques paroles de
regrets aux deux membres que la Société a perdus dans le
courant de l’année, M. Claude Lesage et M. de la Sablière.
Les mémoires de la Société
pour cette troisième année également imprimés
à Paris, chez madame Huzard (1822, in-8° de 96 pages), se terminent
par une notice sur l’avantage de l’emploi des aciers sir Henry dans la
fabrication des instruments d’agriculture;
Par le compte qu’a rendu M. de Brun des Baumes,
de quelques essais de culture faits par lui sur diverses espèces
de céréales; [p.88]
Et, par la liste générale des membres
et correspondants de la Société.
|
|
[104]
|
11 OCTOBRE 1857.
Inauguration à Étampes de la
statue d’Etienne GEOFFROY SAINT-HILAIRE, né à Étampes.
La statue avait dû être exécutée
en bronze par David, d’Angers, mais la mort l’enleva lui-même avant
qu’il eût pu achever son œuvre.
Elias Robert, élève de David, né
à Étampes, offrit de faire une statue en marbre. La ville
d’Étampes accepta son offre généreuse et la statue
fut inaugurée, le 11 octobre 1837. Un concours immense de savants,
de professeurs, de parents, d’amis assistait à celte solennité;
plusieurs éloges furent prononcés, par le préfet du
département et par M. Pommeret des Varennes, maire de la ville, par
MM. Duméril, Serres, Milne-Edwards, Michel Lévy et Jomard,
ancien collègue de Geoffroy Saint-Hilaire dans l’expédition
d’Egypte. Le discours de M. Pommeret des Varennes, maire d’Étampes,
a été imprimé à Paris, chez Mallet-Bachelier.
(Pièce in-4° de 10 pages.)
Le Magasin pittoresque (tome XXVI, septembre
1838), a publié une gravure de la statue, une notice sur Geoffroy
Saint-Hilaire et un compte-rendu de l’inauguration du monument.
|
|
[105]
|
16 OCTOBRE 1821.
M. Tullières, maire de la ville d’Étampes,
chevalier de Saint-Louis et de celui de Notre-Dame du Mont-Carmel et de
Saint-Lazare, informe par une circulaire [p.89] imprimée ses concitoyens de
l’ouverture d’une nouvelle route d’Étampes à Pithiviers.
«Déjà, dit-il, elle a reçu
sa perfection du côté de Pithiviers, l’espace d’un myriamètre
et demi.»
Dans cette lettre il annonce à ses administrés
que «le Conseil municipal a tellement reconnu l’utilité de
cette route qu’il vient de voter une somme de 1,200 fr.,» et il ajoute:
«Le Conseil municipal compte sur la bonne
volonté des habitans d’autant plus nécessaire que ce n’est
qu’à cette condition que le Conseil général du département
a alloué pour la confection de la route, dont est question, la
somme de 19,000 francs.
«Pour jouir promptement des avantages qu’elle
procurera, tous les habitans sont invités à concourir à
sa confection par des souscriptions libres en voitures et en chevaux.
Ceux qui n’ont ni voitures ni chevaux sont appelés à y coopérer
par des dons volontaires en argent.»
|
|
[106]
|
27 VENDÉMIAIRE
AN II (18 OCTOBRE 1793).
Couturier, de la Moselle, en mission dans les
districts d’Étampes et de Dourdan, prend un arrêté
par lequel il ordonne la destruction des matières précieuses
des églises..., cloches, etc...
«Considérant, porte l’arrêté
qu’à l’église dite de Notre-Dame, il existe deux grands et
vieux clochers, dont l’un est couvert de plomb évalué à
soixante milliers pesant ou environ..., que ce clocher est aussi garni
d’une grande quantité de fer, tous objets de la plus grande utilité.»
«Arrête: Le clocher couvert de plomb
sera démoli, vendu par adjudication.»
(Archives nationales,
A F II (142). [p. 90]
Jean-Pierre Couturier était en 1789, lieutenant
général au bailliage de Bouzonville, près du Metz,
et en mars 1791, juge suppléant à la Cour de Cassation.
Il fut en cette année nommé député
du département de la Moselle, à l’Assemblée législative,
et en 1792, à la Convention nationale.
Il s’est rendu célèbre à
la Convention par deux propositions qui font connaître l’homme:
le 16 mars 1792, il demanda à l’Assemblée d’accorder une
amnistie entière à Jourdan Coupe-têtes et à
ses complices, qui venaient d’ensanglanter la ville d’Avignon.
Le 13 mai de la même année, il proposa
une nouvelle formule pour le serment des prêtres et demanda l’incarcération
de ceux qui le refuseraient.
En exécution d’une loi du 23 août
1793, Couturier reçut de la Convention la mission de se rendre à
Étampes pour régénérer le pays. Il a rendu
compte de sa mission dans un mémoire adressé par lui à
la Convention nationale, intitulé:
Rapport fait à la Convention nationale
relativement aux régénérations opérées
dans les districts d’Étampes et de Dourdan, avec quelques observations
et remarques indispensables, notamment sur le mode d’assurer des subsistances
jusqu’à la récolte prochaine, par le citoyen Couturier,
de la Moselle, du 28 frimaire l’an II de la République.
Le récit des faits qui se sont passés
à Étampes pendant la mission de Couturier, ne serait pas
le chapitre le moins curieux de l’histoire de notre contrée pendant
la Révolution. Nous engageons ceux de nos lecteurs qui seraient
désireux d’étudier à fond cette époque néfaste,
de consulter outre le Rapport de Couturier que nous venons de citer,
le Moniteur des 12 et 28 brumaire an II, mais nous leur recommandons
tout particulièrement les Tables manuscrites des Procès-verbaux
de la Convention nationale, qui se trouvent aux Archives nationales.
[p.91]
Ces tables que nous avons consultées seulement
pour les tomes 25 et 26 de la collection des procès-verbaux, nous
ont fourni sur Étampes et sur le séjour de Couturier dans
nos murs, les indications suivantes que nous donnons textuellement et sans
commentaire.
ÉTAMPES (Commune).
19 Brumaire an II:
L’Administration régénérée
remercie la Convention de lui avoir envoyé Couturier.
21 Brumaire:
Le Comité de Surveillance d’Étampes
invite la Convention à rester à son poste.
22 Brumaire:
Régénération des Corps constitués
opérée par Couturier.
28 Brumaire:
Une députation de la commune d’Étampes
annonce à la Convention l’arrivée de treize voitures chargées
de 51,035 livres de fer et autres métaux.
29 Brumaire:
Le premier bataillon de la première levée
du district d’Étampes invite la Convention à rester à
son poste, et l’instruit du serment prêté entre les mains
de Couturier.
9 Frimaire an II:
La Société populaire d’Étampes
informe la Convention du courage du Sans-Culotte Donat.
FAVIERE-DÉFANATISÉE
(Saint-Sulpice-de-Favière).
7 Brumaire an II; Envoi d’argenterie.
AUVERS.
Envoi d’argenterie.
LA FERTÉ-ALAIS.
23 Brumaire:
Une députation apporte à la Convention
les métaux précieux de l’église. En guise de divertissement,
ces individus sont revêtus de guenilles mystiques qu’ils jettent
avec mépris au pied du bureau (sic).
MAUCHAMPS (Commune).
6 Brumaire:
Envoie l’argenterie de son église.
Le citoyen Pierre Dolivier se plaint des calomnies
de Couturier.
MONNERVILLE (Commune).
28 Brumaire:
Envoie à la Convention le procès-verbal
de la régénération des autorités.[p.92]
CHAMARANDE.
29 Brumaire:
Le citoyen Cochet, prêtre, envoie à
son père ses lettres de prêtrise.
DOURDAN.
15 Brumaire:
Le citoyen Savouré, administrateur du district
de Dourdan, a brûlé ses lettres de prêtrise sur la place
publique.
COUTURIER (Jean-Pierre),
représentant du peuple
à Étampes.
17 Brumaire:
Fait un envoi d’argenterie provenant des églises
de Breuillet, Favières-défanatisèe..., annonce le
mariage du curé de Saint-Sulpice.
20 Brumaire:
Annonce l’abondance des blés à Étampes.
25 Brumaire:
Annonce que Ledoux, curé d’Étréchy,
renonce à ses fonctions.
27 Brumaire:
Adresse à la Convention dix-huit à
vingt voitures de cloches, provenant des églises d’Étampes
et des environs.
Annonce le désistement de plusieurs prêtres et des
dons d’argenterie d’église.
28 Brumaire:
Annonce l’abondance des blés et l’arrivée
de deux cents voitures de cloches et métaux divers.
3 Frimaire:
Annonce l’équipement des Volontaires.
Fait passer au Creuset les richesses des églises.
Fait abjurer les prêtres.
8 Frimaire:
Écrit qu’il fait célébrer
les jours de Décadi dans les communes du district, notamment à
Itteville.
15 Frimaire:
Annonce qu’il a trouvé une caisse d’argenterie
dans la maison de l’émigré Valory.
9 Frimaire:
Écrit d’Étampes que les dons en
chemises sont aussi importants à Dourdan qu’à Étampes.
Annonce que les huit cantons du district d’Étampes
ont fourni cent trente-cinq chevaux.
C’est sans doute, après que sa mission
à Étampes avait cessé, que Couturier adressa à
la Convention son rapport que nous avons déjà mentionné,
du 28 frimaire an II (18 décembre 1793), sur les régénérations
opérées par lui. [p.93]
Dans le mois suivant, Couturier était avec
son fils en mission aux armées du Rhin, et il paraît qu’à
cette époque sa femme qui était potière de terre
se trouvait fort gênée; à la date du 15 nivôse
an II (4 janvier 1794), nous trouvons dans le 28e volume des Procès-verbaux
de la Convention, mentionnée, une pétition de l’épouse
du citoyen Couturier, qui se plaint de ce que le propriétaire de
la maison où elle loge veut l’en chasser, parce qu’elle n’a pas payé
ses loyers.
Dans la séance de la Convention du 3 frimaire an III (23
novembre 1794), Couturier vota le décret d’accusation contre Carrier,
dans des termes bons à connaître:
«Ce ne sont point, dit-il, les noyades,
les fusillades, ni même les soupapes prétendues de l’invention
de Carrier qui fixent mon opinion, parce que le mode de destruction des
ennemis et brigands contre la république, ne peut être jugé
criminel que par son intention bonne ou mauvaise.»
Quelques jours plus tard, Couturier, lui aussi,
était mis en accusation, et une procédure s’instruisait
contre lui au Tribunal criminel de Seine-et-Oise. Il parvint à
éviter une condamnation, et fut dans la suite successivement membre
du Conseil des Cinq-Cents, puis député au Corps législatif.
En 1803, Couturier se fit nommer directeur de
l’enregistrement dans le département de la Loire. Il est mort à
Issy, près Paris, le 5 octobre 1818.
|
|
[155]
|
23 OCTOBRE 1793 (2 BRUMAIRE AN II).
|
Voir
le n°155 (cliquez ici) dans le Supplément
en fin d’ouvrage.
|
[107]
|
24 OCTOBRE 1666.
Ce jour le P. Ribiollet, qui fut provincial des
Barnabites, de 1665 à 1668, donne les monita au collège
d’Étampes à la suite d’une visite qu’il venait de faire
de ce collège. Il adressa en même temps au supérieur
général de l’ordre, une relation détaillée
sur l’origine du [p.94] collège et sur les revenus; il termine ainsi sa relation:
«Le local, tant pour les classes, que pour les religieux, est suffisamment
vaste et commode. Il comprend deux jardins et il est situé dans
un pays dont l’air est très-sain.»
|
|
[108]
|
24 OCTOBRE 1790.
L’ingénieur du District d’Étampes,
adresse au Directoire du département de Seine-et-Oise, ses observations
au sujet des ateliers de secours pour les quatre-vingt-dix ouvriers de
Paris, à employer dans le District d’Étampes.
L’Ingénieur demande:
Que ces ouvriers soient placés sous sa
direction, et qu’avant de les envoyer, l’Autorité s’entende avec
les Municipalités sur les mesures à prendre pour faire subsister
ces ouvriers et pour les loger.
Il demande qu’on lui donne deux conducteurs par
atelier, qu’on leur assure à chacun un traitement d’au moins quatre-vingt-dix
livres par mois, et qu’avant de faire les essais proposés, le département
assure dans la caisse du Trésorier du District les fonds nécessaires
au paiement des ouvriers et des conducteurs.
Enfin, il réclame de la part du District
un concours efficace pour la surveillance des ouvriers, et qu’il soit
fortement secondé par les brigades des maréchaussées
voisines et particulièrement par les gardes nationales des environs,
pour pouvoir contenir les ouvriers en tout temps.
|
|
[109]
|
26 OCTOBRE 1526.
Passage à Étampes
du convoi funèbre de la reine Claude, première femme de François
Ier.
Claude, la fille aînée de Louis XII
et d’Anne de [p.95] Bretagne, avait succédé à sa mère
dans la possession du comté d’Étampes.
Cette princesse à peine âgée
de quinze ans, épousa, le 4 mai 1514, à Saint-Germain-en-Laye,
François, comte d’Angoulême et duc de Valois, qui quelques
mois plus tard monta sur le trône de France sous le nom de François
premier. Cette union fut pour la ville d’Étampes l’occasion
de faveurs royales. La jeune princesse lors de son passage dans notre ville
avait consenti à se faire auprès de son père l’interprète
des vœux des habitants d’Étampes, et le jour même de son
mariage, elle obtint de Louis XII qu’il affranchît les habitants
d’Étampes, ses vassaux, de la dépendance des lieutenants
du roi, et qu’il les autorisât à se construire une maison
commune et à administrer eux-mêmes librement leur cité.
La reine Claude qui, à son premier passage
à Étampes, avait refusé toute espèce d’honneurs
revint dans nos murs, le 28 janvier 1516. Celle fois, dit dom Fleureau,
«elle fut reçue par les habitans sous les armes, par le clergé,
par tous les officiers de la justice et par le corps de la ville, au nom
de laquelle les échevins lui présentèrent un superbe
dais chargé d’écussons aux armes de Sa Majesté et
de quantité de chiffres en «broderies d’or; ils le portèrent
au-dessus de sa litière «depuis la porte Saint-Martin par
laquelle elle entra, jusques au château où elle voulut loger.
Les rues étoient éclairées de quantité de flambeaux,
et ce qui agréa le plus Sa Majesté, ce fut une compagnie de
deux cents petits garçons, qui portoient à la main chacun
une banderole de tafetas chargée de ses armes.»
«Les habitans d’Estampes, dit encore dom
Fleureau, furent bientôt privez de l’honneur d’avoir leur reine pour
comtesse et dame particulière de leur ville, car elle mourut l’an
1524, le vingtième jour de juillet.» [p. 96]
La reine Claude mourut dans ce même château
de Blois, où, dix ans auparavant, sa mère Anne de Bretagne,
avait rendu aussi le dernier soupir.
«Claude de France, dont le règne
fut si court et la fin si prématurée, joignait à
une piété sincère une grande douceur, un caractère
toujours égal, et surtout une extrême bonté, qui la
fit appeler de son temps la bonne reine.
«La douce et modeste devise qu’elle avait
choisie peint d’un seul trait la mansuétude et tout le calme de
son âme. C’était une lune en plein avec ces mots: Candida
candidis. Mais bien différente de sa mère Anne de Bretagne,
la jeune épouse de François 1er, n’avait point reçu
de la nature ces dons extérieurs qui au premier abord séduisent
les regards; sa taille était médiocre, les traits de son visage
n’avaient rien qui fixât l’attention, et si quelque chose dans sa démarche
rappelait la reine Anne, c’est qu’à son exemple elle boitait un peu,
sans avoir toutefois comme elle l’art de déguiser presque entièrement
ce défaut.» (Maxime de Montrond, t. II, p. 55.)
Belleforest, historien contemporain, fait dans
son style ce bel éloge de Claude de France: «Elle étoit,
dit-il, estimée la fleur et perle des dames de son siècle,
comme étant un vrai miroir de pudicilé, sainteté,
piété et innocence; la plus charitable et courtoise de son
temps; aimée de chacun, et elle aimant ses sujets et s’efforçant
de bien faire à tous, et n’ayant souci que de servir Dieu et de complaire
au Roi, son époux.»
Des auteurs du temps disent encore, qu’au lieu
de prier pour elle, on l’invoquait comme sainte après sa mort, et
que quelques personnes persuadées de sa sainteté, lui demandaient
remède en leurs maladies et autres adversités.[p.97]
Deux années après sa mort, les restes
de la reine Claude furent transportés de Blois à Saint-Denis.
Le passage à Étampes du convoi funèbre
de la reine Claude, nous est révélé par un manuscrit
de la Bibliothèque nationale (K. 83, n° 18), portant en tête:
Despence de madame de ta Trémoille
et aultres dames et damoiselles qui ont accompaigné et conduict
le corps de la feue royne CLAUDE, que Dieu absoille, depuis Bloys jusques
à Sainct-Denys en France.
Le convoi parti de Blois le 12 octobre 1526 est
passé à Étampes, le 26 octobre, et n’est arrivé
à Saint-Denis que le mercredi septième jour de novembre,
qui est le jour que ladite feue Royne fust enterrée.
Le cortège qui accompagnait devait être
nombreux si l’on en juge par la quantité des denrées qui
se consommaient chaque jour, et par les différents services qui le
composaient. Pour apprécier exactement la quantité de ces
denrées, et arriver par ce calcul à évaluer le nombre
des personnes qui composaient le cortège, il faudrait avoir des
connaissances qui nous font défaut. Nous nous bornerons à
donner un extrait du registre en question, en ce qui concerne les dépenses
faites pendant le séjour à Étampes; dépenses
qui se renouvelaient à peu près chaque jour:
FOURRIÈRE:
A la veufve feu maistre Guillaume Cormerean, d’Estampes,
pour deux cens bûches de gros boys et soixante-douze fagotz, pour
le jourd’huy et le lendemain disner, CXVIII solz;
|
|
|
A
ladite veufve, pour le desroy (1) du logis de madame de la Trémoille et cuysine, et avoir
fourny de linge pour les tables et cuysine, baterie et ustancilles de cuysine
pour le soupper d’arsois (2) et le disner du jour subséquent, LX sols;
A Macé Baudequyn, pour le desroy du logis
de madame de Sainct-Simon et les filles dont elle a charge, X sols; [p. 98]
A Marguerite More, pour le desroy du logis de
madame d’Avangort et les Frezes, X sols;
A l’oste de madame de la Guerche, pour le desroy
de son logis, X sols;
A Jehan Huiche, pour le desroy du logis de madame
la Chastellaine et Pleines, X sols;
Pour le desroy de la panetrye. V sols;
Pour le desroy de l’eschançonnerie, V sols;
Pour le desroy de la fructerie, V sols;
Pour le desroy du garde-manger, V sols;
|
(1)
Desroy, le désarroi, le dérangement
occasionné pour loger madame de la Trérmoille.
(2) D’arsois,
d’hier au soir.
|
|
A
Guillaume Reverdi, pour paille (1), par luy fournye aux dames dont es-jours
précédans, est faicte mencion que les religieux à
l’esglise d’Estampes, IX sols VI deniers.
Sabmedy XXVIIe jour d’octobre 1526, disner
au dit lieu d’Estampes et coucher à Longehumeau.
Paneterye:
A Jehan Dumayne, pour trente douzaines de pains,
IIII livres X sols;
Eschançonnerie:
A l’oste du Sauvaige, d’Estampes, pour huict
pintes de vin cléret viel, X sols;
A … d’Estampes, pour dix pintes et demye de vin
blanc viel, VII sols;
A l’ostesse de Sainct-Jullien d’Estampes, pour
treize septiers de vin cleret nouveau, LII sols.
|
(1)
Les lits à cette époque se composaient même pour les
dames de la, cour d’une paillasse, dont on renouvelait la paille à
chaque étape.
Des religieux accompagnaient le corps qu’on déposait
chaque jour dans l’église, ils ne le quittaient pas et se relevaient
probablement pour veiller la nuit.
On fournissait à ceux qui ne veillaient
pas de la paille pour se coucher.
|
[110]
|
MARDI 29 OCTOBRE
1793 (8 BRUMAIRE AN II).
Couturier célèbre révolutionnairement,
sur la place Saint-Gilles, à Étampes, le mariage du curé
de Champigny.
Nous donnons la copie de cet acte transcrit par
les ordres de Couturier sur le registre des actes de mariage de Champigny
pour l’année 1793, dont l’original doit [p. 99] se trouver aussi
sur les registres de la ville d’Étampes.
Dans cet acte, Couturier ne se borne pas à
violer les lois de l’église, il viole encore dans toutes les dispositions
relatives au mariage civil, la loi du 20 septembre 1792 qui régissait
alors les actes de l’état-civil. Le mariage célébré
par Couturier était un acte nul sous tous les rapports, c’était
un scandale et rien autre chose. La loi du 20 septembre 1792 qui a servi
de base au titre II de notre Code civil, voulait que le mariage alors
fut précédé de publications faites huit jours à
l’avance dans le lieu du domicile de chacune des parties; l’acte de mariage
ne pouvait être reçu que dans la maison commune du lieu de
ce domicile. Couturier se soucie fort peu de se conformer à la loi,
il usurpe les fonctions d’officier de l’état-civil et celles de notaire,
et célèbre le mariage sur une place publique d’Étampes.
Voici cet acte:
Ce jourd’hui huitième jour du second mois
de l’an II de la. République française, une et indivisible
en la ville d’Étampes, une heure de relevée, au-devant de l’arbre
de la Liberté, planté sur la place de la Régénération.
Par devant moi Jean-Pierre Couturier, représentant
du peuple, assisté du citoien Duché, officier public en ladite
ville, et en présence des témoins ci-après nommes
et d’une grande affluence de citoyens, sont comparus Henri Salmon, curé
de la paroisse de Champigny, âgé de cinquante-six ans, natif
de Venderesse, district de... département des Ardennes, fils de
feu Jean-Baptiste Salmon et de deffunte Charlotte Aubert, d’une part; et
Anne Chaté, âgée de quarante-huit ans et demie, fille
de Claude Chaté, journalier, demeurant à Herry-le-Chatel,
et de deffunte Françoise Portier, ses père et mère,
demeurant tous deux en la commune de Champigny, d’autre part;
Lesquels ont dit que, désirant, depuis
longtemps de s’unir ensemble, ils n’avaient pu le faire sous l’ancien
régime, pourquoi voulant profiter de la présence de Moi,
représentant du peuple, pour donner à leurs citoiens l’exemple
de leur soumission aux lois nouvelles auxquelles ils applaudissoient de
tout leur cœur et craignant mon prompt départ, ils ont, dimanche
dernier, fait publier à la porte de la maison commune et en la forme
ordinaire leur union prochaine, et qu’ils paroitroient devant Moi pour
leur donner acte de leurs conventions matrimoniales qui purement et simplement
consistent et se réduisent à laisser au survivant la jouissance
de tout ce qu’ils possèdent tant en meubles [p. 100] qu’immeubles et dont lu prix principal
est de la somme de six mille livres que les acquêts conquets faits
ou à faire, les donnations successions et legs qui pourront leur
avenir pendant la présente communauté seront de même
à la jouissance du survivant, le tout sans être tenu de donner
caution.
A été convenu, en outre, entre les
parties qu’attendu que la fortune dont ils jouissent actuellement, appartient
en totalité au¬dit Salmon à l’exception des hardes de
ladite Chaté, qu’après la mort sans enfants desdits époux,
la totalité de leur fortune retournera aux héritiers dudit
Salmon, à moins que le père de ladite Chaté ne soit encore
vivant, dans lequel cas lesdits époux consentent qu’il jouisse jusqu’à
son décès de la totalité de leur fortune, laquelle retournera
auxdits héritiers Salmon après sa mort, inventaire préalablement
fait après la mort desdits Salmon et sa femme et de suite procéder
à la célébration de leur mariage si longtemps désiré.
En conséquence, après avoir donné
connaissance à haute et Intelligible voix de là publication
avant ditte et de celle extraordinaire que j’ai fait faire aujourd’hui
au son de la caisse, j’ai interpellé au pied de l’arbre de la Liberté
au milieu de l’affluence des citoiens, tous et chacun de former à
l’instant son opposition, si aucune il i a et personne ne s’étant
présenté, lesdits conjoints se sont donné la main
et réciproquement ont prononcé librement et déclaré
s’épouser. Cette formalité observée, j’ai déclaré
à haute et intelligible voix, au nom du Peuple François et
de la Loi que lesdits Salmon et Chuté étoient unis en mariage.
J’ai, en outre, arrêté que le présent
acte de mariage révolutionnairemcnt célébré,
sera transcrit à l’instant sur le registre des mariages de la Commune
de Champigny, apporté à cet effet; le tout fait en présence
des citoiens Charpentier, de Sebillon, administrateur du département.
Sureau fils, juge de paix du canton d’Étampes, et Baude, président
du tribunal du district d’Étampes, qui ont signé avec les
parties, l’Officier public et Moi, les jour, mois et un avant dit. Signé:
Anne Chaté, Salmon, Sureau fils, Duchez, officier public, Couturier,
Baude, Charpentier, Sebillon et P. Raguideau.
|
|
[111]
|
31 OCTOBRE 1793 (10 BRUMAIRE
AN II).
Le citoyen Couturier, représentant du peuple,
envoyé par la Convention dans le département de Seine-et-Oise,
instruit l’Assemblée des progrès de la philosophie dans les
divers cantons qu’il a parcourus, et du mariage d’un grand nombre de prêtres
qui abjurent publiquement, à la grande satisfaction des citoyens,
[p. 101] toutes les idées superstitieuses dont ils avaient eu,
disent-ils, le malheur de se rendre les apôtres.
(Procès-verbaux de
la Convention, 24e volume.)
|
|
[112]
|
FIN OCTOBRE 1702.
Le frère Jean-André Foucquemberg,
barnabite à Étampes, mourut sur la fin d’octobre de cette
année, âgé de 99 ans 3 mois. Il se souvenait très-bien
de la mort d’Henry IV. Il conserva jusqu’à sa mort, sa mémoire
et son intelligence. Le Mercure galant, de novembre 1702, rapporte
qu’il travaillait encore au jardin, à la sacristie et à tout
ce qui regardait son état. Il cousait même sans lunettes et
à la simple lumière d’une chandelle. Toute sa vie il eut
une santé toujours bonne; il mourut des suites d’une chute. Il reçut
tous ses sacrements, et il rendit l’âme sans peine, sans douleur
et sans aucune convulsion.
|
|
[113]
|
4 NOVEMBRE 1792.
Envoi à la Monnaie, par les Administrateurs
et Procureur-Syndic du district d’Étampes, de l’argenterie provenant
de l’abbaye de la Joie-Villiers, la Congrégation d’Étampes
et Paroisses du district, pesée par les citoyens Hujo (sic)
et Enard, orfèvres, après en avoir séparé les
corps étrangers.
ABBAYE DE LA JOIE-VILLIERS. Une petite croix d’or pesant six gros. Un
soleil, un plateau, une petite croix sur son pied, deux ciboires, un calice
et trois patènes, un anse sur son pied et une plaque à jour,
pesant le tout ensemble en vermeil, 27 marcs 6 onces 4 gros, ci [p.102]
|
27 m
|
6 on
|
4 gr
|
Une lampe et ses chaînes, un encensoir, sa navette et sa cuillère,
une petite croix, deux couronnes, un cœur, quatre burettes et deux plats,
un bassin, deux calices, une boîte aux saintes huiles, un bénitier
et son manche, un petit ciboire, une coquille, le bout d’un goupillon,
un réchaud, des débris de chasse et reliquaire, une grande
croix et son bâton, une caffetière.une autre caffetière
plus petite, trois tasses à médecine, un petit chandelier,
trois gobelets, et trois écuelles, le tout en argent non doré,
et pesant 74 marcs 2 onces 4 gros, ci
|
72
|
2
|
4
|
MAISON DE LA CI-DEVANT CONGREGATION D’ÉTAMPES. Deux calices et
deux patènes, un plateau, un soleil, et un ciboire, le tout de
vermeil, et pesant 17 marcs 6 onces 1 gros, ci
|
17
|
6
|
1
|
Une lampe avec sa chaîne, quatre burettes et deux plats, un bénitier,
un encensoir, une navette et sa cuillère, quatre chandeliers, deux
croix, un calice, un ciboire et son couvercle, trois écuelles, une
tasse, un gobelet à pied, deux boîtes, une plaque, trois statues
représentant saint Augustin, saint Joseph et la Vierge, le tout d’argent,
et pesant 83 marcs
6 onces 7 gros, ci
|
83
|
6
|
7
|
FABRIQUE DE MONNERVILLE. Une croix de procession sans manche et deux burettes,
pesant ensemble 7 marcs 5
onces 6 gros, ci
|
7
|
5
|
6
|
TOTAL
|
211 m
|
3 on
|
6 gr
|
|
|
[114]
|
8 NOVEMBRE 1793 (18 BRUMAIRE
AN II)
Couturier adresse de Sogrès, au Comité
de Salut public, à Paris, une lettre pour l’informer du passage
à Étampes, de trois cent soixante-dix-neuf prisonniers [p. 103] arrêtés
à Sablé, département de la Sarthe, et dirigés
de Saumur sur Paris.
(Archives nationales,
AF II (142)
|
|
[156]
|
8 NOVEMBRE 1793 (du 18 du 2e mois de l’an II).
|
Voir
le n°156 (cliquez ici) dans le Supplément
en fin d’ouvrage.
|
[115]
|
9 NOVEMBRE 1793 (19
BRUMAIRE AN II).
Couturier, représentant du Peuple, en mission
a Étampes,
Rend à Segrès, commune de Favières-Défanatisé
(Saint-Sulpice-de-Favières),
Un arrêté par lequel:
«Prenant des mesures d’intérêt
et de salut public, pour confisquer le château de Mesnil-Voisin,
appartenant à Marie-Françoise Broglie, veuve de Charles-Joseph
Lignerac, âgée de soixante-dix-neuf ans.
«Ses héritiers sont:
«Lignerac, duc de Caynus;
«Et Lignerac, femme du comte de Rouget.
« … Outre, les sommes que les
sangsues intéressées (c’est ainsi que Couturier désigne
les héritiers présomptifs de Madame de Lignerac), peuvent
annuellement soutirer de la faiblesse d’une femme de quatre-vingts ans,
il y a à craindre que sa mort, que l’on peut juger très-prochaine,
ne soit cachée aux administrations et que la cupidité ne profite
de l’intervalle pour opérer des dilapidations.
«L’Administration municipale d’Étampes
est nommée tutrice de la citoyenne Broglie-Lignerac, pour les biens
qu’elle possède dans son arrondissement.»
(Archives nationales, AF
II (442.) [p. 104]
|
|
[116]
|
MÊME DATE
L’Administration régénérée
d’Etampcs, et l’ex-curé Charpentier, témoignent par une pétition
à la Convention nationale leur reconnaissance de lui avoir envoyé
le citoyen Couturier, montagnard.
«L’énergie, dit cette pétition,
est rendue au District; les prêtres se marient; les aristocrates
et les gens suspects sont arrêtés.»
|
|
[117]
|
10 NOVEMBRE 1793 (20 BRUMAIRE
AN II).
Couturier envoie des commissaires dans toutes
les paroisses du district d’Étampes, «pour recueîllir
l’argenterie des églises, les cloches, grilles de fer et autres
matières propres à la république.»
Il signale aux commissaires les paroisses suivantes:
Étampes, Milly, Maisse, Angerville, Saclas,
Fontaine, Méréville, Boissy-la-Rivière, Boissy-le-Sec,
Ormoy, Saint-Cyr, Monnerville, Bois-Herpin, Roinvilliers.
(Archives nationales).
|
|
[118]
|
13 ET 14 NOVEMBRE 1567.
L’armée royale, sous la conduite du duc
d’Anjou, frère du roi (Charles IX), alors âgé seulement
de quinze ans, assemblée entre Étampes et Saint-Mathurin-de-l’Archant,
part à la poursuite des Huguenots. Le maréchal de Brissac,
gouverneur de l’avant-garde du camp du roi, entra sans coup férir
à Montereau, que les Huguenots avaient abandonné.
(Mémoires
de Claude Haton, p. 498.) [p. 105]
|
|
[119]
|
13 NOVEMBRE 1794 (23 BRUMAIRE
AN III).
Un décret de la Convention porte que les
entrepreneurs qui achèteront des biens nationaux pour former le
canal d’Essonne, jouiront pour le paiement de leur prix des mêmes
avantages que les autres adjudicataires de pareils biens.
|
|
[120]
|
15 NOVEMBRE 1793 (25
BRUMAIRE AN II).
Couturier fait part à la Convention que:
«Ledoux, curé d’Etréchy, et
Bougault, prêtre, ont renoncé à leur état mensonger
et que leurs lettres de prêtrise ont été brûlées.»
|
|
[121]
|
16 NOVEMBRE 1793
(26 BRUMAIRE AN II ).
Arrêté par lequel Couturier enjoint
aux officiers de plusieurs communes des environs d’Étampes, de présenter
aux Municipalités un compte bien étendu de leur gestion.
(Archives nationales.)
|
|
[122]
|
17 NOVEMBRE 1793 (27
BRUMAIRE AN II).
Arrêté signé Couturier portant:
«Les Administrateurs des districts sont
autorisés à réduire les calices, Saints et autres
matières des églises, à leur juste valeur, en les
convertissant en lingots.»
|
|
[123]
|
18 NOVEMBRE 1793
(28 BRUMAIRE AN II).
Une députation de la commune d’Étampes,
annonce [p. 106] à la Convention l’arrivée de treize voitures chargées
de 51,035 livres de fer, cuivre, bronze et plomb qui bientôt seront
suivies d’autres.
(Procès-verbaux de
la Convention, t. XXV.)
|
|
[124]
|
19 NOVEMBRE 1793
(29 BRUMAIRE AN II).
Cochet, député du département
du Nord à la Convention, dépose sur le bureau de l’Assemblée
au nom de son fils, curé à Chamarande, les lettres de prêtrise
de celui-ci.
|
|
[125]
|
21 NOVEMBRE 1793 (1er
FRIMAIRE AN II).
Arrêté de Couturier d’après
lequel on ne pourra dorénavant établir des usines sur la
rivière d’Étampes, sans autorisation.
En outre, cet arrêté reproche «au
citoyen Dupré, imprimeur, d’avoir agi avec une noire méchanceté.»
|
|
[126]
|
24 NOVEMBRE 1793 (4
FRIMAIRE AN II).
Un arrêté de Couturier accorde une
indemnité à Nasson, procureur de la commune régénérée
(Étampes). —
(Archives nationales.)
|
|
[127]
|
24 NOVEMBRE 1794 [Lisez en fait: 25 novembre 1795 (B.M.)] (4 FRIMAIRE
AN IV).
L’Administration municipale
d’Étampes, représentée par Nasson, commissaire provisoire
du Directoire exécutif, Hochereau, président, Fruand, adjoint,
et Peteil, syndic, adresse une pétition aux Administrateurs du
[p. 107] département de Seine-et-Oise, au sujet du conflit qui
s’est élevé entre elle et les membres de l’ancien District,
pour l’attribution à la nouvelle Administration municipale de l’emplacement
nécessaire à ses réunions et du mobilier de l’ancien
District.
Bien que Ia pétition de l’Administration
municipale, dont nous possédons l’original, ne porte pas la date
de l’année, cette date peut être facilement suppléée.
On voit par cette pétition qu’il s’agit de l’installation de l’Administration
municipale d’Étampes, à la suite de la suppression des districts.
Les Administrations municipales ont été créées
par la Constitution du 22 août 1795 (5 frimaire an IV), qui a par
le fait supprimé les districts. La date exacte de cette pétition
peut donc être fixée au 24 novembre 1795 (4 frimaire an IV).
Une mention mise en marge de cette pétition indique que l’Administration
municipale a été invitée à ne disposer de
rien avant que le Ministre ait statué.
|
|
[128]
|
25 NOVEMBRE 1792.
Envoi à la Monnaie par les Administrateur
et Procureur syndic du District d’Étampes, d’objets d’argenterie
provenant des églises et des couvents.
Cet envoi comprenait:
|
CHALOU. Une croix d’argent, pesant |
27 m
|
6 on
|
4 gr
|
BOISSY-LE-SEC. Un calice
|
2
|
1
|
5
|
ÉGLISE SAINT-BASILE. Une croix, les feuilles couvrant le bâton
|
8
|
|
5
|
Deux chandeliers d’argent
|
7
|
4
|
6 ½
|
Deux encensoirs, une navette avec sa cuiller et sa chaîne
|
11
|
6
|
4
|
Une petite croix d’argent
|
2
|
|
6
|
Une croix d’argent en reliquaire
|
1
|
6
|
4 ½
|
Une
vierge d’argent
|
4
|
|
2 ½
|
Un saint Basile en vermeil
|
3
|
3
|
|
Deux
burettes et un plat d’argent
|
2
|
3
|
4
|
Une
tasse
|
1
|
1
|
2
|
VILLENEUVE-SUR-AUVERS. Un encensoir
|
3
|
2
|
4
|
Une croix sans manche
|
4
|
5
|
6
|
Et une paire de burettes d’argent
|
1
|
1
|
|
MOIGNY. Une lampe garnie de ses chaînes
|
4
|
|
2 ½
|
AUVERS. Une croix sans manche en sept morceaux et trois clous
|
5
|
6
|
3
|
MILLY. Argent écrasé et dont la pesée partielle a
été impossible. Une croix, les feuilles du bâton,
une boule, trois bouleaux plats, un petit crucifix, une plaque d’argent,
deux plaques rondes, un encensoir, son couvercle, ses quatre chaînes,
un bouton et trois anneaux, une navette à encens. une petite chaîne,
une petite cuiller, deux buttes, six cordons à baleine de bédeau,
une petite vierge et une petite fleur de lys. une petite
croix, un petit cœur, quatre chandeliers, une lampe garnie de
trois chaînes, de deux petites couronnes, dont une du ci-devant
Ordre de
Malthe, deux écuelles à quêter, le tout pesant
|
41
|
1
|
3
|
Une petite croix en or, pesant quatre-vingt-douze grains.
|
|
|
|
HOTEL-DIEU DE MILLY. Une écuelle à quêter
|
|
5
|
5
|
HOTEL-DIEU D’ÉTAMPES. Une lampe en argent
|
9
|
6
|
5
|
Une croix d’autel
|
11
|
4
|
|
Un encensoir, navette, cuillère et sa chaîne
|
4
|
5
|
7 ½
|
Un bénitier et goupillon, déduction faite de deux gros pour
le crin non ôté
|
5
|
1
|
4
|
Deux burettes et leur plat d’argent
|
3
|
|
|
Six chandeliers d’autel [p.109]
|
38
|
6
|
|
NOTRE-DAME D’ÉTAMPES.
Un encensoir, deux navettes avec deux cuillères attachées
par une petite chaîne
|
12
|
2
|
6
|
Une vierge
d’argent
|
7
|
6
|
5
|
Deux burettes
d’argent et leur plat
|
4
|
1
|
5
|
Une lampe d’argent
|
7
|
7
|
2
|
Trois tasses
|
4
|
3
|
3
|
Une jambe
|
5
|
3
|
7
|
Une croix de
vermeil
|
1
|
3
|
½
|
Plusieurs feuilles
d’argent, visses, écrous, goupilles couvrant et servant à
une chasse en bois
|
34
|
4
|
3½
|
Une croix d’autel,
déduction faite d’une once pour un morceau de fer greffé
dans une bosse de la croix
|
6
|
5
|
2
|
La garniture
de deux bras de saints
|
4
|
3
|
4½
|
Une petite
couronne en vermeil
|
|
5
|
5½
|
Une petite
couronne d’argent
|
|
1
|
4½
|
Une croix de
procession
|
11
|
|
2½
|
DANNEMOIS. Une
croix, pesant
|
4
|
1
|
5
|
SAINT-YON. Une
paire de burettes d’argent
|
1
|
3
|
4
|
VIDELLES. Une
croix
|
4
|
3
|
6
|
TOTAL
|
303 m
|
4 on
|
2 gr ½
|
|
|
[129]
|
27 NOVEMBRE 1793
(7 FRIMAIRE AN II).
Un arrêté signé: Couturier
et Gérosme, secrétaire,
Vu la pétition adressée au citoyen
Couturier, reprétant [sic] du Peuple
à Étampes, tendante à convertir l’église Saint-Gilles
en halle au blé;
«Autorise la commune de convertir l’église
en halle au blé.» [p.
110]
Dans cette pétition signée de douze
habitants d’Étampes, on lit:
«Il n’y a pas de halle au blé dans
la commune d’Étampes, quoiqu’il y ait un marché considérable.
Il existe dans cette commune attenant au marché au blé l’église
de la ci-devant paroisse Saint-Gilles, qui formerait une halle toute bâtie
puisqu’il ne s’agit que d’ouvrir les cintres qui sont autour des murs du
dehors de l’église...»
(Archives nationales.)
|
|
[130]
|
29 NOVEMBRE 1793 (9 FRIMAIRE
AN II).
Couturier prend un arrêté par lequel il
prescrit aux prêtres qui voudront jouir de la pension à laquelle
ont droit ceux qui auront renoncé à leur métier, de
faire inscrire dans trois jours leur acte de renonciation sur le registre
de la commune, «attendu que plusieurs prêtres, même de
ceux mariés, après avoir abdiqué leur métier
et brûlé leurs papiers, recommençaient leur charlatanisme
par des messes où ils attiraient les gens égarés et
simples.»
(Archives nationales.)
|
|
[131]
|
30 NOVEMBRE 1793 (10
FRIMAIRE AN II).
Charpentier, délégué de Couturier,
appose les scellés chez Aymard. Charles-Marie-Nicolaï, propriétaire
du domaine de Courances et autres.
(Archives nationales.)
|
|
[132]
|
DÉCEMBRE 1705.
Les chevaliers de la Compagnie royale de l’Arquebuse
d’Étampes donnent une fête en l’honneur du duc [p. 111] de Vendosme qui
était leur protecteur, à l’occasion de la victoire remportée
par le duc au combat de Cassano.
Le Mercure galant du mois de décembre
1705 donne de cette fête la description suivante:
«Les chevaliers de l’Arquebuse d’Étampes
s’assemblèrent dans l’hôtel de Vendosme pour résoudre
tous les préparatifs de cette feste et ils chargèrent de
l’exécution M. Rivet, leur commandant, dont ils connoissent le zèle
et l’affection. M. Rivet écrivit aussitost à M. l’archevesque
de Sens, pour obtenir la permission de faire chanter un Te Deum;
ce qu’il parut accorder avec beaucoup de joye. M. Crozat, intendant du conseil
de son altesse, marqua aussi son zèle, en permettant aux chevaliers,
la chasse sur les plaisirs du prince, la veille de cette réjouissance.
«On commença à trois heures
après-midy, par la publication de l’Ordonnance des Officiers; et
le soir, l’on fit battre les tambours et sonner toutes les cloches de
la ville. L’on dressa un feu à quatre faces, devant la porte de
l’hostel, où d’un costé M. de Vemdosme estoit représenté
poursuivant l’Armée des Alliez, avec ces mots: Fiat Angelus
persequens et coarctans eos, Ps. 34. On voyoit, d’un autre côté,
ce prince qui mettoit le feu dans les montagnes du Piémont, en les
touchant seulement avec une baguette; et tous les peuples qui, pour éviter
l’embrasement, montoient au sommet et sembloient se précipiter, avec
ces mots: Tange montes, et fumigabunt, Ps. 144. Quis se abscondet
à calore ejus, Ps. 18. On voyoit dans une autre face Monsieur
de Vendosme présentant au Roy divers peuples enchaînez, avec,
ces mots: Non timebo millia populi circumdantis me, Ps. 3. Omnia
subjecisti sub pedibus ejus, Ps. 8. Et la quatrième face représentoit
la Victoire, montrant au Roy les quatre saisons, avec ces mots: Regnum
tuum, regnum omnium sæculorum, P. 144.
[p.112] «Ce feu estoit terminé par une pyramide, aussi à
quatre faces, où estoient représentées toutes les
conquestes de son altesse en Italie, avec une renommée au-dessus.
«Tout l’édifice du feu estant ainsi
en état, la compagnie s’assembla à trois heures après-midy
à la porte de leur commandant, au nombre de cinquante chevaliers
tous sous les armes, proprement vêtus, tous leurs chapeaux estant
ornez de plumes blanches; ils se rendirent à la porte de M. Hochereau,
roy de l’oiseau, qui se mit à leur teste, et qui les conduisit à
la butte, où il fut tiré pour prix trois éguierres.
Ces prix estant tirez, la compagnie revint à l’hostel pour disposer
la marche. MM. les maire perpétuel et lieutenant général
de police marchaient à la teste, suivis de tous les officiels de
ville en robes noires, précédez de leurs hallebardiers et
de leurs bedeaux en robes rouges Ensuite de quoy, le roy de la compagnie
richement vêtu, avec ses officiers, l’es-ponton à la main,
le drapeau déployé et suivi de tous les chevaliers, chacun
selon son rang, entra dans l’église Nostre-Dame, au bruit de toute
l’artillerie, qui avoit esté conduite place de l’église, et
de trois décharges de mousqueterie. Le tour du chœur estoit illuminé
d’un très-grand nombre de lamperons; et le Te Deum fut chanté
en musique par le chapitre. Ce cantique fini, les tambours qui estoient
au milieu du chœur, donnèrent le signal, et l’artillerie fit encore
une décharge. La compagnie sortît dans le mesme ordre, et trouva
les fenestres des chevaliers et la porte de l’hostel toutes remplies de lumières,
que la nuit faisoit briller. M. Hochereau, roy, à la teste de ses
officiers, alluma le feu, pendant que la compagnie en faisoit le tour au
son des tambours, et au bruit des acclamations de Vive le Roy et Son Altesse,
du canon et des fauconneaux qui estoient dans les tours de l’hostel, des
boëtes, et de toute la mousqueterie. Cette décharge estant finie,
on [p. 113]
tira le feu dont l’artifice qui estoit nombreuse, fit tout l’effet qu’on
en pouvoit attendre et remplit toute la place où ce feu estoit dressé.
Après quoy, la compagnie fit encore une décharge et entra
dans l’hostel, où un souper magnifique estoit préparé
et où les santez du roy, des princes, de sa maison et de son altesse
furent souvent réitérées, au son des tambours. Le souper
fini, on commença le bal, où quantité de dames parurent
avec beaucoup d’éclat; et ce bal fut suivi d’une superbe collation;
et l’on peut dire que cette réjouissance a esté des mieux ordonnées
et des mieux exécutées. Ces chevaliers, en attendant quelques
nouvelles actions de leur prince, pour donner des marques plus éclatantes
de leur zèle, font faire des prières continuelles pour la
prospérité des armes de Sa Majesté.»
|
|
[133]
|
11 FRIMAIRE AN
II (1er DÉCEMBRE 1793).
Couturier envoie quatre gendarmes au château
de Villiers, pour s’emparer de la personne du comte de Selve.
Le comte de Selve n’ayant pas été
trouvé dans son château, le 13 frimaire suivant (3 décembre
1793), Couturier prend un arrêté d’après lequel:
«Ledit comte de Selve sera considéré
comme émigré s’il ne se présente pas dans l’espace
de dix jours et ses biens mis en séquestre.»
|
|
[134]
|
11 FRIMAIRE AN
II (1er DÉCEMBRE 1793).
Le citoyen Pierre Dolivier, ci devant curé
de Mauchamps, se plaint à la Convention d’avoir été
calomnié par le citoyen Couturier, commissaire à Étampes,
qui lui a reproché de s’être fait un mérite d’un argent
qui [p.114] ne lui appartenait pas, en offrant à la Convention
400 livres qui appartenaient à la fabrique.
|
|
[135]
|
13 FRIMAIRE AN
II (3 DÉCEMBRE l793)
Arrêté par lequel Couturier ordonne
rétablissement d’un chemin et d’autres travaux au pont des planches
et aux chemins de Saudreville et du Mesnil.
|
|
[136]
|
15 FRIMAIRE
AN II (5 DÊCEMBRE 1793).
Une lettre de Couturier prescrit des mesures
pour la vente du mobilier du château de Segrez, ayant appartenu
à Montulé, suspecté d’émigration.
|
|
[137]
|
15 FRIMAIRE AN II (5
DECEMBRE 1793).
Couturier informe la Convention que le 12 frimaire,
ses agents ont découvert dans la maison de l’émigré
Valory, une caisse renfermant 290 marcs d’argenterie.
(Archives nationales.)
|
|
[138]
|
6 DÉCEMBRE 1576.
Ouverture à Blois des États généraux,
convoqués par Henry III.
À la première séance on comptait
cent quatre députés de l’Eglise, soixante-douze de la Noblesse,
cent cinquante du Tiers-Etat.
Quand le Roi entra, toute l’Assemblée se
leva, la tête découverte, «et ceux du Tiers-Estat un
genoil en terre, jusqnes à ce que le Roy et les Royncs se furent
assis.» [p. 115]
«Toute l’Assemblée estoit fort attentive,
et avoient tous les yeux tournez vers le Roy, quand d’une bonne grâce,
parole ferme, haute et diserte;» il prononça sa harangue.
A cette séance assistaient les députés
du Bailliage d’Étampes, qui étaient:
Pour le Clergé, vénérable
maistre Artas le Long, chanoine de Notre-Dame d’Étampes;
Pour la Noblesse, le seigneur de Voussay;
Et pour le Tiers-Estat, maistre Jean Hony.
(L’Ordre des Estats tenus
à Bloys. Paris, Robert le Mangnier, 1577, in-4°.)
|
|
[139]
|
6 DECEMBRE 1664.
Nicolas Legendre, natif d’Étampes, est
admis à l’Académie de peinture et de sculpture. Il avait
présenté à cette Académie pour son sujet de
réception une Madeleine pénitente, en terre cuite. Déjà
il était juré de la maîtrise; l’année suivante,
dans l’Assemblée du 4 juillet 1665, il fut élu adjoint à
professeur à l’Ecole royale de sculpture. Il est mort en 1671, âgé
de cinquante-deux ans.
Nicolas Legendre avait étudié sous
un sculpteur très-médiocre et néanmoins au rapport
de Florent Lecomte (Cabinet des singularitez, etc.) il fut un des plus savants
artistes de son temps.
Quoique Nicolas Legendre soit mort encore jeune,
il a travaillé à la décoration d’un grand nombre de
monuments religieux ou d’édifices publics, et a laissé quantité
d’œuvres d’art, dont beaucoup sans doute sont perdues ou ont été
détruites.
M. de Chennevières a publié dans
les Mémoires inédits sur la vie et les ouvrages
des membres de l’Académie royale de peinture et de sculpture,
une notice sur [p. 116] Nicolas Legendre, écrite vers 1690, par Guillet de Saint-Georges,
à laquelle nous empruntons ce qui suit:
«Nicolas Legendre était issu d’une
très-honnête famille, et dès son enfance, il donna
des marques d’une très-sage éducation. Il montra de bonne
heure beaucoup de goût pour le dessin et la sculpture. Il se forma
lui-même et fut redevable de son talent à son travail.
|
|
|
«Les
premiers ouvrages qui le firent remarquer furent plusieurs statues de saint
Bruno dans différentes attitudes qu’il sculpta pour la Chartreuse
de Gaillon (1).
«Il travailla ensuite pour l’abbaye de
la Victoire de Senlis, puis, à Paris, il sculpta la porte du Collège
de la Marche.
«Une de ses œuvres les plus remarquées,
fut la sculpture des boiseries de l’église Saint-Paul à Paris,
qu’il embellit de bas-reliefs et de figures isolées.
A la porte du Couvent des Bénédictins
d’Issy, on voyait deux statues de pierre représentant, l’une saint
Benoît, et l’autre sainte Scholastique; toutes les deux étaient
dues au ciseau de Legendre.»
En outre, il avait orné:
En 1657, la façade de l’hôtel de
Béarnais, rue Saint -Antoine, de deux grandes figures d’anges;
En 1658, le portail du château de Meudon,
de quatre statues d’enfant;
Ce fut encore lui qui exécuta, en I659,
à Vaux-le-Vicomte, résidence du surintendant Fouquet, les
ornements de stuc qui décorent les plafonds des appartements;
Ce fut surtout pour l’église de Saint-Nicolas
du Chardonnet qu’il fit les ouvrages; les plus considérables, Legendre
orna de sculptures la façade de cette église sur la rue des
Bernardins, et à l’intérieur de l’église, il [p. 117] travailla à
la chapelle de la Vierge et à celle des Agonisans;
On cite encore de lui un fronton, représentant
la tempérance et la prudence, au Collège des Quatre-Nations;
Une sainte Radegonde, pour un couvent de Poitiers;
Deux renommées en bois sculpté,
pour la chambre du roi au Louvre;
Deux enfants, pour l’église Saint-Jacques-la-Boucherie;
Enfin, un saint Leu et saint Gilles, pour Étampes.
Nicolas Legendre était très-lié
avec Charles Lebrun, peintre du roi Louis XIV, auteur des tableaux, représentant
les batailles d’Alexandre. Ce fut à son amitié avec ce grand
peintre qu’il dut d’être chargé de travaux d’art au château
de Vaux et dans l’église Saint-Nicolas du Chardonnet.
Il fut enterré dans cette église
dans laquelle étaient les tombeaux de plusieurs grands personnages,
notamment celui de la mère de Lebrun et du président Jérôme
Bignon.
Legendre a été marié deux
fois et a laissé plusieurs enfants, dont l’un s’est fait connaître
aussi comme sculpteur.
Un de ses enfants avait été tenu à Maincy
sur les fonds de baptême par Charles Lebrun, comme représentant
le surintendant Fouquet.
On croit que sa première femme était
de Senlis; enfin, Nicolas Legendre figura au procès de Fouquet,
comme créancier opposant.
|
(1)
L’église de ce couvent et ses monuments furent entièrement
détruits par un incendie en 1761.
|
[140]
|
18 FRIMAIRE AN II (8
DÉCEMBRE 1793).
Procès-verbal, signé: Couturier,
Jérôme, Baron, Delisle, Seringe et Dibarast, receveur, çonstatant
l’envoi [p.118] à la Monnaie
de l’argenterie et des métaux précieux provenant des églises,
montant à environ 3,000 marcs argent et vermeil, et 15,000 livres
en pièces de monnaie et assignats.
(Archives nationales.)
|
|
[141]
|
6 DECEMBRE 1719.
«Décès de dame Marguerite
le Cordier du Tronc, abbesse de l’Abbaye royale de Villiers, Ordre de
Citeaux, proche La Ferté-Aleps. Madame du Tronc, étoit sœur
de M. le marquis de la Londe, de M. le marquis du Tronc, maréchal
des camps et armées du roi, et de madame de Savari, dont le mari
étoit grand-maître des eaux et forêts de Normandie;
elle étoit aussi nièce de feu M. Bontems, premier valet
de chambre du roi.»
(Nouveau Mercure, décembre
1719, p. 189.)
|
|
[142]
|
8 DECEMBRE 1793 (18 FRIMAIRE
AN II).
La Société populaire d’Étampes
fait passer à la Convention un arrêté qu’elle a pris
pour que l’église de cette commune soit régénérée
et devienne le Temple de la liaison triomphante, et qu’au milieu du temple,
il soit érigé un monument composé des attributs de
l’agriculture, des arts et métiers, surmonté des déesses
de la Liberté et de la Raison.
(Procès-verbaux
de la Convention, 27e volume.)
|
|
[143]
|
12 DECEMBRE 1793 (22 FRIMAIRE
AN II).
Le citoyen Boulence, officier municipal à
Étampes, informe la Convention qu’il vient d’être chargé
par le montagnard Couturier, de la conduite de 30 milliers de [p. 119] fer, provenant
des ci-devant domiciles de la superstition; c’est le troisième envoi
de cette nature, et quatre-vingts voitures sont déjà prêtes
à suivre la même destination.
«Le fanatisme, dit-il, existe encore à
Janville, près d’Étampes; il seroit à désirer
que le citoyen Couturier se rendît dans cette commune, pour y porter
l’esprit à la hauteur du règne de la Raison.»
(Proces-verbaux de la Convention,
même volume.)
|
|
[144]
|
11 DECEMBRE 1794 (21
FRIMAIRE AN III).
Le Comité de Législation de la Convention
présente, pour former l’Administration du District d’Étampes,
les citoyens dont les noms suivent:
Président:
Gérosme, ancien épicier;
Directoire:
Nasson, expert-écrivain,
agent national de la commune d’Étampes;
Carqueville, agent national
de la commune de Lardy;
Gudin jeune, ci-devant homme
de loi, commis de l’Administration du District;
Dergny, apothicaire à
Étampes;
Agent national:
Crosnier, secrétaire
de l’Administration du District;
Conseil général:
Raymond, marchand de mousseline,
ex-chef de Légion;
Mesnard, cultivateur à
Boissy-sous-la-Montagne, ci-devant Saint-Yon;
Bourgeois fils, de La Ferté-Aleps;
Levasseur, géomètre
à Milly; [p.120]
Durand-Lalande, aubergiste
à Étampes, ancien notable;
Goudion, arpenteur, canton
de La Ferté-Aleps;
Chachignon, huissier à
Milly.
(Procès-verbaux
de la Convention, 51e volume.)
|
|
[145]
|
13 DÉCEMBRE 1859.
M. Frédéric DUBOIS, d’Amiens, secrétaire
perpétuel de l’Académie de médecine, prononce dans
la séance publique annuelle de ce jour, l’éloge d’Etienne
Geoffroy Saint-Hilaire.
Cet éloge a été imprimé
dans les Mémoires de l’Académie de Médecine,
tome XXIV. Il en a été aussi tiré quelques exemplaires
en brochure, in-4°, de 32 pages.
Précédemment dans la séance
publique annuelle du 22 mars 1852, M. Flourens, secrétaire perpétuel
de l’Académie des sciences, avait prononcé l’éloge
historique de notre illustre compatriote. (Brochure, in-4°, de 24 pages,
1852).
|
|
[146]
|
23 FRIMAIRE
AN XI (14 DÉCEMBRE 1802).
Le 23 frimaire au XI, les ecclésiastiques
de l’arrondissement d’Étampes, convoqués par les ordres du
Préfet de Seine-et-Oise, après une messe solennelle célébrée
par M. le curé de Notre-Dame, prêtent dans cette église,
entre les mains de M. Hénin, alors sous-préfet d’Étampes,
délégué à cet effet, et en présence
des autorités civiles, militaires et judiciaires de la ville, sur
les Saints Evangiles et chacun séparément, le serment préscrit
par l’art. 27 de la Convention, arrêtée le 23 fructidor [p. 121] an IX (10 septembre
1801), entre le Gouvernement français et le pape Pie VII.
Ce serment était ainsi conçu:
«Je jure et promets à Dieu, sur les
Saints Evangiles de garder obéissance et fidélité
au Gouvernement établi par la Constitution de la République
Française. Je promets aussi de n’avoir aucune intelligence, de n’assister
à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit
au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et
si dans ma Paroisse ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose au
préjudice de l’Etat, je le ferai savoir au Gouvernement.»
Voici la liste des ecclésiastiques qui ont prêté
serment dans cette réunion, avec l’indication des paroisses où
ils devaient exercer leur ministère:
Auger, Jean, desservant, Saint-Basile
d’Étampes;
Beaunier, Michel-Augustin, id., Saint-Maurice;
Henry, Honoré, id., le Val-Saint-Germain;
Vejux, Etienne, vicaire, Notre-Dame d’Étampes;
Leroy, Charles-Dominique, desservant, Videlles;
Filleau, Jacques, id., Boutigny;
Lambert, Pierre-Louis-Benjamin, id., Corbreux;
Prieur, Pierre, id., Abbéville-Arrancourt;
Boulloy, Claude-Antoine, aumônier, Hospice d’Étampes;
Delaville, Marin, desservant, Saclas;
Boutin, Gérard, id., Buno-Bonnevaux;
Moutié, François, id., Bullion;
Bidault, Louis, attaché à Saint-Basile d’Étampes;
Travers, Etienne, desservant, Guillerval;
Daage, François-Arnouph, id., Chamarande;
Porchon, Jean, id, Torfou;
Rigault, Jean-Claude, id., Saint-Martin d’Étampes;
Devaux. Louis, id. Saint Gilles d’Étampes; [p.122]
Mailhat, Hubert-Marie-Silvestre, id., Chalo-St-Mard;
Lhomme, Michel, id., Sermaise;
Gibier, Jacques, amateur desservant, pour un an, Notre-Dame d’Étampes.
|
|
[147]
|
15 DÉCEMBRE 1789
MM. Jean Hême de la Maison-Rouge, échevin,
Jean-Gabriel Baudry de la Potterie, conseiller assesseur, Jacques Crosnier,
substitut du procureur du roi au bailliage d’Étampes, officiers
préposés à la recette de l’argenterie, et Désiré-Jean-Chrétien
Hugo, orfèvre vérificateur, nommés, par délibération
du Corps municipal, envoient au Directeur des monnaies à Paris,
une caisse contenant 78 marcs 2 onces 3 gros d’argenterie, produisant en
argent 4,231 livres 7 sols 11 deniers, consistant en bijoux, vaisselle
d’argent, et argenterie d’églises, déposés à
l’Hôtel-de-Ville d’Étampes, en exécution du décret
de l’Assemblée nationale du 6 octobre 1789, du 11 au 15 décembre.
Ces objets avaient été déposés,
savoir:
Par M. Picart, maire;
Par M. Geoffroy, conseiller;
Par M. de Tressan, abbé de
Morigny, l’argenterie provenant de la chapelle, qui suit:
Une figure représentant saint
Biaise;
Une croix d’autel garnie de son christ;
Un soleil de vermeil;
Un calice et sa patène;
Une coupe de calice dont la lige,
le pied et la patène se sont trouvés être de cuivre
rouge doré;
Par M. Boncerf, archidiacre de l’église
de Narbonne, un plat ovale, deux plats ronds et d’autres objets d’argenterie;
[p.123]
Par M. Boncerf, conseiller, médecin
ordinaire du roi, deux flambeaux garnis et d’autres objets;
M. Gabaille, procureur du roi au
bailliage, deux flambeaux, deux jattes, une écuelle et d’autres
objets;
Mademoiselle Gallier, bourgeoise,
une écuelle, un sucrier et d’autres objets.
|
|
[148]
|
16 DÉCEMBRE 1789.
Second envoi à la Monnaie à Paris,
d’une caisse contenant 43 marcs 7 onces 4 gros et 1/2 d’argenterie, produisant
en argent 2,357 livres 10 sols 4 deniers, et provenant de:
M. Guyon, procureur au bailliage,
receveur de la ville et chargé par intérim de la subdélégation
d’Étampes;
M. Lanon, bourgeois d’Étampes;
M, de Bouraitie, conseiller, secrétaire
du roi, receveur particulier des finances à Étampes;
Et M. de Leyre, secrétaire
de l’infant duc de Parme.
|
|
[149]
|
19 DÉCEMBRE 1791.
Le Receveur syndic du Directoire du District d’Étampes
adresse à Palloy une expédition de la délibération
du Directoire de ce jour, fixant le jour où se fera l’ouverture
de la caisse renfermant la pierre de la Bastille, dont Palloy lui a fait
hommage et il l’invite à assister à la cérémonie,
l’assurant de la satisfaction qu’éprouvera le Directoire.
Voici le texte de la délibération:
EXTRAIT du registre des délibérations
du Directoire du District d’Étampes, du 19 décembre 1791.
[p.124]
Monsieur le Procureur syndic a dit:
Messieurs,
Je vous ay fait part de la lettre que M.
Palloy m’a écrite, le trois de ce mois, sur laquelle le Directoire
a arrêté qu’il recevroit avec satisfaction la Pierre dont
il lui fait l’hommage venant
des cachots de la Bastille, dans laquelle se trouve le plan de
cette cy-devant forteresse.
M. Palloy m’a annoncé par une lettre
postérieure dattée du 12, que cette Pierre avoit été
conduite à Orléans par erreur, et il m’a prié de vous
témoigner ses regrets de ne pouvoir assister à l’ouverture
de la caisse qui la renferme.
Cette caisse est parvenue au Directoire le
16, et d’après ce qui m’a été dit par le parent du
sieur Remond, à l’adresse duquel elle étoit, que le sieur
Hénault qui s’étoit déjà présenté
devant le Directoire, viendroit incessamment pour être présent
à l’ouverture, vous avés crus, Messieurs, devoir la suspendre.
Il y a lieu de croire aujourd’huy, que M.
Hénault ne viendra point; je pense donc, Messieurs, que le
Directoire doit s’empresser de faire connoître à M. Palloy
sa reconnoissance et satisfaire la curiosité des Patriotes, des vrais
amis de la constitution et de notre liberté, en indiquant le jour
que 1a caisse sera ouverte et en arrestant le cérémonial qu’il
croira devoir être observé en pareil cas et être dû
au civisme et au patriotisme de M. Palloy.
Sur quoi le Directoire arrête que le
mardi vingt-sept décembre présent mois, dix heures du matin,
il sera fait ouverture de la caisse renfermant la pierre dont il s’agit;
laquelle sera placée dans un lieu apparent de la salle où
le Directoire tient ses séances; que MM. les membres du Conseil
du District, MM. les officiers municipaux et procureurs des communes de
son arrondissement, MM. les juges et commissaires du Roy du tribunal, MM.
les juges de paix de cette ville et des cantons, seront invités de
s’y trouver et se rendre pour cet effet en la salle du Directoire, et que
M. le commandant de la garde nationale sera invité de s’y trouver
avec tel nombre d’officiers et gardes nationaux qu’il jugera convenable.
ARRÊTE en conséquence que les
lettres d’invitations seront imprimées et envoyées dans
le plus bref délai par M. le Procureur syndic;
Comme aussy qu’expédition de la présente
délibération sera adressée dans le jour à M.
Pallois, qui est invité de vouloir bien faire ses efforts pour pouvoir
se rendre auprès du Directoire, les jour et heure cy-dessus indiqués.
Pour expédition, signé: CHARPENTIER,
président, GROSNIER [sic],
secrétaire. [p.125]
C’est à N. Pallloy, architecte-entrepreneur
de son état, qu’avait été confié la démolition
de la Bastille:gloire inigne qui lui tourna la tête et influa sur
toute sa destinée. Palloy s’acquitta de la tâche comme d’un
sacerdoce. Bien que les historiens l’aient à peine nommé,
il occupe une place remarquable dans l’Histoire de la Révolution.
Il remplit un des rôles comiques du drame, il représente le côté
niaisement enthousiaste de l’époque, il est le type de l’entrain révolutionnaire.
Pour démolir la Bastille, ce maçon
négligea ses propres travaux, et employa tous ses ouvriers à
l’accomplissement de la grande œuvre, qui, par là, devint très-coûteuse.
Elle commença le lendemain de la prise, et dura jusqu’au 21 mai
1790, c’est-à-dire près d’une
année.
La démolition achevée, Palloy
garda avec soin les chaînes, la serrurerie et les pierres de la Bastille.
Il purifia les chaînes par le feu, et fit frapper avec pour 4,200
livres de médailles de fer et d’autres en cuivre et en plomb. Quant
aux pierres, il en rassembla une collection dans son chantier de la rue
des Fossés-Saint-Bernard, et il en fit des distributions pendant
plusieurs années. Avec des pierres provenant de la démolition
de la Bastille, il fabriqua des bornes-frontières,
qui devaient être placées aux extrémités du territoire
de la liberté; ou bien encore des bustes de J.-J. Rousseau et de Mirabeau,
sculptés en relief, et quatre vingt-trois petits modèles de
la Bastille, offerts par lui et par ses apôtres aux quatre-vingt-trois
départements de la France. Enfin, il confectionna des plans de cette
prion, mis sous verre, encadrés, et qu’il envoya à tous les
districts, aux îles et aux colonies, aux cantons, aux communes rurales,
aux sections, etc. Palloy se créa ainsi une spécialité.
(Augustin Challamel, Histoire-musée de la République Française.)
Palloy avait voulu, il paraît, donner
au District d’Étampes, [p.
126], une marque spéciale de sa considération,
il l’avait assimilé aux départements, et à l’envoi
du plan de la Bastille, il avait joint relui d’une pierre provenant de la
démolition de cette prison. Que sont devenus la pierre et le plan
envoyés par Palloy? — Nous n’avons pas pu le découvrir, ce
sont là deux objets qui auraient aujourd’hui leur place marquée
dans le Musée de la ville.
|
|
[150]
|
29 FRIMAIRE AN III (19
DÉCEMBRE 1794)
Les membres de la Société populaire
de Bonne-Commune ci-devant Chamarande, offrent à
la Convention l’hommage de leur reconnaissance pour ses travaux depuis
le 9 thermidor; ils sollicitent une loi qui interdise l’entrée de
la Société populaire aux fonctionnaires publics, afin que les
autorités constituées ne puissent plus influencer le peuple.
(Procès-verbaux de
la Convention, t. 51)
|
|
[151]
|
26 DECEMBRE 1740.
La Sœur de Reconseil, de la Congrégation
Notre-Dame d’Étampes, meurt âgée de soixante-seize
ans, après avoir déclaré sa soumission à la
bulle Unigenitus et au nouveau catéchisme.
|
|
[152]
|
1190.
Philippe-Auguste casse la commune
d’Étampes.
(Léopold Delisle,
n°571)
M. Léopold Delisle, en rapportant cet acte
de rigueur, dit: [p. 127]
La commune d’Étampes n’est guère
connue que par l’acte qui l’a supprimée; il cite sous le u°
434, un acte du même roi, de février 1195, faisant défense
à la commune d’Étampes de recevoir les hommes de corps (les
Serfs) de l’église Sainte-Croix d’Orléans, et il semhle
disposé à penser que la mesure prise contre la commune d’Étampes,
avait été motivée par des infractions à cette
défense.
|
|
|
SUPPLÉMENT.
|
|
[153]
|
6 AOÛT 1793
(AN II [Lisez en fait: An I (B.M.)] DE LA
RÉPUBLIQUE).
Nous, Maire et officiers municipaux administrateurs
au département des subsistances des commune et district de Paris,
dépositaires des expéditions originales des deux décrets
de la Convention Nationale des 1er juillet et 5 du même mois 1793,
à nous délivrées les 2 et 6 du présent mois,
déclarons et certifions, qu’attendu le besoin urgent où est
la commune de Paris de subsistances, le citoyen Pierre-Joseph Mainfroy, marchand
farinier, demeurant à Étampes, paroisse Saint-Gilles, district
d’Étampes, a été autorisé par nous, ainsi que
le premier desdits décrets nous en donne la faculté, à
acheter de différents laboureurs, fermiers, cultivateurs, marchands
meuniers et fariniers des cantons et districts des départements de
Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise, Eure-et-Loir, Loiret et Loire, et autres
départements circonvoisins, la quantité de blé et farine
qu’il pourra trouver à acheter dans lesdits lieux, lesquels blés
et farines il se propose d’envoyer de suite à Paris, soit dans les
magasins de la commune, soit chez les [p. 128] boulangers où à
la halle de cette cité; en conséquence, nous invitons nos frères
des communes, districts et départements sur le terroir desquels se
fera l’expédition et le transport de la quantité de grains
et farine, à le protéger et favoriser de tout leur pouvoir,
à la charge, par le citoyen sus-nommé, de faire la déclaration
prescrite et de prendre un acquit à caution, conformément au
décret du 4 mai dernier. — Fait en la maison commune de Paris, le
6 août 1793, an II de la République une et indivisible — Signé:
PACHE, maire; GARIN et DE SAVANNE.
|
|
[154]
|
9 SEPTEMBRE 1690.
CLAUDE BOICHOT, bourgeois de Paris, procureur
de très-révérende dame Marie LAMBERT DE THORIGNY, religieuse
professe de l’ordre de Citeaux, prend possession de l’abbaye royale de
Villiers, près La Ferté-Alais.
L’an mil six cens quatre-vingt-dix, le neufiesme
jour de septembre, avant midy, en la presance de moy Mire Jacques Louvet,
prestre chanoine de Sainte-Croix d’Étampes, chapelain administrateur
de Bouray, y demeurant, nottaire apostolique au diocèse de Sens,
estant de présent en l’abbaye royalle de Nostre-Dame de Villiers,
prés La Ferté-Alais, ordre de Citaux. assisté de Me
Paul Duchesne, l’ainé, nottaire royal résidant aud. lieu
de La Ferté-Alais et des témoings cy-après nommés,
Me Claude Boichot, bourgeois de Paris, y demeurant, vieille rue du Temple,
paroisse Sainct-Paul, de présent en lad. abbaye de Nostre-Dame de
Villiers, a comparu au nom et comme procureur de très-révérende
dame Marie Lambert de Thorigny, religieuse professe de l’ordre de Citeaux
et pourvue en cour de Rome de laditte abbaye royalle de Villiers du dit ordre
de Citeaux, diocèse de Sens, comme vaccante par le décez de
dame Anne-Dorothée Dargouges de Rannes, dernière paisible possessice
abbesse de lad. abbaye, fondé de procuration de ladite dame Lambert
de Thorigny, spécialle à l’effet des présentes passée
par devant Moussinet et Batellier, nottaires apostoliques à Paris,
lé quatriesme du present mois et nan, laquelle led. Boichot, procureur,
a représenté pour estre et demeurer annexée au present
acte, s’est transporté en lad. abbaye Nostre-Dame de Villiers
où [p. 129] estant en vertu tant des bulles de provision de lad. abbaye accordées
par nostre Sainct-Père le pape Alexandre huitiesme, à présent
séant, à lad. dame Lambert de Thorigny, données à
Rome à Saincte-Marie-Majeure, l’an de l’Incarnation de Nostre-Seigneur
mil six cens quatre-vingt-dix, la veille des calendes d’avril, l’an premier
du Pontiticat de nostre dit Sainct-Père, deument expédiées
et veriffiées que de la sentence de fulmination délivrée
sur lesd. bulles par Monsieur l’Official de Paris, l’un des commissaires
apostoliques desnommez exprez en datte dud. jour, quatriesme des présent
mois et an. signée Cheron et plus bas Batellier et scellée.
Et estant entré dans l’église de lad. aabaye après avoir
faict nos prières devant le St Sacrement au
grand autel à genoux, par la libre entrée que nous
a trouvée dans lad. église et baise main du chantre, led.
procureur au nom de lad. dame Lambert de Thorigny, après le Veni
Creator chanté, s’est présenté à la
grille du couvent ouverte ou estoient révérande dame
Angélique Dargouges, prieure de lad. abbaye, dame Marie Sauget...
et maistresse des Novices, dame Geneviève Chassebras, présidente
et procuratrice, dame Magdelaine Cappe, dame Jeanne Dubois, secrétaire
et les... (autres?) dames d’icelle abbaye assemblée, nous a requis
de faire la lecture desd. bulles, sentence de fulmination d’icelles après
lesquelles lecture et publications faittes à haulte et intelligible
voix desd. bulles, sentence de fulmination et procuration, après
quoy led. Boichot au nom de procureur de lad. dame Lambert a pris en la
présence et du consentement desd. dame prieure et religieuses qui
l’ont agrée et approuvé, la possession corporelle, réelle
et actuelle de lad. abbaye royalle Nostre-Dame de Villiers de La Ferté-Alais
et de ses droicts, revenus, profficts, émoluments, circonstances,
appartenances et dépendances généralement quelconques
et estant entré dans l’intérieur d’ficelle abbaye pris séance
en la place affectée à lad. dame abbesse au cœur d’icelle
et de là au chapitre et sonné les cloches de lad. abbaye et
par toutes les autres cérémonies en tel cas requises et accoustumées
à laquelle prise de possession aucunes personnes ne s’est opposé.
Et de tout ce que dessus led. Boichot aud. nom de procureur a requis acte
à luy par moy susdit nottaire apostolique assisté dud. Me
Paul Duchesne, nottaire royal, octroyé pour servir et valloir à
lad. dame Lambert de Thorigny en temps et lieu et que est raison et a esté
lad. procuration paraphée ne varietur par led. Boichot aud. nom et
moy nottaire apostolique susd. et soussigné et dud. Sr Duchesne.
Ce fut ainsy fait dans ladite abboye de Villiers,
les an et jour susdicts, ès-presence de domp Anthoine Gentil, bachelier
en théologie, religieux de l’ordre Saint-Bernard, directeur desd.
dames, demeurant en lad. abbaye. Me... Thierriat, prestre curé de
Cerny, y demeurant, Me Estienne Sevard, prestre de pnt, demeurant
[p.130] à
Bouret, et…et… demeurant dans lad. abbaye, tesmoins.
Signé: Boichot.— Sr Angélique D’Argouge,
prieure. — Sr Marie Saulger. — Sr Geneviève Chassebras. — Sr Marguerite
Rossy. — Sr Anne Chassebras. — Sr Gabrielle de Gourmont. — Sr Magdeleine
Ringuet. — Sr Geneviève Bagereau. — Sr Marie Ferret. — Sr Jeâne
Loir. — Sr Charlolte le Boucher. — Sr Marie Fournier. — Sr Marie de Savary.
— Sr Gabrielle Boucheron. — Sr Magdeleine Cappe. — Sr Gillette Ferret. —
Sr Marie de Cherlin. — Sr Antoinette Chassebras. — Sr Jeanne Dubois. — Sr
Antoinette Cherre. — Sr Marie Roustier. — Sr Magdeleine Berthelot. — Sr
Catherine Ferret. — Sr Marie le… — Sr Anne Nicolas. — Sr Françoise
Nicolas. — Sr Françoise ... Stornat. — Sr Charlotte D’Argouges. — Sr
Marguerite Ingrain. — Sr Marguerite Aleps. — Sr Louise Fontaine. — Sr Marguerite
Lefebvre de Chamblin.
F.-Ant. Gentil, confesseur et directeur. — Thierriat,
curé de Cerny. — E. Sevard. — Prudent Guillard de Baulieu. — Boichot.
—Duchesne. —J. Louvet, notaire apostolique.
L’original de ce singulier procès-verbal
et celui de la procuration donnée à Maître Claude
Boichot sont en notre possession; ces pièces ont été
publiées une première fois dans l’Abeille d’Étampes
du 22 mars 1873.
|
|
[155]
|
23 OCTOBRE 1793 (2 BRUMAIRE
AN II).
Extrait du registre des délibérations
de la municipalité d’Angerville-la-Gâte:
Au nom de la Loi:
Le second jour de la première décade
du second mois de l’an deux de la République française une
et indivisible, à Angerville, chef-lieu de canton du district d’Étampes,
département de Seine-et-Oise. [p. 131]
Moi, Jean-Pierre Couturier, représentant
du peuple, l’un des membres de la commission repartie par la Contention
Nationale, pour la surveillance à la vente des effets de la liste
civile et particulièrement délégué par mess collègues
pour opérer la régénération révolutionnaire
des autorités constituées, en excution du décret du
23 août dernier, et ce, d’après les avis réitérés
donnés à ladite commission, par les citoiens patriotes des
sociétés populaires et administratives du district, sur la
nécessité urgente de cette régénération,
partout où besoin sera et au vu de l’urgence des mesures de salut
public, que l’affaiblissement de l’esprit républicain indique et
que la malveillance des ennemis déguisés en patriotes, commande
impérieusement, me suis rendu en ladite ville, accompagné
des citoiens Charpentier, administrateur du district du departement de
Seine-et-Oise, Raguideau, administrateur du district de Dourdan, tous
deux secrétaires, Jérôme, président, et Baron
Delisle, procureur-syndic du district d’Étampes, Sergent-Loslier,
commissaire national près le tribunal du district, Gilot et Sureau,
juges de paix de la ville et du canton d’Étampes, Brou et Becus,
officiers municipaux d’Étampes, ainsi que d’un détachement
de la garde nationale d’Étampes qui m’a déclaré ne
vouloir me quitter qu’après que je serais rendu à mon poste,
à la Convention Nationale, où, après avoir consulté
des membres de la société populaire et du conseil général
de la commune jouissant de toute la réputation de bons républicains,
je me suis procuré une liste de candidats, qui a été
discutée devant moi, ce fait, j’ai requis le procureur de la commune
de faire convoquer le conseil général et les citoiens de
la ville, dans l’église paroissiale, pour cejourd’hui, huit heures
du soir, ce qui aiant eu lieu, j’ai fait donner lecture de la liste des
citoiens qui sont sortis du scrutin épuratoire et en ai soumis le
résultat à la censure de l’assemblée, à laquelle
j’ai déclaré la destitution du conseil général,
celle de la juridiction de paix et du comité de surveillance, en
observant que cette destitution révolutionnaire n’était faite
que comme mesure de sûreté générale, sans qu’elle
puisse être envisagée comme un motif de suspicion contre les
membres qui n’auraient pas été conservés, sauf la
surveillance du comité et l’application de la Loi, dans le cas de
droit, et de suite, j’ai procédé à la création
et réorganisation nouvelle, révolutionnairement faite, desdites
autorités, de la manière suivante:
MUNICIPALITÉ
Les citoiens: Charles Léger, maire, Jean-Charles
Lagesse, procureur de la commune; — Grégoire Damon, Alexandre Jousset,
Dubois fils, Jean Pichard, Dauvilliers fils, officiers municipaux; — Conseil:
Jean-Baptiste Goujon, Savouré père, Claude Losne père,
Jean-Baptiste Courtois, Rousseau, épicier, Léger le jeune,
Eutrope Montigny, Michel David père, bonnetier, Jean-Joseph Cochia,
Charles Jousset, François Friteau, cabaretier, Charles Mousset,
Tessier, notaire, secrétaire-greffier; — Juridiction de paix: Louis
- Georges Chartrain, juge de paix, Etienne Hardy, greffier; — Dubois père,
Savouré père, Louis-Lubin Bertrand, Pierre-Eutrope Montigny,
assesseurs de la ville; — Comité de surveillance: Jean Charles Lagesse,
limonadier, Alexandre Jousset, Bruère, cordonnier, Charless Mousset,
Charles Jousset, Dauvilliers fils, Michel Vauxelle, François Pailleau,
Thiercelin fils, Isidore Tournemine, Rautrus Fontaine, ci-devant nommé
Roy, Jean-Baptiste Goujon. Société populaire. — Sur ce qui
m’a été représenté par les membres composant
la liste ci-dessus, que la société populaire de cette ville
venait nouvellement d’être établie, qu’elle n’était
composée que de dix-sept [p.
132] membres, bons sans-culottes, et qne trente-un
candidats étaient enregistrés pour être admis au nombre
des sociétaires, j’ai, en conséquence, arrêté qu’ils
ne pourront être reçus qu’après un scrutin épuratoire
et que, dans tous les cas, les prêtres non mariés, ni révolutionnairement
élus fonctionnaires publics, non plus que les ex-nobles et leurs
agents, ne pourront êre admis, et qu’enfin il sera fait un règlement
pour la police intérieure de ladite société.
A la fois, j’ai installé les membres composant
le Conseil général de la commune, de la juridiction de paix
et de comité de surveillance, et commandé, an nom de la Loi,
à tous citoiens de les reconnaître, chacun en droit soi,
et d’être soumis à tous les actes émanés de
leur autorité; en conséquence, lesdits membres se sont présentés
au bureau et ont prêté le serment de maintenir la liberté
et l’égalité ou de mourir a leur poste en les défendant,
et j’ai arrêté que ceux des membres absents prêteront
le même serment, chacun devant son corps respectif, et j’ai expressément
recommandé aux fonctionnaires publics la plus grande exactitude
dans la rentrée des contributions, de surveiller les malveillants
et même les cultivateurs récalcitrants avec la plus grande
sévérité, même de les mettre en état
d’arrestation, suivant l’exigence des cas, ainsi qu’il en sera usé
par le Comité de surveillance envers 1es hommes suspects, d’exécuter
les lois, notamment celles relatives au transport de la matière
dea cloches, au district, pour être convertie en canons, à
l’effet de foudroyer une bonne fois les ennemis de la liberté et
de l’égalité, comme aussi du transport de l’argenterie de
l’église, si ce n’est fait; et attendu que dans plusieurs communes,
il ne se trouve pas assez de citoyens pour la formation des comités
de surveillance, on qu’ils n’ont pa s assez d’énergie pour mettre
en état d’arrestation les hypocrites, les faux patriotes et autres
hommes suspects, j’ai autorisé 1e comité de surveillance
de cette ville à suppléer en cas de besoin les fonctionnaires
des comités négligents ou faibles, dans lonte l’étendue
du canton, et vu les bonnes dispositions manifestées par les membres
du cloub [sic] naissant en cette ville, je
prie la société populaire séant aux Jacobins de Paris,
de s’affilier, à l’effet de quoi, expédition du présent
arrêté lui sera adressée, à la diligence du
président de la société, et une autre expédition
à la Convention Nationale, à la diligence du procoreur de
la commune, notamment pour lui manifester les vœux et désir de toute
l’assemblée pour qu’elle reste stable a son poste, jusqu’à
ce qu’elle aura consolidé le grand ouvrage qu’elle a si glorieusement
commencé.
Fait et clos les jour, mois et an avant dits;
et ont les citoyens Charpentier et Raguideau, secrétaires, les citoyens
assistants dénommés en tête et les membres des autorités
constituées, signé aux moi, lecture faite au milieu des applaudissements
et des cris réitérés: Vive la République! Vive
la Montagne! Périssent les tyrans! La Liberté ou la mort!
Signé: Couturier, Raguideau, secrétaire;
Charpentier, secrétaire; Gillol, Sureau fils, Jérôme
Alexandre, [p.133]
Becus, Brou, Baron-Delisle, Sergent,
Joussel Alexandre, Léger, Bonneau, Lagesse, Chartrain.
Et pendant que les membres signaient, un membre
a proposé de livrer aux flammes le Drapeau de la garde, qu’il a
dénoncé être d’un fond blanc et avoir porté des
fleurs de Lis, et que cette garde avait reçu d’un français,
émigré depuis. L’Assemblée a accueilli cette motion
avec le plus vif enthousiasme, et le Drapeau a élé brûlé
hors la ville, après avoir été traîné
dans la fange et foulé aux pieds, au milieu des cris de: Vive la
République! Vive la Montagne! Périssent les traîtres
et leurs dons empoisonnés!
Signé: Tessier. Dubois, Richard, Hardy,
Goujon-Savouré, L. Thiercelin, Ch Jousset, M Vauzelle, Dauvilliers
fils. Ch. Mousset, Damon, Savouré, Tournemine, Fritteau, Courtois,
David, Pailleau, Montigny. Charpentier, Raguideau, Couturier.
|
|
[156]
|
8 NOVEMBRE 1793 (du 18
du 2e mois de l’an II).
Les habitants d’Angerville, à la nouvelle
de l’arrestation opérée la veille dans son château de
Méréville du marquis de Laborde, adressent la pétition
suivante au Comité de sûreté générale
â Paris:
«Citoyens,
«L’arrestation du citoyen Laborde, en sa
maison de Méréville canton d’Angerville, district d’Étampes,
département de Seine-et-Oise, qui s’est effectuée le jour
d’hier, a répandu l’alarme et la consternation dons les cœurs de
touss les habitants de cette commune. Cet événement malheureux
nous enlève tout à la fois un père, un amy, un bienfaiteur
et le modèle le plus parfait des vertus républicaines; ses
sentiments pour nous furent toujours les mêmes; l’orgueil, l’ostentation,
la dureté qui marchent presque toujours à la suite de l’opulence
et des grandes richesses, lui furent inconnus. La veuve et l’orphelin,
le pauvre et l’indigent trouvèrent en tous temps l’accès le
plus facile auprès de lui, et les secours les plus prompts et les
plus abondans. Soulager l’humanité souffrante, essuyer les larmes
des affligés, firent ses plus [p. 134] chères délices. C’est
avec attendrissement, citoyens, que nous vous rappelons ses vertus civiques,
et les bienfaits qu’il se plut à répandre sur nous avant l’époque
de la Révolution, comme depuis sa naissance. Si en 1788 le fléau
destructeur d’une grêle universelle ravagea nos campagnes, et porta
le désespoir dans l’âme du cultivateur, l’amy de l’humanité,
l’orage à peine fini, vole chez tous ceux qui exploitent ses terres,
aux paroles de consolation il joint la remise des fermages échus et
à échoir; il leur offre des grains pour ensemencer et pour
leur propre subsistance. Il fait ensuite faire le cadastre général
des pertes essuyées par tous les particuliers peu aisés des
communes d’Angerville et de Méréville, et les en fait remplir.
Il fait en outre prévenir les cultivateurs que leurs pertes pourraient
gêner pour continuer leur exploitation, qu’ils peuvent s’adresser
à lui avec confiance, et qu’il leur fera les avances convenables,
sans aucun intérêt, et en les laissant maîtres de régler
les termes pour les remboursements. A ce désastre succède
l’hyver le plus rigoureux, le citoyen Laborde trouve aussitôt dans
son cœur bienfaisant des ressources inépuisables pour apaiser la
faim du pauvre, et le parer des rigueurs du froid. Il veut supporter seul
les pertes de tous, s’il obtient des remises sur les vingtièmes,
il les destine au soulagement des malheureux; dans cette année désastreuse
plus de cinquante mille livres sont versées par ses mains inépuisables
sur nos deux communes.
«Enfin parait l’astre révolutionnaire
qui nous éclaire, le Sénat français dicte ses lois,
les décrets des 4, 5, 6, aoust sortent de son sein pour la félicité
générale, le citoyen Laborde, attentif à cette voix,
n’hésite pas un instant; ses jouissances les plus douces sont sacrifiées
dès qu’il aperçoit qu’elles peuvent nuire à la fécondité
des récoltes, ou exciter des réclamations; le gibier destructeur
disparait, les colombiers sont démolis, les pigeons exterminés,
les droits féodaux successivement anéantis; une contribution
patriotique de cinq cent mille livres suit de prés, un don de
même nature en argenterie; ses impositions sont plutôt payées
que réglées, La loi sur l’emprunt forcé paraît,
il s’empresse de l’acquitter, il se fait un devoir sacré de partager
toutes les charges publiques, aucun sacrifice ne lui coute pour montrer
sa soumission à la volonté générale.
«S’il fait tout pour le bien de la République,
il n’est pas moins attentif à venir au secours de ses concitoyens;
notre commune sans ressource, sans revenus, sans moyens, lui expose sa
détresse et ses embarras; il prévient ses désirs, il
lui fait construire et meubler maison commune, corps de garde, prisons;
elle lui demande un dédommagement des sommes payées par les
individus propriétaires qui la composent lors de la confection de
son papier terrier; il fait droit à sa pétition.
«Si nos jeunes concitoyens se disposent à voler au
secours de Ia patrie, il leur prodigue ses largesses.
«Le Comité de bienfaisance de la
section du citoyen Laborde à Paris, rendant justice à son
excellent cœur, l’associe à ce Comité. Son âge, des
infirmités le déterminent, contre son inclination, [p. 135] à ne pas
accepter cette place, mais il assaisonne sa lettre de remerciement d’un
don de cinq mille livres pour les pauvres de la section.
«Pour rendre justice au citoyen Laborde,
nous vous attestons qu’il ne fait que du bien au milieu de nous, et jamais
de mal, que toutes ses paroles et ses actions ont été marquées
au coin du patriotisme et du plus grand attachement à la Révolution,
aux vrais principes de l’égalité et de la liberté,
et à l’unité et l’indivisibilité de la République.
Vous n’avez point ordonné son arrestation parce que vous le regardiez
comme suspect, mais seulement par mesure de sureté;
c’est ce qui nous assure le succès de notre pétition. C’est
pourquoi nous réclamons de votre justice que le citoyen Laborde
nous suit rendu; si cependant contre toute attente, ce citoyen s’était
rendu coupable envers la République, nous serons les premiers à
vous demander que le glaive des lois s’apesantisse sur sa tête; mais
pleins d’une juste confiance qu’il n’a point démérité
de sa patrie, les deux communes d’Angerville et Méréville réunies
espèrent que vous leur rendrez leur père, leur amy, leur
bienfaiteur, et de retour dans nos foyers, nous chanterons tous ensemble:
Vive la Montagne, vive la Convention, vivent tous les amis
de la République.»
«Ci fait il a été unanimement
arrêté que la présente adresse sera portée
au Comité de sûreté générale par une
députation de vingt-trois citoyens de cette commune qui ont été
présentement nommés à l’unanimité, lesquels
sont: Claude Min, Dauvillier père, Pierre Quinton, Pierre Léguay,
P. Courtois, André Laumonier, Jousset fils aîné, Jean-Jos,
Cochin, Babault l’aîné, Pillaut, J.-Henry Rousseau, Malaquin,
Delaville, Charles Echer, Bruére. Claude Jousset fils, Robillon.
Dubois père, Antoine Delafoy, Simon Forteau, L. Forteau, Hippolyte
Guignepain et Et. Thevenot, qui ont tous accepté.»
Fait et arrêté en l’assemblée
générale de la commune d’Angerville, lesdits jour et an
que dessus.
Signé: Huchet, Luthier, Rousseau, Libre
Leguay, sans-culotte, Serveau, Chartrain, Antoine Delafoy, Courtois, Vauzelle,
Thevenot, Leguay, Jousset, Beurier, Rousselet, curé, Bertrand, Dauvilliers
père, Hureau, Malaquin, Gasgne l’aisné, Echer, Hipolite Guignepain,
J.-B. Mennault, Forteau, Robillon, Dubois père, Jufroy, Alleaume,
François Loguay, Cochin, Babault l’aîné, Dauvillier,
Etienne Marteau, Serveau, Laumonier, Delafoy, Hardy, Jousset fils aîné,
Louis Dousse, Honoré-Gabriel Perrot, Paul Sevestre, Pillant, Roulleau,
Jousset, [p.136] Carré, Jacques Menault, François Delafoy, David,
Langlois, Thiercelin, Rabourdin, Revoir, Duparc, Dubois, Mainfroy, Houdy,
Massenet, Claude Jousset père, Minier, Quinton, Houdy l’aîné,
Claude Guignepain, Beaufrère, Courtois, Dollon, maire, Mineau, off.,
Mulard, off., Lebrun, Tessier, secrétaire.
Jean-Joseph marquis de Laborde était parvenu
à une grande fortune par des voies irréprochables, son nom
d’origine était Bort; il était né en 1724, à
Bielle dans le Béarn, d’une famille qui s’était établie
à Jacca, en Arragon, où elle faisait un petit commerce.
En 1784, le château de Méréville,
qui était tenu depuis longtemps dans la famille de la Tour du Pin,
fut acquis par le marquis de Laborde, banquier de la cour, «le premier
industriel dont le gouvernement ait recherché l’assistance pour
les finances.»
Laborde avait acquis une immense fortune qu’on
évaluait à 1,800,000 livres de rentes et il savait en faire
le plus noble usage. Il affectionnait particulièrement son château
de Méréville, pour lequel il dépensa beaucoup d’argent.
Il acquit des terres à tout prix pour agrandir son parc; il détourna
des rivières, déplaça des montagnes, creusa des vallées;
il répara le château, l’agrandit, l’embellit, le remplit d’objets
d’art; il planta son parc d’arbres rares; il y construisit des canaux,
des cascades, des rivières, des grottes, des colonnes, des temples...
Il dépensa SEIZE MILLIONS!
Un visiteur dont le nom est resté inconnu
a écrit sur l’un des murs du temple qu’on voit dans le parc de Méréville,
des vers qui lui ont été inspirés par la beauté
du monument et l’agrément du lieu et qui méritent d’être
cités:
Ici Laborde, au fruit de ses
utiles veilles
Donnant un emploi généreux, [p. 137]
Par bienfaisance a créé des merveilles,
Et par goût pour les arts il a fait des heureux.
Dans les premiers jours de
novembre 1793, M de Laborde, informé que les terroristes veulent
s’emparer de sa personne et de ses biens, était allé à
Paris pour ramasser à la hâte ce qu’il avait de plus précieux,
et faire ses dispositions pour fuir.
En quittant Paris, il remit à Vaillot,
son domestique, un coffre contenant des valeurs et des bijoux pour une
somme considérable, et lui donna l’ordre d’aller l’attendre à
Sancheville, canton de Bonneval (Eure-et-Loir). M.
de Laborde au lieu d’aller rejoindre directement Vaillot à Sancheville,
eut la fatale pensée de repasser par son château de Méréville.
Ni ses vertus, ni le respect qu’il inspirait ne purent le soustraire au
sort commun de tant d’hommes irréprochables. M. de Laborde venait
de rentrer dans son château quand il fut arrêté et envoyé
au Tribunal révolutionnaire. Toute la population de la commune voulut
l’arracher aux brigands qui l’avaient arrêté, Laborde modéra
lui-même l’élan de leur dévouement; le lendemain de
cette arrestation, les habitants du canton se réunissaient à
Angerville et signaient l’adresse que nous avons rapportée, Le
Tribunal fut inexorable et Laborde pérît sur l’échafaud
révolutionnaire, le 29 germinal an II (18 avril 1794).
Quant à Vaillot, après avoir enfoui son précieux
trésor, il était accouru a Paris; il faisait à son
maître dans la prison du Luxembourg de fréquentes visites.
II ne tarda pas lui-même à être arrêté. Il
était encore en prison au mois de novembre I796, et on ignore quel
a été son sort et celui du trésor que lui avait confié
M. de Laborde. [p. 138]
|
|
[157]
|
Tableau
chronologique des Pères Barnabites qui ont été supérieurs
au Collége d’Étampes, appelé: MAISON DE SAINT-ANTOINE.
Ce tableau est tiré des Archives de la
Congrégation de Saint-Paul, dite des Barnabites, à Rome.
NOTA. — De 1629, époque de la fondation,
jusqu’à 1644, il n’y eut point de supérieur titulaire.
Durée de leurs
fonctions
|
NOMS
|
PRÉNOMS
|
PATRIE
|
1644
à 1647
|
le
P. Posteolonna
|
Candide
|
Milan
|
1647
à 1650
|
le
P. Guyon
|
Guillaume
|
Montargis
|
1650
à 1653
|
le
P. Marchand
|
Séverin
|
Diocèse
de Sens |
1653
à 1656
|
le
P. Tremouille
|
Louis
|
Moret
|
1656
à 1659
|
le
P. Berthonet
|
Fortuné
|
Montargis
|
1659
à 1662
|
le
P. Bourdin
|
Augustin
|
Paris
|
1662
à 1668
|
le
P. Fleureau
|
Basile
|
Étampes
(1)
|
1668
à 1671
|
le
P. Duchesne
|
Thomas
|
Reims
|
1671
à 1674
|
le
P. Faget
|
Lucien
|
Lescar
|
1674
à 1677
|
le
P. Moreau
|
Redemptus
|
Montargis
|
1677
à 1680
|
le
P. de Montmeslier
|
Remi
|
Montargis
(2)
|
1680
à 1686
|
le
P. Menard
|
Pierre
|
Montargis
|
1686
à 1689
|
le
P. Bailly
|
Denis
|
Paris
|
1689
à 1695
|
le
P. Blanduret
|
Gabriel
|
Dioc.
d’Auxerre
|
1695
à 1701
|
le
P. Capitain
|
Ch.-Aug.,
|
Paris
(3)
|
1701
à 1707
|
le
P. Gavinet
|
Jean-Dom.,
|
Montargis
|
1707
à 1713
|
le
P. Contault
|
Guillaume
|
Dourdan
|
1713
à 1716
|
le
P. Flamand
|
Athanase
|
Paris
|
1716
à 1722
|
le
P. Gavinet
|
Déjà nommé
|
|
1722
à 1734
|
le
P. Contault
|
Id.
|
|
1734
à 1740
|
le
P. de Castillon
|
Marcel
|
Paris
|
1740
à 1743
|
le
P. Contault
|
Déjà nommé
|
|
1743
à 1746
|
Le
P. Couterat
|
Jean-Chrysostome (4)
|
[p. 139]
|
1746
à 1752
|
le
P. de Cutillon
|
Déjà
nommé
|
|
1752
à 1758
|
le
P. Laborde
|
Vincent
|
Pau
|
|
Justis
de causis, Stamparum ac Garacti suspensa est electio. (Cap. gen. 1758.)
(5)
|
|
|
|
En 1761,
fut nommé le P. Laborde, susdit, qui mourut la même année.
On ne lui donna un successeur qu’au Chapitre général extraordinaire
de 1769.
|
|
|
1760 à
1776
|
le P. Guyot
|
Bernard
|
Versailles
|
1776 à
1779
|
L’élection
du supérieur fut ajournée
|
|
|
1771 à
1785
|
le P. Péchard
|
François-de-Sales
(6)
|
|
1785 à
la débâcle
|
le P. Delage
|
Athanase
|
Paris
|
|
|
|
|
(1) Auteur des Antiquités d’Étampes, le premier
qui ait fait deux triennats.
(2) Auteur de l’Esprit de saint Paul, petit livre qui eut beaucoup
de succès et éditeur de l’ouvrage de dom Fleureau.
(3) Le même qui fut supérieur général
de 1725 à 1731.
(4) Le nom du P. Couterat ne se trouve pas dans le livre des professions,
ce n’est pas le seul qui ait été oublié, mais il
a été certainement supérieur à Étampes,
en 1743 et à Montargis en 1749. C’était un prédicateur
fort goûté. [p. 139]
(5) Traduction: L’élection d’Étampes et de Guéret
a été ajournée pour de sérieux motifs.
(6) Le lieu de naissance du P. Péchard n’est point indiqué
dans le livre des professions, il existe plusieurs familles de ce nom à
Étampes et dans les environs; il est donc présumable que
le P. Péchard était de la Beauce. [p.140] [p. 141]
|
|
TABLE
Albert
(Jean), principal du Collège, 28.
Angerville-la-Gâte, 130, 133.
Anjou (duc d’), 104.
Anne de Bretagne, son convoi à Étampes, 9.
Argenterie envoyée à la Monnaie, 122, 123.
|
Arnaud, prédicateur,
48.
Arquebuse d’Étampes, 30, 33,110.
Ateliers de secours, 94.
Auvers, 91,108.
|
Bailly
d’Estampes, 49.
Balivière (comte de), 86.
Barnabites, 6, 7, 63, 138.
Bastille (Pierre de la], 123.
Le Besgue, de Majainville, 1.
Blois (Etats de), 114.
Boichot (Claude), 128.
Boissy (Collège de), 77.
Boissv-le-Sec, 107.
Bonne-Commune, 126.
|
Borde, de
la 55.
Bougin ou Baugin, 72.
Boulence, 118.
Bouray (ponts et chemins de), 78.
Bourbon, duchesse de Vendôme (Marie-Anne de), 26.
Bourgeois, 119.
Bourraine, 2.
Breton (Gilles), 24.
Brunehaut (Terre de), 59.
|
Capucins
d’Étampes, 27, 28, 63.
Carqueville, 4, 19.
Cassegrain, 49.
Challo-Saint-Mard (Franchise de), 16.
Chalo-la-Raison, 28.
Chalou, 107.
Chamarande, 92.
Champigny, conseiller du roy, 7.
Champigny (Mariage révolutionnaire du curé de),
98.
Charpentier, ex-curé, 104.
Charpentier, président du Directoire, 124, 132.
Chauvuin (Jean), 50.
Chéri (Rose), 34.
|
Chevalier
(Jean), 7.
Claude de France, son convoi funèbre à Étampes,
94.
Cochet, curé de Chamarande, 106.
Comédien d’Étampes (le),
Congrégation de N -D., 2, 37, 48, 51, 102.
Cordeliers, 63.
Le Cordier du Tronc (Marguerite), 118.
Courances (comme de), 8.
Couturier (Jean-Pierre), 89, 92, 98, 100, 102, 103, l04, 105, 106,
109, 110, 113, 114, 117, 118, 136.
Crassous, représentant du peuple, 26.
Crespin, 67.
Crosnier, 7, 119.
|
Dannemois,
109.
Davoust (dom Alexis), 46.
Delaitre, 35.
Delisle (Philippe), 15.
Delort (Charlotte de Viard, dame), 31.
|
Déportés
du 18 fructidor an V, 80.
Dergny, 119.
Dolivier, 113.
Dourdan, 92.
Durand-Lalande, 120.
|
Eglise Saint-Basile,
50, 107.
Eglise Saint-Gilles, 109.
Emigrés, vente de leurs
biens, 20.
Escar (baronne d), 32.
Espagne (Marie-Anne Victoire, infante
d’), 15.
Essonne (canal d’); 105.
Estouches, 3.
Étampes (administrateurs du district d’), 25, 82, 119.
Étampes (assemblée d’), 12.
Étampes (bataillon des volontaires d’), 26.
Étampes (clergé de la ville et de l’arrondissement
d’), 28, 120.
Étampes (collège d’), 28.
Étampes (comité révolutionnaire de la commune
d’), 61.
Étampes (commune d’), 91, 105, 126.
Étampes (conseil-général de la commune d’),
29, 55. |
Étampes
(coutumes d’), 84.
Étampes (directoire du district d’), 5, 26, 119,
Étampes (distribution des prix
de l’Ecole secondaire communale d’), 74.
Étampes (duché d’),
6.
Étampes (faubourg Saint-Martin d’). 29, 37.
Étampes (Hôtel-Dieu d’), 108.
Étampes (Louis Marquis d’), 12.
Étampes (municipalité d’), 18, 106.
Étampes (navigation de la rivière d’), 16.
Étampes (société d’agriculture d’), 85,
86, 87.
Étampes (société populaire d’), 20,118.
Étampes (société des sans-culottes d’), 22.
Étampes (société républicaine d’),
2.
Étampes (tribunal du district d’), 27.
Étréchy, 47.
|
Favière-Défanatisée,
91.
La Ferté Alais, 91.
La Ferté-Alais (société populaire de), 8.
Fleureau (Basile), 138.
|
Foucquemberg
(Jean-André), barnabite, 101.
Fournier l’Américain, 78.
De Pouilleuse de Flacourt, 12.
|
Garde-royale
rappelée, 50.
Gavinet (le P. Dominique), 37, 138.
Geoffroy-Château, 69.
Gérosme-Poussin, 7.
Gérosme, secrétaire de Couturier, 109, 119.
Gérosme (veuve), 7.
Gillot, 49.
Godeau (Michel), 67.
|
Geoffroy
(Jean-Gérard), 23.
Geoffroy Saint-Hilaire, 27, 28,76,84.88,120.
Gomberville (Marin le Roi, de), 40.
Gorsns, 38.
Goudion, 120.
Grains (prix des), 82.
Grosnier, 124.
Gudin jeune, 119.
|
Halle
au blé, 109.
Henri III, 6, 144.
Hôpital Saint-Jacques-de-L’épée, 7.
|
Houy (Jean),
115.
Hüe (Cantien), 24.
Hureau, curé de Saint-Cir-la-Rivière, 7.
|
Indigents
(souscription pour les), 29.
|
Joie-Villiers
(la), abbaye, 64, 101, 118, 128.
|
Laborde-Méréville,
46, 133.
Lambert de Thorigny (Marie), 128.
Languet, archevêque de Sens, 142 , 83.
Laumonnier (Pierre-Louis-Joseph), 26.
Lavallery, 84.
Lecerf, curé d’Arpajon, 20.
Lecomte (Pierre), 49.
Ledoux, curé d’Etréchy, 105.
Lefebvre (sa sœur), 83.
|
Legendre
(Nicolas), sculpteur, 115.
Le Long (Artus), 115.
Levasseur, 119.
Lignerac (Marie-Françoise Broglie, veuve), 403.
Longueil (Claude de), 70.
Lorraine (Catherine de), 6.
Louis XI, 49.
Louis XV, 71.
|
Mainfroy,
127.
Maladie contagieuse à Étampes, 44,70.
Mathurins, 63.
Mauchamps, 91.
Mazis (des), 24.
Mesnard, 119.
Mesnil-Voisin (château de), 103.
Milly (commune de), 8, 69, 108.
Milly Hôtel-Dieu de, 108.
Malet, 1.
|
Marché
aux bestiaux, 23.
Martin, curé d’Adonville,7.
Moigny (commune de), 8, 108.
Mondeville (comme de), 8.
Monnaie (retrait des pièces de), 72.
Monnerville, 91, 102.
Montmeslier (de), 138.
Montulé, 114.
Morigny, abbaye, 1, 2.
|
Nasson, 106.
Nicolaï, propriétaire du domaine de Courances,
110, 119.
Nicolas-Glasson, janséniste, 47.
|
Notre-Dame
(chapitre), 62, 82,115.
Notre-Dame (église), 89, 109.
Notre-Dame (paroisse), 2.
|
Ober-Kamlack
(affaire d’), 64.
Oncy (commune d’), 8.
|
Orage de
1625, à Étampes, 51.
Orléans (prisonniersd’), 78.
|
Palloy 38,
123.
Paris, 47.
Paris (commune de), 127.
Paris (parlement de), 49.
Perrier, curé de St-Pierre, 46.
Philippe-Auguste, 126.
Poillove (de, marquis de Saint-Mars), 46.
|
Poilloüe
de Bierville (Louis), 64.
Pompardin, receveur des tailles, 17.
Presbytères des curés, 39.
Prieuré de St-Pierre, 61.
Processions pour la pluie, 36.
Prunelé, 48.
|
Raymond,
119.
Reconseil (la sœur de), 126.
Ribiolet (le P.), 93.
Rivet (la sœur), 83.
|
Rolland (Etienne),
2.
Romanet, général, 74.
Rosière à Étampes, 30.
Roussillon (Mme de), 19.
|
Sainte-Croix
(chapitre), 62, 73.
Saint-Yon, 109.
Salmon, curé de Champigny, 99.
Salpêtre, 33.
|
Saudreville,
114.
Selve (Jean de), 46.
Selve (comte de), 113.
Simonneau, 20, 38.
|
Talaru
(Louis de), marquis de Chalmasel, 23.
|
Tullières,
maire d’Étampes, 85, 88.
|
Vaillot,
137.
Valory, émigré, 114.
Vauluisant, abbaye, 2.
Vendôme et d’Étampes (duc de), 82.
Viart (chanson composée par M. de), 59.
|
Vidolles,
109.
Villeneuve-sur-Auvers, 108.
Villiers (abbesse de), 2, 19, 128.
Voussay (le seigneur de), 115.
|
TABLE CHRONOLOGIQUE
(élaborée par Bernard Métivier)
On y a corrigé quatre erreurs de Bigault et Marquis ([030] [088]
[126] [153]).
| MOYEN ÂGE |
|
RÉVOLUTION (suite)
|
|
mars 1095 —
6 février 1147 —
1190 —
26 juillet 1467 —
|
[016], p. 16-17
[013], p. 12-15
[152], p. 126-127
[065], p. 49
|
2 septembre 1792 —
6 et 7 septembre 1792 —
4 novembre 1792 —
25 novembre 1792 —
|
[086], p. 76-77
[089], p. 78-80
[113],
p. 101-102
[128],
p. 106-109
|
XVIe
SIÈCLE
|
|
16 juillet 1793 —
|
[060],
p. 47
|
4 avril 1502 —
10 février 1513 —
26 octobre 1526 —
21 mai 1549 —
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 septembre 1556 —
24 juin 1562 —
21 juillet 1562 —
mai et juin l566 —
13 et 14 novembre 1567 —
6 décembre 1576 —
17 janvier 1579 —
|
[029], p. 24-25
[011], p. 9-12
[109], p. 94-98
[048], p. 33-34
[099], p. 84-85
[057], p. 44-46
[064], p. 49
[050], p. 36-37
[118], p. 104
[138], p. 114-115
[006], p. 5 |
19 thermidor an I (6
août 1793) —
15 septembre 1793 —
27 vendémiaire an II (18 octobre 1793) —
27 vendémiaire an II (18 octobre 1793) —
2 brumaire an II (23 octobre 1793) —
8 brumaire an II (mardi 29 octobre 1793) —
10 brumaire an II (31 octobre 1793) —
18 brumaire an II (8 novembre 1793) —
18 du 2e mois de l’an II (8 novembre 1793) —
19 brumaire an II (9 novembre 1793) —
19 brumaire an II (9 novembre 1793) —
|
[153], p. 62 et 127-128
[097], p. 84
[106], p. 89-93
[155], p. 93 et 130-133
[155], p. 130-133
[110], p. 98-100
[111], p. 100-101
[114], p. 102-103
[156], p. 103 et 133-137
[115], p. 103
[116], p. 104
|
XVIIe
SIÈCLE
|
|
20 brumaire an II (10 novembre
1793) —
|
[117], p. 104
|
7 mai 1613 —
29 juillet 1625 —
19 janvier 1638 —
1644-1785 —
19 septembre 1645 —
du lundy 7 mars 1649 —
17 août 1653 —
mars 1663 —
23 avril 1664 —
6 décembre 1664 —
24 octobre 1666 —
14 juin 1674 —
25 avril 1684 —
juin 1686 —
9 septembre 1690 —
1er septembre 1694 —
|
[041], p. 28-29
[067], p. 50-55
[007], p. 6
[157], p. 137-139
[098], p. 84
[018], p. 17-18
[076], p. 67-68
[017], p. 17
[036], p. 27
[139], p. 115-117
[107], p. 93-94
[055], p. 40-43
[039], p. 28
[052], p. 37-38
[154], p. 82 et p. 128-130
[084], p. 73-74
|
25 brumaire an II (15 novembre
1793) —
26 brumaire an II (16 novembre 1793) —
27 brumaire an II (17 novembre 1793) —
28 brumaire an II (18 novembre 1793) —
29 brumaire an II (19 novembre 1793) —
1er frimaire an II (21 novembre 1793) —
4 frimaire an II (24 novembre 1793) —
7 frimaire an II (27 novembre 1793) —
9 frimaire an II ( 29 novembre 1793) —
10 frimaire an II (30 novembre 1793) —
11 frimaire an II (1er décembre 1793) —
11 frimaire an II (1er décembre 1793) —
13 frimaire an II (3 décembre l793) —
15 frimaire an II (5 décembre 1793) —
15 frimaire an II (5 décembre 1793) —
18 frimaire an II (8 décembre 1793) —
|
[120], p. 105
[121], p. 105
[122], p. 105
[123], p. 105-106
[124], p. 106
[125], p. 106
[126], p. 106
[129], p. 109-110
[130], p. 110
[131], p. 110
[133], p. 113
[134], p. 113-114
[135], p. 114
[136], p. 114
[137], p. 114
[140], p. 117-118
|
XVIIIe
SIÈCLE
|
|
18 frimaire an II (8 décembre
1793) —
|
[142], p. 118
|
janvier 1701 —
lundi de la pentecôte 1702 —
fin octobre 1702 —
décembre 1705 —
13 septembre 1712 —
5 septembre 1713 —
22 août 1715 —
11 avril 1718 —
6 décembre 1719 —
13 mars 1720 —
janvier 1721 —
24 août 1721 —
24 août 1721 —
27 février 1722 —
14 septembre 1735 —
15 septembre 1735 —
16 septembre 1735 —
1er juin 1736 —
juillet 1740 —
20 juillet 1740 —
26 décembre 1740 —
29 mars 1746 —
1er avril 1746 —
6 juillet 1751 —
1er avril 1754 —
11 février 1755 —
janvier 1760 —
31 mars 1763 —
15 avril 1772 —
18 août 1774 —
|
[003], p. 2
[045], p. 30
[112], p. 101
[132], p. 110-113
[092], p. 82
[087], p. 77
[079], p. 70
[034], p. 26-27
[141], p. 118
[020], p. 19
[001], p. 1
[080], p. 70-71
[081], p. 71
[015], p. 15-16
[093], p. 82
[094], p. 83
[095], p. 83-84
[051], p. 37
[061], p. 47-48
[062], p. 48
[151], p. 126
[025], p. 23
[027], p. 24
[059], p. 46-47
[028], p. 24
[012], p. 12
[002], p. 1-2
[026], p. 23
[035], p. 27
[077], p. 69
|
22 frimaire an II (12 décembre
1793) —
20 nivôse an II (9 janvier 1794) —
8 pluviôse an II (27 janvier 1794) —
23 ventose an II (13 mars 1794) —
7 germinal, an II (27 mars 1794) —
9 germinal an III (29 mars 1794) —
12 germinal an II (1er avril 1794) —
16 germinal an II (5 avril 1794) —
16 germinal an II (5 avril 1794) —
19 germinal an II (8 avril 1794) —
5 floréal an II (24 avril 1794) —
5 floréal an II (24 avril 1794) —
6 mai 1794 —
26 floréal an II (15 mai 1794) —
28 floréal an II ( 17 mai 1794) —
15 thermidor an II (2 août 1794) —
17 thermidor an II (4 août 1794) —
23 brumaire an III (13 novembre 1794 ) —
21 frimaire an III (11 décembre 1794) —
29 frimaire an III (19 décembre 1794) —
13 pluviôse an III (1er février 1795) —
3 ventôse an III (21 février 1795) —
2 thermidor an III (20 juillet 1795) —
17 thermidor an III (4 août 1795) —
26 thermidor an III (13 août 1795) —
25 fructidor an III (11 septembre 1795) —
4 frimaire an III (24 novembre 1794) —
13 août 1796 —
23 fructidor an V (9 septembre 1797) —
19 fructidor an VII (5 septembre 1799) — |
[143], p. 118-119
[004], p. 2-3
[009], p. 8
[021], p. 20
[023], p. 22
[024], p. 22-23
[030], p. 25-26
[031], p. 26
[032], p. 26
[033], p. 26
[037], p. 27-28
[038], p. 28
[040], p. 28
[042], p. 29
[047], p. 33
[070], p. 61
[071], p. 61
[119], p.105
[144], p. 119-120
[150], p.126
[010], p. 8-9
[014], p. 15
[063], p. 48-49
[072], p. 61-62
[075], p. 67
[091], p. 82
[127], p. 106
[074], p. 63-66
[090], p. 80-81
[088], p. 78 |
| septembre 1776 — |
[083], p. 72-73
|
XIXe
SIÈCLE
|
|
| 19 août 1781 — |
[078], p. 69-70 |
23 frimaire an XI (14 décembre
1802) —
26 floréal an XII (16 mai 1804) —
|
[146], p. 120-122
[043], p. 29
|
RÉVOLUTION
|
|
27 août 1804 (9 fructidor
an XII) —
|
[082], p. 72 |
juillet 1789 —
15 décembre 1789 —
16 décembre 1789 —
23 janvier 1790 —
lundi de la pentecôte 1790 —
24 octobre 1790 —
13 janvier 1791 —
11 mars 1791 —
31 juillet 1791 —
19 décembre 1791 —
27 mars 1792 —
5 juin 1792 —
13 juin 1792 —
9 août 1792 —
|
[058], p. 46
[147], p. 122-123
[148], p. 123
[008], p. 7
[046], p. 30-33
[108], p. 94
[005], p. 3-4
[019], p. 18-19
[068], p. 55-59
[149], p. 123-126
[022], p. 20-21
[053], p. 38-39
[054], p. 39-40
[073], p.62-63
|
14 septembre 1807 —
1er septembre 1808 —
28 juillet 1817 —
7 octobre 1820 —
23 juin 1821 —
6 octobre 1821 —
16 octobre 1821 —
6 octobre 1822 —
août 1825 —
24 septembre 1825 —
16 mai 1829 —
30 mai 1842 —
11 octobre 1857 —
13 décembre 1859 —
|
[096], p. 84
[085], p. 74-75
[066], p. 49-50
[101], p. 85
[056], p. 43-44
[102], p. 86-87
[105], p. 88-89
[103], p. 87-88
[069], p. 59-61
[100], p. 85
[044], p. 29-30
[049], p. 34-36
[104], p. 88
[145], p. 120
|
|