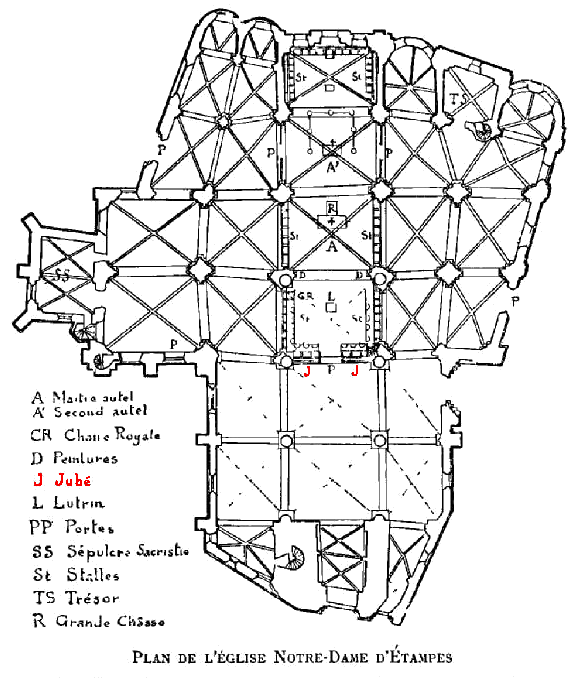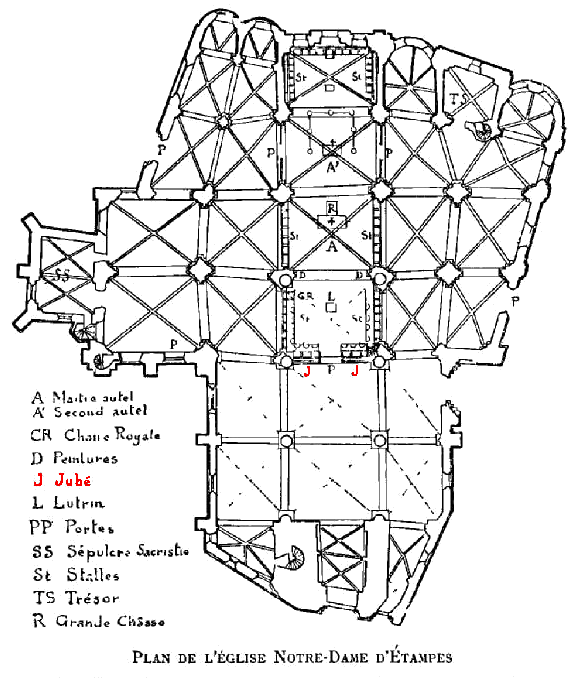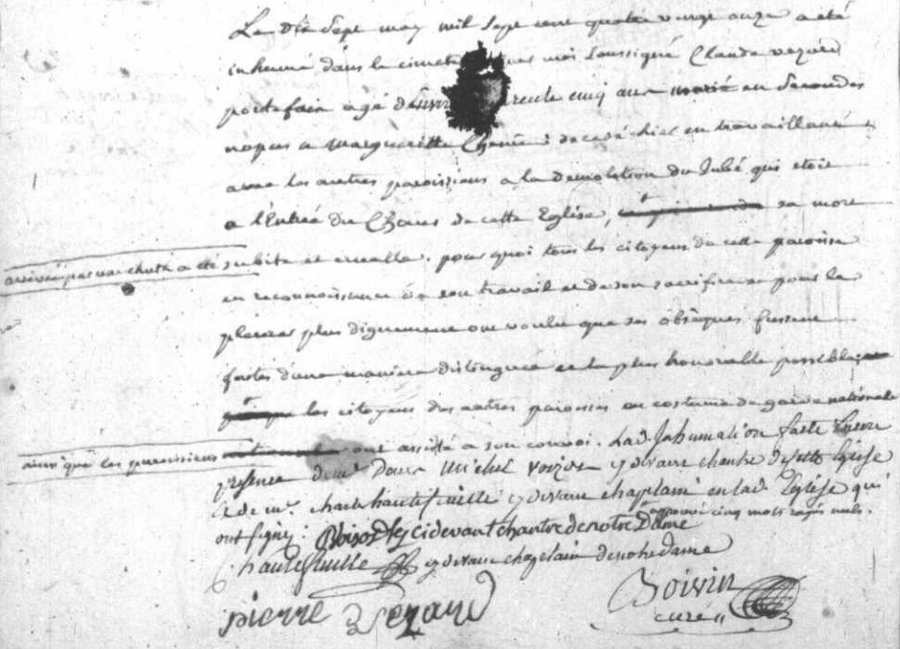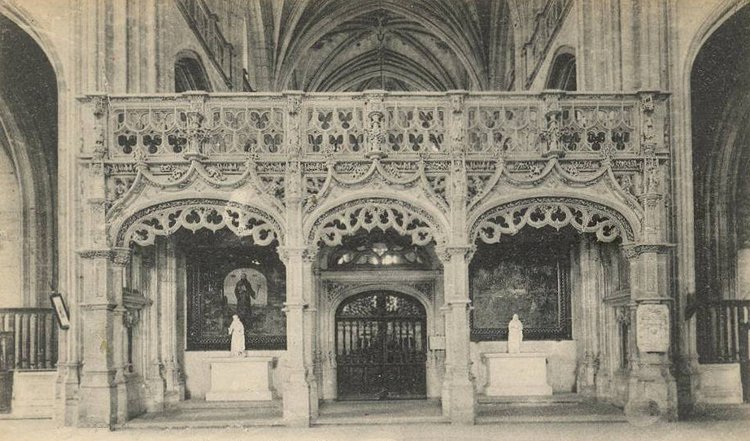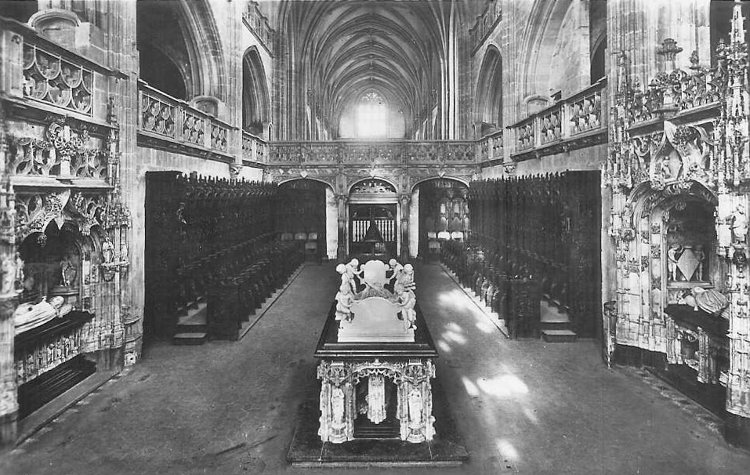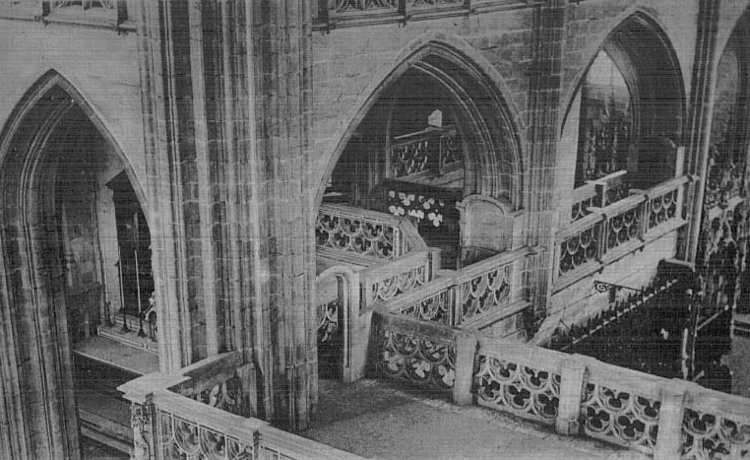|
|
La démolition du jubé de l’église Notre-Dame
d’Étampes
(16 mai 1791)
Dans mon étude sur les Objets mobiliers
du chœur de l’église Notre-Dame d’Étampes pendant le moyen-âge,
publiée en 1913, je fus amené à parler du jubé
et je déplorais la pénurie des renseignements existant sur
son compte. Or, mon travail était imprimé depuis seulement quelques
jours, lorsque notre confrère M. l’abbé Alliot, parcourant en
ma présence le deuxième Registre des délibérations
du District d’Étampes (Archives départ. de Seine-et-Oise,
cote L II K), y découvrit à la date du 19 mai 1791 (folio
14 v°), un compte rendu qui se rapportait à la démolition
récente du jubé de Notre-Dame.
Avec sa cordialité habituelle dont je m’empresse
de le remercier, l’éditeur du cartulaire de la grande collégiale
étampoise me communiqua immédiatement sa bonne fortune, et
nos lecteurs doivent à son obligeance la copie de l’intéressant
document suivant, qui commence par des allusions à la suppression
de certaines paroisses de la ville.
|
|
«Séance du 19 Mai 1791. Le Directoire assemblé,
présidé par M. Duverger, vice-président, où étaient
MM. Sagot, [p.197] Desroziers,
administrateurs, Héret, procureur sindic..........
«Cependant au moyen des mémoires à
lui (Directoire) fournis par le corps municipal, et par les habitants de
chacune des cinq paroisses de cette ville et fauxbourgs même par les
habitans de celles adjacentes, je pense, Messieurs, qu’il peut présentement
s’occuper des suppressions et union de ces différentes paroisses;
et il le doit d’autant plus que vous êtes instruits, que le seize
de ce mois, cinq heures du matin, des habitans de la paroisse Notre-Dame
de cette ville, autorisés sinon par le Corps municipal, au moins par
la présence d’aucuns de ses membres, que l’on assure avoir mis la main
à l’œuvre, et avoir procuré les outils et brouettes appartenant
à la ville, se sont portés en foule dans l’église où
ils ont eu le spectacle touchant de voir l’un d’eux perdre la vie sous les
décombres du jubé qu’ils se sont permis de détruire,
ainsi que la clôture du chœur.»
«J’aime à croire qu’ils n’ont eu en
vue que la conservation de leur église, et qu’ils ont pensé
que, pour pouvoir l’obtenir, il leur fallait la faire paraitre plus vaste
en démasquant le chœur et lui donnant plus de clarté. J’y
suis d’autant plus fondé, qu’il est de notoriété publique,
qu’ils se sont cotisés jusqu’à concurrence de 6 à 700
l. pour la faire reblanchir; mais leur conduite n’est pas moins un mépris
des loix, et d’un exemple qu’il serait très dangereux de tolérer,
puisque les habitans des autres paroisses pouraient aussi se permettre de
semblables destructions, qui, outre qu’elles pouraient tourner au détriment
de la Nation, pouraient encore lui occasionner des dépenses infructueuses,
dans le cas même où les églises seraient conservées.
«J’estime donc, Messieurs, que le Directoire
doit inviter, même requérir au plustot M. l’évêque
du Département, conformément à l’art. 13 de la loy
du 24 novembre dernier, de concourir par lui-mème ou par son fondé
de procuration aux travaux préparatoires des suppressions et unions
tant des paroisses de cette ville et fauxbourgs que de celles adjacentes,
même de toutes les autres paroisses du ressort du District.»
(Signé:) Huret.— Duverger.— Sagot. — Desroziers.
[p.198]
|
|
S’il n’est pas assez explicite à notre gré au point de vue
descriptif, le document nous fournit par contre des révélations
aussi curieuses qu’inattendues.
Ainsi ce sont les fidèles eux-mêmes,
les plus dévôts parmi les paroissiens de Notre-Dame, qui, lorsque
l’interruption du culte n’était pas encore envisagée, quand
la Révolution n’avait encore donné que ses prémices,
ont pris des pioches et ont furieusement détruit l’encombrant jubé!
Ils présentèrent pour excuse que le
jubé et la clôture du chœur donnaient à l’église
une apparence étroite. Ceci n’est pas pour nous surprendre, puisque
cela confirme notre proposition touchant l’étendue du chœur et la
petitesse extraordinaire de la nef. Le but avoué de ceux qui, à
une heure matinale, avec préméditation, avec complot, commirent
cet acte de destruction, était de sauver l’église elle-même
de la démolition.
La véracité de cette dernière
affirmation ne saurait être mise en doute; mais je pense qu’il faut
aussi faire une part, dans un élan si prompt et d’un caractère
si insurrectionnel, à l’impopularité des jubés, vastes
écrans utiles au bien être des chanoines mais devenus insupportables
à la curiosité des fidèles, et que depuis bien longtemps,
dans beaucoup d’églises, l’on avait déjà jeté
bas.
|
|
Je me suis naturellement empressé de
consulter le registre des inhumations au sujet du paroissien à qui
son acharnement fit commettre une imprudence fatale. Les commentaires de
l’acte que j’ai retrouvé confirment parfaitement le caractère
du mouvement populaire indiqué dans la délibération
du Directoire. [p.199]
Le dix sept may mil sept cent quatre vingt onze, a
été inhumé dans le cimetière par moi soussigné,
Claude Vezard, portefaix, marié en secondes nopces à Marguerite
Chenu, âgé d’environ quarante cinq ans, décédé
hier en travaillant avec les autres paroissiens de cette paroisse à
la démolition du jubé qui était dans cette église,
sa mort arrivée par une chute en tombant avec le ceintre dudit jubé
a été subite et cruelle; pour quoi tous les citoyens de cette
paroisse, en reconnaissance de son travail et de son sacrifice, et pour le
pleurer plus dignement, ont voulu que ses obsèques fussent faites
d’une manière distinguée et le plus honorable possible; les
citoyens des autres paroisses en costume de garde national, ainsi que les
paroissiens, ont assisté à son convoi. La dite inhumation faite
encore·en présence de M. Denis Michel Voizot, cy devant chantre
du cy devant chapitre de cette église, et de Mr Charles Hautefeuille,
chapelain de cette église, qui ont signé.»
Voizot, cy devant chantre
de Notre-Dame.
Hautefeuille, cy devant
chapelain de Notre Dame.
Pierre Vezard. — Boivin, curé.
|
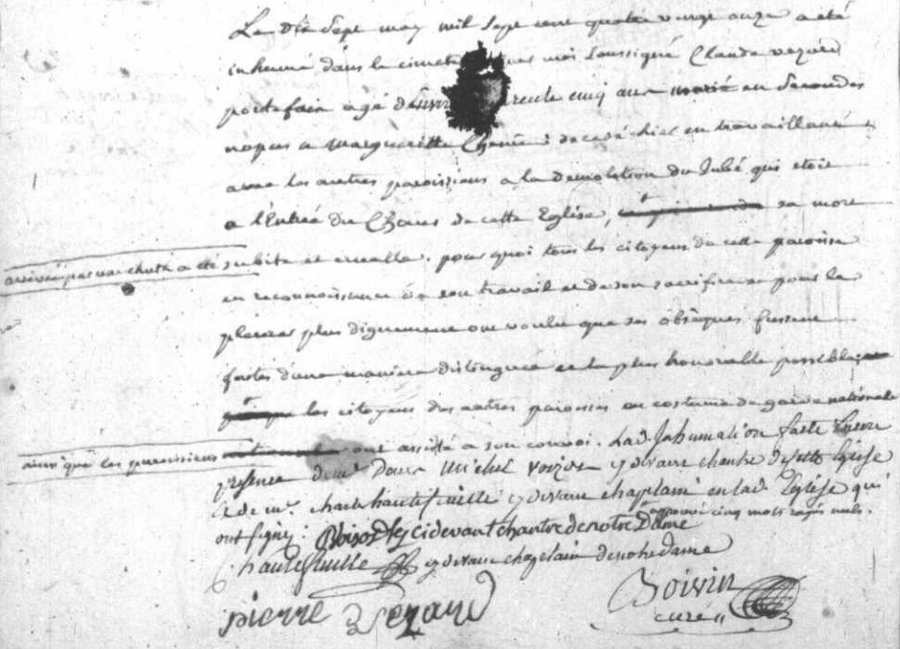
Acte de décès de Claude Vezard (voir en
Annexe)
|
Dans mon étude ci dessus mentionnée, j’avais, sans pouvoir
la résoudre, posé une autre question: le jubé était-il
en pierre ou en bois?
|
|
Nos deux documents nouveaux n’apportent pas de réponse précise.
Cependant, pour ma part, par suite de plusieurs circonstances et bien qu’elles
ne soient pas probantes, — la réquisition de brouettes, l’existence d’un cintre ou
arc et sa chute soudaine, aussi le fait qu’il a survécu aux guerres
religieuses et qu’il n’a pas alimenté les feux de l’armée huguenote
en 1562 et en 1568, — je me sens enclin à penser que le jubé et aussi
les clôtures latérales étaient en pierre. Ce fait, s’il
était exact, rendrait encore plus vraisemblable notre proposition
concernant [p.200] les deux fragments
de pierres sculptées susceptibles d’être des débris du
jubé (1); la démolition tardive
de celui-ci expliquerait pourquoi ils sont aussi facilement parvenus jusqu’à
nous: je ne crois pas que les travaux de restauration opérés
durant le XIXe siècle aient touché à des constructions
capables de les avoir fournis, et il me semble au contraire que les architectes
eurent alors le soin louable de remettre en place ou de refaire les morceaux
intéressants. En somme, depuis le XVIe siècle, il n’y a pas
eu de travaux ni de changements dans l’église au point de vue construction,
hormis ceux que je viens de rappeler et la destruction de la clôture
du chœur.
|
(1)
Article cité, p. 15. (Annales de la Société
Historique et Archéologique du Gâtinais, 1er et 2e trimestres
1913).
|
L’un et l’autre débris gisèrent longtemps côte
à côte dans un coin de la crypte de l’église Notre-Dame,
avec d’autres fragments de sculpture plus importants. Je crains que de jolis
morceaux provenant du même dépôt ne soient aujourd’hui
dispersés, égarés et perdus pour l’histoire (2).
Quoiqu’il en soit, je tenais à bien affirmer
la provenance commune des deux sculptures en question. Leur matière
est également identique: toutes deux sont en pierre calcaire stampienne,
très dure, et remplie de coquillages distinctifs. L’une d’elles, qui
se trouve en la possession de M. le commandant comte Lefebvre des Noëttes,
a [p.201] été jugée digne
par M. Camille Enlart d’être moulée pour le Musée de
sculpture comparée du Trocadéro, et elle y figure en plâtre,
comme pièce du XIIe siècle dans la salle romane (côté
oriental). On l’a présentée comme un ancien corbeau
dont elle a en effet assez bien la forme et les dimensions; il s’agit en tous
cas probablement d’un support.
Tout d’abord, il est évident que nous possédons
seulement la partie supérieure de la pierre, et que le fragment détaché
et perdu est très important: je l’évalue à plus de la
moitié. La largeur de ce qui reste, qui est bien la largeur primitive
marquée par les tranches des côtés conservées
intactes, est de 0.21 centimètres: c’est celle de l’imposte ou bandeau
plat supérieur dont la largeur est, sur la face, de 0.06 centimètres:
au-dessous de ce bandeau, la pierre est taillée en chanfrein et se
dégage pour laisser en vue le sujet sculpté. La profondeur
de la pierre est réduite par la mutilation à 0.10 centimètres. |
(2) Il y a peu d’années,
un de nos confrères d’Étampes eut la chance de sauver un fragment
de colonnette ornée, parce qu’il avait appris qu’un tombereau de
décombres sortis d’un coin de l’église avaient été
transportés dans la campagne, dans un lieu de décharges.
|
Les honneurs qu’on lui rend sont dus à une petite tête
humaine d’une très curieuse physionomie, placée perpendiculairement
et immédiatement sous l’imposte qu’elle entame légèrement:
la tête a 0.11 centimètres de hauteur pour 0.08 centimètres
de large; le visage, jeune, imberbe et même assez fin, est d’un ovale
très allongé par suite de la forme tombante mais énergique
du menton. Les yeux qui ne sont pas asymétriques, l’un se trouvant
plus bas que l’autre, sont très grands, avec le lobe trop saillant
et mal arrondi. La bouche fermée est petite et un peu sensuelle; les
oreilles font défaut; les
joues ont des contours assez délicats; les narines [p.202] sont prêtes à vibrer, tandis
qu’un léger sourire achève de donner la vie à cette
figure plaisante et naturelle que malheureusement dépare une mutilation
tout à fait regrettable de l’œil droit. Les cheveux, séparés
très correctement par une raie médiane, tombent en bandeau
et achèvent de féminiser le petit personnage; mais ils tournent
à la hauteur des tempes pour former de chaque côté une
bouclure ayant l’apparence d’une coque. Enfin, si l’étrangeté
et le mystère conviennent à ce jeune visage incertain de fille,
de femme, ou de garçon, elles sont fournies par deux ailes qui semblent
liées à la tête par la coque des cheveux. Ceci, je m’empresse
de le dire, n’est qu’apparent. Nous n’avons plus à considérer
aujourd’hui qu’une tête, mais cette tête eut jadis un corps,
et c’est aux épaules que les ailes s’attachaient. Quant aux coques
de cheveux, je suppose qu’elles indiquent simplement l’extrémité
de cheveux courts et roulés.
|
|
Quant à l’identification du personnage, il faut rejeter l’idée
d’un chérubin; celle d’un ange serait plus convenable, mais, à
mon avis, l’artiste s’est proposé de représenter l’Homme
ailé, un des quatre animaux de l’Apocalypse, qui symbolise l’évangéliste
saint Mathieu. J’expliquerai pourquoi tout à l’heure, mais je désire
faire remarquer tout de suite que des cheveux roulés comme ceux de
notre personnage sont, par une coïncidence au moins bizarre, une des
plus curieuses caractéristiques d’un Homme ailé (2) sculpté, ayant 1 mètre de hauteur,
qui décorait [p.203] jadis un ambon de
la cathédrale de Besançon dont je reparlerai plus loin.
|
(2)
Il ne faut pas dire un ange: le terme serait absolument impropre en
cette circonstance. Au point de vue physionomique, l’Homme de Besançon
[p.203] a 1a tête aussi
ronde et aussi large que celui d’Étampes l’a étroite et longue
(Jules Gauthier, L’ambon de la cathédrale de Besançon, XIe
siècle, dans le Bulletin archéologique, 1898).
|
Si de la première pierre il nous reste seulement la partie
supérieure, de la seconde nous ne possédons plus que la partie
inférieure: à cette diversité nous trouvons plusieurs
avantages pour l’étude qui d’abord va nous prouver que les deux pierres
ont appartenu à une même série grande ou petite, de supports
semblables, ayant eu les mêmes dimensions et la même destination,
outre des rapports symboliques précis, et ensuite qui nous permettra
de reconstituer presque complètement la forme des pierres.
|
|
| Aucun charme gracieux ne pare la seconde pierre, dont je me suis
pour le moment constitué le gardien; de plus la mutilation a rendu
piteux l’aigle qui en faisait l’ornement, et dont la tête, le cou et
la partie supérieure des ailes ont été brisés
et perdus. L’oiseau, posé sur un bandeau de feuilles d’acanthe stylisées,
n’est pas très grand: sa hauteur, depuis les pattes jusqu’à
la naissance du cou, est de 0.17 centimètres; la largeur du corps,
en sa plus grosse épaisseur, est de 0.11 centimètres. La
hauteur du bandeau de feuillage est de 0.07 centimètres environ.
Ce bandeau devait marquer l’extrémité inférieure de
la pierre, mais je ne saurais l’affirmer, car la mutilation a enlevé
de ce côté toute trace de taille; par ce fait le bandeau et
la pierre peuvent avoir perdu un ou deux centimètres de hauteur, sinon
plus. Enfin la [p.204] largeur de la pierre
entière, — qui est comme pour l’autre incontestablement la largeur primitive, — est aussi de 0.21 centimètres: cette mesure représente
également l’envergure des ailes. En somme il ne reste plus de la pierre
qu’un fragment de la partie ornementale. |
|
|
L’identité des mesures pour les deux pierres est donc précisée
seulement par leur largeur et par la largeur des ailes; mais cela suffit,
je pense, pour entraîner la similitude des autres dimensions que nous
ne pouvons pas constater par le fait, car en outre, en dehors de tout symbolisme,
l’harmonie des sculptures est éclatante: chaque figure est munie d’ailes,
et si cela est chose très naturelle pour l’oiseau, c’est plus extraordinaire
pour le personnage: les deux pierres ont donc selon toute vraisemblance
été taillées sur le même module et par conséquent
ont dû concourir à la même décoration. On peut
en outre déduire, avec leur première forme presque intégralement
reconstituée, les dimensions communes des deux pierres ainsi résumées:
Hauteur, 0.42 centimètres environ; largeur, 0.21 cm.; hauteur de
l’imposte, 0.06 cm.; hauteur des sujets sculptés, 0.36 cm. Environ.
La hauteur totale est approximative, sans être très conjecturale;
seule la profondeur, d’un intérêt secondaire, reste inconnue. |
|
|
A l’époque romane, par tradition romaine et byzantine (1) sans doute, on s’est plu quelquefois à utiliser
[p.205] l’aigle comme ornement pour
sa seule beauté décorative et sans être guidé
par une idée symbolique. L’orfèvrerie s’en est emparée,
et on le rencontre sculpté sur quelques chapiteaux (1). Mais le gros succès
de l’aigle à l’époque chrétienne lui vient de son caractère
symbolique. Si j’ai proposé pour l’identification du petit personnage
du premier support l’Homme ailé, de l’Apocalypse, c’est parce
que je vois dans l’Aigle le symbole également apocalyptique
de saint Jean l’Évangéliste. Il est plus habituel de représenter
les Quatre Animaux nantis chacun d’un nimbe et du Livre de la Bonne Nouvelle,
et il n’y a pas trace de ces deux attributs sur nos débris. Cela ne
prouve d’ailleurs pas qu’ils n’existaient point, du moins le Livre, car l’Homme
le tenait peut-être dans ses mains et l’Aigle dans son bec. En tout
cas, si ces attributs sont convaincants, ils ne sont peut-être pas
essentiels, et je crois que même sans eux les deux identifications se
confirment l’une l’autre suffisamment. Et alors on se demande si le Lion de
saint Marc et le Bœuf de saint Luc n’ont pas existé et ne manquent
pas à l’appel. |
(1)
Les monnaies et les enseignes des légions romaines ont sans doute
beaucoup fait pour établir cette tradition: plus tard sont venus les
tissus orientaux. Mais encore il apparaît que l’architecture, au temps
de l’occupation romaine, a multiplié partout en France des images sculptées
de l’attribut de Jupiter que les artistes du haut Moyen-âge eurent
constamment sous les yeux. Les musées de Nîmes, de Vienne, de
Narbonne, de Marseille, de Limoges, de Langres, etc. possèdent des
séries d’aigles en ronde-bosse ou en relief provenant de frises ou
d’autres parties de monuments (Espérandieu, Recueil général
des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine).
(1) De beaux aigles très
mouvementés, posés sur des acanthes, ornent les chapiteaux
des colonnes du portail de Saint-Gilles-du-Gard; — chapiteau
de l’église du Ronceray, à Angers, et de Saint-Sernin de Toulouse;
chapiteau ou portail de l’église Saint-Michel à Pavie; etc.
|
Il faut essayer maintenant de déterminer quelle fut l’utilisation
des pierres.
|
|
|
Comme nous l’avons dit, il peut s’agir seulement [p.206] de supports. La position des pierres dans
leur emploi se trouve déterminée par la perpendicularité
obligatoire de la partie supérieure de la face du support proprement
dit, c’est-à-dire de l’imposte. Or cette position étant acquise,
on constate que la pierre devait être naturellement en saillie et libre
sur ses côtés, ce qui est inévitable pour les modillons,
corbeaux et aussi les pierres destinées à recevoir des linteaux
ou les claveaux inférieurs de portes, qui sont également nommées
impostes, chambranles, corbeaux.
La saillie ou le retrait des figures décoratives de ces supports varie
considérablement surtout au fur et à mesure qu’on s’éloigne
de l’époque romane, et la modération avec laquelle la sculpture
a été exécutée dans cet ordre d’idées,
ne pourrait servir qu’à une indication quant à la date du travail.
Enfin, en principe, la finesse de la sculpture exclue l’hypothèse
d’un modillon de corniche extérieure et élevée; à
Étampes, les modillons figurés sont tous du type grotesque. |
|
S’agirait-il alors de corbeaux? Ils abondent à l’intérieur
de l’église Notre-Dame, et leur raison d’être est souvent énigmatique
(1). On en voit aussi plusieurs à l’extérieur
(2). Ces corbeaux ont dû servir à
porter la toiture d’appentis. Les uns et les autres ont [p.207] souvent un rebord étroit, destiné
probablement à maintenir quelque pièce de bois. La plupart
ont une décoration franchement grotesque et sont certainement plus
anciens, parfois même beaucoup plus anciens que les fragments égarés
dont nous nous occupons. Différences de style et d’âge plus
ou moins grandes, différence plus ou moins nette de destination, différence
de genre dans les sujets sculptés, voilà en somme ce qui les
sépare des corbeaux encore en place, soit à l’extérieur,
soit à l’intérieur de l’église.
|
(1)
Il y en a de fort peu connus, à la base du clocher, attribuables au
XIe siècle et qui furent primitivement extérieurs. Plusieurs
autres, qui en réalité devraient être appelés
des culots, sur lesquels reposent des arêtes de
voûtes à la romaine, sont devenus célèbres; visibles
dans le bas-côté sud, ils sont d’une forme très spéciale
et ne peuvent être comparés par exemple avec les corbeaux classiques
qui supportent des arêtes d’ogives carrées fort primitives
dans l’église de Boigneville (arrond. d’Étampes, cant. de Milly).
(2) Sur le mur de la
sacristie actuelle, façade nord.
|
Toutes ces considérations viennent à l’appui de
notre présomption que les deux pierres proviennent du jubé.
Elle se justifie encore mieux si nous examinons la question symbolique et
les usages que celle-ci a entraînés. Sans doute les Quatre Animaux
de l’Apocalypse furent introduits dans maintes décorations architecturales,
mais toutefois au milieu de circonstances presque toujours identiques. Leur
place habituelle est sur les façades des églises, dans les
tympans de portes, tout proches d’une image du Christ en Majesté (1). Les exceptions à cette règle sont
en somme assez rares. Quelquefois ils accompagnent les Évangélistes
en qualité d’attribut et les artistes leur ont en même temps
prêté un rôle d’inspirateurs (2). Enfin on les rencontre régulièrement, en groupe
ou séparément, sur quelque partie des rares ambons ou jubés
à galerie qui subsistent. [p.208] D’autres fois on les a peut-être choisis
simplement à cause de leur nombre (1).
|
(1)
Dans les tympans, ils sont presque toujours présentés de
côté. Un tympan conservé au Musée archéologique
de Dijon est à ce point de vue très exceptionnel, car l’Homme
y est de face. — En orfèvrerie, les Quatre Animaux figurent principalement
sur les croix reliquaires ou processionnelles, sur les plats de couverture,
comme sur les plaques d’ivoire, en un mot partout où le Christ est
représenté avec le même caractère symbolique.
(2) Dans les tympans
des portails de Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret) et de Saint-Pierre-le-Moutier
(Nièvre); — sur un pilier de la nef, dans la cathédrale
de Strasbourg, les Quatre Animaux ornent les culots qui portent les statues
des saints.
(1) Sur la façade
extérieure du croisillon nord de la cathédrale de Reims, ils
servent d’amortissements aux accolades de trois grandes fenêtres rapprochées. — Sur la
façade de l’église Saint-François, à Assise,
ils décorent en haut et en bas l’extrados d’une grande rose.
|
Qu’on veuille bien se reporter à ce que je rappelais dans ma
précédente étude (2) à
propos de la lecture de l’Évangile sur les ambons et les jubés.
Vraiment, il y avait là un motif péremptoire pour que les quatre
attributs des Évangélistes servissent à leur décoration
de préférence à tout autre sujet. Du reste il en fut
ainsi: la tradition s’en est établie au plus tard à l’époque
carolingienne et pourrait bien avoir une origine païenne (3). En tout cas, à la fin du Xe siècle,
nous voyons en effet Folcuin, abbé de Lobbes, au pays de Liège,
faire exécuter un ambon en métal. Du côté nord,
celui-ci «portait un pupitre [p.209] en
forme d’aigle coulé en bronze et magnifiquement doré; ses
ailes rabattues pouvaient se relever pour recevoir le livre des Évangiles;
le cou de l’oiseau, au moyen d’un mécanisme ingénieux, devenait
mobile; il semblait alors prêter l’oreille au chant du diacre, exhalant
en même temps des nuages de parfums produits par l’encens jeté
sur des charbons allumés à l’intérieur de son corps»
(1). Depuis, quittant les ambons, l’aigle est
devenu simple lutrin d’innombrables fois, et il continue seul à jouer
ce rôle encore aujourd’hui (2). Pourtant,
au Moyen âge, les trois autres animaux ont contribué aussi
parfois à l’ornementation des ambons. On en trouve encore des exemples
en Italie (3); un exemple,
le plus curieux en la circonstance, nous est offert par l’ambon de l’église
San Giovanni [p.210] à Pistoia.
On y voit l’Aigle, dépassant le rebord du parapet et supportant le
pupitre, incliné, posé au-dessus de la tête de l’Homme,
tandis que le Bœuf et le Lion sont groupés à droite et à
gauche de celui-ci; aucun des Animaux n’est nimbé (1). L’ambon de San Miniato à Florence comporte
un arrangement un peu analogue, mais dont le symbolisme, s’il existe, est
moins clair: l’Aigle est posé sur des feuilles d’acanthe comme celui
d’Étampes; la cariatide qui supporte le tout est ici une femme qui
elle-même a pour support une figurine de lion. Aucun nimbe non plus.
|
(2)
P. 16, note.
(3) Quatre ambons du
VIe siècle, à Ravenne, sont tous ornés de nombreuses
images d’animaux uniquement recrutés parmi les agneaux, paons, cerfs,
colombes, canards, poissons (Dom Cabrol, Dict. d’archéologie
chrétienne et de liturgie, 1907, t. I, art. Ambon). Or
ces ambons quadrangulaires, s’ils sont évidés, n’en ont pas
moins la forme des autels païens antiques, lesquels précisément
eurent quelquefois leurs panneaux ornés de figures symboliques ayant
d’étranges rapports avec les figures chrétiennes. Le musée
de Langres notamment possède un de ces autels païens sur les
faces duquel se voient un aigle, un paon et un amour ailé pour symboliser
Jupiter, Junon et Vénus; le quatrième bas-relief rappelle
Apollon avec une couronne de laurier (Espérandieu, ouvr. cité,
t. IV, p. 320). Les similitudes sont peut-être dues seulement au hasard;
je crois qu’elles méritaient néanmoins d’être signalées.
— Il est probable que dans nos musées, ou remployées sur les
façades de nos monuments du Moyen âge, se trouvent quelques
pierres sculptées des époques mérovingienne et carolingienne,
dont la destination primitive, aujourd’hui insoupçonnée, fut
d’orner des ambons.
(1) Jules Helbig, L’Art
Mosan (Bruxelles, 1906), p. 29-30.
(2) Dans l’église.
Santa-Maria dei Miracoli, à Venise, l’aigle-lutrin en marbre est posé
sur la balustrade de l’ambon (dernier quart du XVe siècle).
(3) Dans l’église
du Saint-Sépulcre, à Bologne, à coté de l’autel
très surélevé parce qu’il domine le Sépulcre,
se trouve l’ambon décoré sur chacune de ses deux faces visibles
de deux animaux apocalyptiques. Tous ceux-ci sont de face, sauf le bœuf qui
est de profil. L’aigle est d’une très grande similarité avec
le nôtre; toutefois pouvant s’étendre, il écarte plus
loin ses ailes, et au lieu d’être posé sur un bandeau de feuillage
purement décoratif, il tient dans ses serres un volumen en partie
déroulé. La tête et les ailes dépassent le bandeau
sculpté qui forme le rebord du parapet de l’ambon, lequel rebord joue
à peu près le même effet que l’imposte de notre support
d’Étampes. La tête et le cou de l’aigle mesurés ensemble
n’atteignent pas tout à fait le tiers de la hauteur de tout l’oiseau,
constatation utile pour la restitution de notre fragment étampois.
— M. J. Gauthier a étudié plusieurs autres ambons italiens,
décorés des Quatre Animaux à Almenno, à Milan
(ouvr. cité, p. 294-296). — En descendant
jusqu’a la Renaissance, on trouve l’exemple d’un remarquable jubé
à Paris, celui de l’église Saint-Germain l’Auxerrois, érigé
vers 1545. — Son architecte fut Pierre Lescot, et Jean Goujon avait sculpté
pour lui cinq panneaux aujourd’hui au Louvre, dont quatre représentent
les Évangélistes accompagnés des Animaux.
(1) Cet ambon est dressé
au milieu de la nef comme une chaire à prêcher, mais il ne peut
y avoir doute quant à sa qualification. En effet, outre qu’il n’a
peut-être pas toujours occupé cette place, il est vaste et muni
de trois pupitres fixes, témoignant ainsi qu’il est utilisé
comme un ambon ordinaire ou une galerie de jubé.
|
En France, la pénurie des monuments de ce genre ne saurait nous
faire supposer qu’il n’y en a jamais eu. M. Jules Gauthier, archiviste du
département du Doubs, a essayé avec quelques morceaux de marbre
sculptés de restituer l’ambon de la cathédrale de Besançon
(2), et nous sommes fondé
à croire [p.211] qu’il y en eut un également
dans la cathédrale d’Angoulême (1).
Enfin, quand les Quatre Animaux sont représentés seulement
par deux d’entre eux, l’aigle ne manque jamais et il est le plus souvent accompagné
de l’Homme ailé (2).
En résumé
tout s’accorde pour nous conduire à cette conclusion, correspondant
à notre première proposition, que les deux pierres ont servi
de quelque façon à la décoration du jubé, soit
qu’elles aient appartenu à un ou deux anciens ambons incorporés
dans le jubé, soit qu’elles aient été remployées
dans la construction de celui-ci, soit encore qu’elles aient été
sculptées spécialement pour lui.
Leur nombre restreint et leurs sujets d’ornementation
rendent très improbable qu’elles aient servi de modillons à
un encorbellement de la galerie. Et si elles ont toujours été
réduites au nombre deux, elles pourraient avoir servi de corbeaux
pour soutenir le [p.212] linteau de la porte
d’entrée du chœur ou celui de la porte de l’escalier. Elles pourraient
encore avoir marqué l’emplacement des pupitres des lecteurs de l’Évangile
et de l’Épitre, montées sur des colonnettes (1), suivant les principes d’un des arrangements italiens.
Le caractère de
la sculpture des deux pierres d’Étampes les désigne bien comme
appartenant au XIIe siècle. C’est la date que M. Enlart a spontanément
assignée à celle dont le style est en apparence plus avancé.
|
(2)
Quatre bas-reliefs taillés dans du marbre antique, représentant
les Quatre Animaux et attribués au XIe ou au XIIe siècle, furent
extraordinairement conservés dans un remplage du XIIIe siècle
appliqué contre un arc-de-triomphe romain voisin de la cathédrale
de Besançon. M. Gauthier a pu établir qu’ils avaient probablement
appartenu à l’ambon de cette église (ouv. cité;
—
voir aussi ci-dessus). Leur sculpture est d’un maigre relief; le lion, le
bœuf et l’aigle ont respectivement de 0.60 à 0.65 centimètres
de hauteur, et de 0.60 à 0.65 centimètres de largeur. Seul
l’Homme est représenté de face, tenant le Livre dans ses mains;
son nimbe dépasse le panneau et empiète sur la bordure de la
cuve, comme la tête de l’Homme d’Étampes sur l’imposte. Les trois
autres Animaux, aussi nimbés et accompagnés du Livre,
sont représentés de côté. M. Gauthier présume
que l’ambon fut démoli avant 1212, ce qui impliquerait à la
même époque la construction d’un jubé.
(1) Le musée d’Angoulême
conserve un aigle nimbé et tenant le Livre sculpté en bas-relief
sur une grande pierre presque carrée (haut. 0.70 cent., larg. 0.80
cent.), avec bordure à la partie inférieure, provenant de la
cathédrale, qui possède les dimensions et le caractère
voulus pour avoir orné un panneau d’une cuve d’ambon; il est impossible
de ne pas reconnaître sa grande similitude avec les aigles de Besançon
et d’Italie. Lui-même aurait son similaire sur un pignon de l’église
peu éloignée des Trois-Palis (Charente), attribué au
XIIe siècle. Moulage au Trocadéro. On suggérera peut-être
que cet aigle a pu appartenir à un tympan, mais la différence
très sensible du relief de la sculpture et peut-être aussi la
forme carrée de la pierre rendraient cette proposition peu acceptable.
(2) Tel est précisément
le cas sur la façade de la cathédrale de la ville de Lucques:
les deux figures au lieu d’être dans le tympan du portail sont dans
son extrados; —
sur l’ambon de l’église Saint-Marc, à Venise, l’aigle posé
sur une colonnette qui s’élève extérieurement au long
du parapet, porte le pupitre sur ses ailes, et l’Homme ailé joue le
même rôle pour une seconde tribune plus basse; — à
la baie principale du portail de Saint-Gilles-du-Gard, le linteau est posé
sur deux corbeaux ornés de 1’Aigle et du Bœuf.
(1) M. Maxime Legrand
possède justement un fragment de colonnette ayant la même provenance
et qui aurait été propre à l’usage dont nous parlons.
La colonnette ornée était de style roman avancé.
|
D’un autre côté, j’ai expliqué quelles circonstances
rendent possible l’érection du jubé vers 1190 (2). M. C. Enlart a remarqué
qu’on ne [p.213] connaît aucun jubé
en France qui soit une œuvre de l’art roman; ailleurs, si l’on en trouve,
c’est parce que le pays qui les a produits s’est attardé dans ce style
(1). Toutefois M. Enlart ne déclare nullement
comme impossible l’existence de jubés au XIIe siècle.
On trouvera peut-être cette date prématurée.
Pourtant, le seul auteur qui ait fait une étude approfondie de la
question, Jean-Baptiste Thiers, pense avec force que la fermeture des chœurs
par des murailles a été mise en pratique depuis que les offices
divins se sont multipliés, c’est-à-dire depuis le XIIe siècle,
et dans le but de préserver les ecclésiastiques des injures
de l’air (3)
On n’a pas encore
cité un seul texte du temps pouvant fournir une indication précise.
Un embarras naît du fait qu’aucun terme spécial ne fut avant
longtemps trouvé pour désigner ce qui devint plus tard «jubé».
Au Moyen âge, on disait en latin «ambo» ou «pulpitum»
ou «lectrinum» et en français pupitre, lectrin,
lesteril, letrin, trin ou trincq (2). En
plein dix-septième siècle, Thiers déclare que les jubés
sont appelés ordinairement tribunes et Pupitres (3), quelquefois lectriers et doxales;
voulant parler des destructeurs de ces galeries, il n’a pas trouvé
d’autre expression que celle d’ambonoclastes, dont il est peut-être
d’ailleurs l’inventeur. Combien [p.214] la confusion
est difficile à éviter! C’est parce qu’il a voulu marquer
l’idée de séparation seulement, sans nécessité
d’allusion à la galerie, que l’évêque de Mende, Guillaume
Durant, dans son Rational des divins offices, a écrit
«un mur».
En résumé,
le jubé de l’église Notre-Dame d’Étampes, démoli
par les plus fidèles paroissiens eux-mêmes, en mai 1791, devait
être en pierre. Sa très grande simplicité, cause probable
de l’indifférence que les siècles paraissent lui avoir témoignée,
est aussi une preuve de son ancienneté. II y a présomption
sérieuse pour que 1ui ait appartenu l’étrange figure du XIIe
siècle, sculptée en pierre, dont un moulage existe au Musée
du Trocadéro, conjointement avec une pierre semblable ornée
d’un Aigle. J’espère qu’on voudra bien me pardonner la petite extension
donnée à mon étude au sujet de ces pierres, sans avoir
pu étayer ma thèse d’une preuve formelle, et me tenir compte
du résultat beaucoup plus certain de l’identification de la première
figure qui en tout cas représente évidemment l’Homme ailé
apocalyptique, attribut-symbole de l’évangéliste saint Mathieu.
L.- Eug. Lefèvre.
|
(2)
Ouvr. cité, p. 17: voir aussi Le Miracle de
la Visitation de Notre-Dame et l’Aumônerie de Notre-Dame d’Étampes,
dans le Bulletin de la Soc. archéologique de Corbeil et d’Étampes
(I913).
(3) Dissertations
ecclésiastiques sur les principaux autels, la clôture du chœur
et les jubés des églises (Paris, 1688, in-12, p. 19-22).
Voici une phrase qui précise les raisons de Thiers: «L’Office
de la Vierge…, celui des fondations d’Obits et de Messes votives, étans
fort fréquens et fort répandus, je ne doute pas que l’on n’ait
pris là occasion de fermer de murailles le Chœur des Églises,
et que cela n’ait été exécuté peu après
l’établissement de ces offices, qui ne s’est fait que vers la fin
du douzième siècle. Voilà à peu près l’époque
que l’on peut fixer à ces sortes de clôtures» (Ibid.,
p. 36). Les autres offices extraordinaires étaient ceux des fêtes
particulières et [p.213] des confréries.
Les messes votives et les obits furent réduits en 1192 l’office
de la Vierge a été ordonné à toute l’Église
par Urbain II dans le concile de Clermont, en 1193 (Ibid., p. 22-23
et 29). —
L’ouvrage de Thiers, dont le titre est souvent mentionné, n’est jamais
cité avec précision; c’est un livre rare, en somme fort peu
connu. Aux renseignements ci-dessus je crois donc devoir encore ajouter cet
autre: dans ma précédente étude (p. 35, note), j’ai fourni
le sens d’une phrase de Guillaume Durant dont voici le texte original: «Hoc
tempore quasi communiter suspenditur sive interponitur velum, aut murus
inter clerum et populum». Thiers en tire cette conclusion: «Ce
qui marque un usage déjà établi dans la plupart des
Églises et convient asses bien à notre époque.»
(Ibid., p. 36)
(1) Manuel d’archéologie
française (t. I, p. 755).
(2) Ibid., p.
754.
(3) N’est-ce pas du
jubé et du tref mal appelé chevron dans cet
article du compte de fabrique de Notre-Dame d’Étampes, en 1514: «A
luy (Jehan Girardin, serrurier) pour avoir fait troys chevilles de fer à
tenir le chevron de dessus le pepitre du cueur auquel fut mis et apposé
partie du luminaire de feu Anne, en son vivant, royne de France, que Dieu
absolve, le corps d’icelle reposant en la dite église, seize deniers»
(Max. Legrand, Annales de la Soc. archéolog. du Gâtinais,
1907, p. 100-101).
|
|
ANNEXES
ANNEXE 1
Ce que Lefèvre écrivait du même jubé en 1913
Annales du Gâtinais
31 (1913), pp. 13-20
II est
évident que, à un moment donné, pendant l’époque
romane, la barrière du chœur se trouva là où elle est
aujourd’hui, au milieu du double transept la preuve nous en est fournie
par la présence [p.14] de
deux colonnettes adossées, surmontées de deux chapiteaux romans
et qui, sans le moindre doute, furent destinées à supporter
la poutre de gloire.
Mais cet état de chose ne dura pas, et on
est en droit de penser qu’il cessa vers 1190, quand les chanoines transportèrent
hors de l’église un gênant grabatoire qui occupait le croisillon
sud (1). C’est après cette date ou un
peu plus tard, qu’on accentua l’agrandissement du choeur en le clôturant
plus complètement par l’érection du jubé.
D’ailleurs, au moyen âge, le grand-chœur, c’est-à-dire
le chœur proprement dit et ses dépendances, dans les cathédrales
ou collégiales, comprenait généralement et peut-être
toujours le transept et les bas-côtés plus ou moins développés.
Il en fut probablement ainsi dans notre collégiale d’Etampes.
|
(1)
Ce petit hôpital, qu’on appelait l’Aumônerie Notre-Dame, exista
à l’exemple de ceux qui furent installés dans nombre de cathédrales
comme celles de Paris et de Chartres. Voir notre étude, Le miracle
de la Visitation Notre-Dame, à propos d’un groupe sculpté
de l’église Notre-Dame d’Etampes, dans le Bulletin de la Société
archéologique de Corteil et d’Etampes, 1913.
|
Pour
nous convaincre, il y a, outre l’usage, ce fait que des peintures décoratives
figurant un semis de fleurs de lis et des colliers existent encore sur la
face occidentale intérieure des premiers piliers du choeur actuel,
à l’angle de la croisée du transept ces peintures étaient
sans doute primitivement dans le chœur, dans la partie où se dressaient
les chaires réservées à la famille royale; nulles peintures
n’existent sur les deux piliers qui font face et qui sont actuellement les
derniers de la nef parce qu’ils étaient cachés, du côté
du chœur tout au moins, par [p.15] les boiseries
du jubé et les dossiers des hautes stalles.
Le jubé, dont nous connaissons l’existence
seulement par un renseignement fortuit de Basile Fleureau, devait donc être
placé entre les deux dernières colonnes de la nef actuelle,
en avant du transept. Tout ce que nous savons de positif sur son compte, à
cause d’un usage général et d’une mention au XVIe siècle
susceptible de s’appliquer à lui seulement, c’est qu’il était
surmonté d’un Christ en croix entre la Vierge et saint Jean (1), et qu’il possédait une galerie supérieure
de circulation accessible par un ou deux escaliers en vis ou simplement
droits comme à Angers (2).
|
(1)
Il est question de ce calvaire dans le Compte de recettes et dépenses
de la fabrique de l’église Notre-Dame d’Étampes pour les années
1513-1515, publie par M Maxime Legrand (Annales de la Société
archéologique du Gâtinais, 1907, p. 108). L.-Eug. Lefèvre,
Rapport cité, p. 81.
(2) Sur le plan ci-joint
que M. Albert Mayeux a aimablement dessiné pour nous, nous avons place
à droite un escalier à vis, comme au jubé de Villemaur
(Aube), daté de 1521.
|
Considérant que le jubé n’a laissé aucune trace
sur les piliers, on le présume volontiers avoir été en
bois. Cependant, outre que l’un des deux piliers visés a été
refait au milieu du XIXe siècle et se trouve devenu un mauvais témoin,
il existait naguère dans un coin de l’église des débris
de pierres sculptées pouvant provenir de la barrière du chœur.
Il y avait notamment un aigle, motif habituel des décorations d’ambons,
et un sommier d’arc ayant pu servir à la porte centrale. Ce dernier
vestige doit remonter à la fin du xne siècle, d’ailleurs sans
parfaite certitude, et l’aigle, au caractère roman, pourrait être
du même [p.16]
temps ou plus ancien. Tout ccla est évidemment très vague,
et surtout très hypothétique; nous ignorons même quand
le jubé de pierre ou de bois fut démoli.
PLAN DE l’église Notre-Dame
d’Étampes
Essai de restitution de l’arrangement du chœur
au moyen âge.
La galerie servait
certainement au lecteur et à des chantres dans des fonctions courantes
(1): elle fut aussi [p.17]
utilisée à partir
du XVe siècle pour une cérémonie annuelle très
particulière, un salut par personnages, fondé par maitre
Jean Huë, doyen de la Faculté de théologie en Sorbonne,
et natif d’Etampes.
|
(1)
A mon avis, plusieurs motifs poussèrent les chapitres à l’érection
de jubés: le désir de rendre le sacrifice de la messe plus
mystérieux pour les fidèles, celui de séparer plus complètement
le chœur de la nef ou le peuple [p.17] se réunissait
trcs librement et non saus quelques inconvénients, le besoin de préserver
les chanoines contre le froid et les courants d’air pendant l’hiver. De plus,
le vrai jubé a galerie, celui qui n’est pas seulement une haute barriere
close, est une galerie qui relie les anciens ambons un peu surelevés.
L’Épitre et l’Evangile se chantaient au jubé d’ou ils pouvaient
être mieux entendus par le peuple. Entre les deux, on chantait des
versets, des psaumes ou d’autres prieres tirées de l’Ecriture Sainte.
Ce chant se nomme graduel parce que, a Rome, l’exécutant se
plaçait sur les degrés de l’ambon, in gradu ambonis:
et en d’autres églises, par exemple à Reims, sur les marches
du sanctuaire, in gradibus presbytrii (Instructions générales
en forme de catéchisme... imprimées par ordre de mess. Ch.-J.
Colbert, évêque de Montpellier, Paris, 1710, pp. 588-589).
Le jubé se trouvait indiqué pour d’autres petites cérémonies
comme celles dont nous allons parler.
|
Voici comment Fleureau décrit cette curieuse cérémonie
créée en 1477: «Le grand salut par
personnages se chante dans cette Eglise le jour de la feste de l’Annonciation
de Notre-Dame, auquel
on habille deux enfants de choeur, l’un en fille, qui représente
la Sainte-Vierge, et l’autre qui représente l’Ange Gabriel, qui luy
annonce le Mystère de l’Incarnation. Tous les Ecclésiastiques
vont processionnellement au-dessous des Orgues, où ils chantent divers
Motets convenables à la solennité cependant les deux enfants
habillez, comme nous avons dit, montent au Jubé. Celuy des deux qui
représente l’Ange se place au bout du même Jubé, du
côté de l’Évangile, et celuy qui représente la
Vierge se met à l’autre bout du côté de l’Épitre
et après que les Prestres ont cessé, ils chantent à
leur tour en forme de Dialogue l’Évangile qu’on lit à la Messe
de ce jour; ensuite tous passans par dedans [p.18]
dans le Chœur disent le De profundis pour le repos de l’âme
du Fondateur, et jettent de l’eau bénite sur sa tombe sous laquelle
son corps repose devant le grand Autel (1)».
Les dimensions de la nef du chœur actuel sont de
30 mètres de longueur pour 14 mètres de largeur; avec une
travée de plus, l’ancien chœur présumé devait avoir
environ 40 mètres de longueur, moins le petit espace accaparé
par l’épaisseur du jubé.
Le chœur s’étendait ainsi sur quatre grandes
travées dont les trois premières, marquées par de gros
piliers, étaient ouvertes sur le double transept et sur les bas-côtés.
La dernière travée était, comme aujourd’hui, fermée
par deux murs épais qui, au XIe siècle, étaient extérieurs
et percés de grandes fenêtres devenues sans raison d’être
et ultérieurement bouchées. Le chevet est carré et percé
à l’étage inférieur de trois fenêtres romanes
très primitives, et à l’étage supérieur également
de trois fenêtres [p.19] contemporaines
des voûtes, dont les arcs sont légèrement brisés.
|
(1)
Fleureau, ouv. cité, p. 189. – L’Annonciation fut un mystère
particulierement populaire au Moyen âge il avait le don de charmer
les imaginations. On accrut encore son succes quand on lia le souvenir de
la salutation angélique a l’institution du couvre-feu. L’usage de
celui-ci fut introduit par Guillaume II d’Angleterre pour obvier aux vols
nocturnes. Le concile tenu à Lisieux en 1055 marque peut-être
son établissement définitif en Franc:e il ordonnait de sonner
une cloche tous les soirs pour inciter à prier Dieu et avertir de fermer
sa porte, ce qui se faisait vers les sept heures. Le pape Jean XXII (1316-1334)
eut l’idée d’un reglement établissant que la prière de
la salutation angelique serait repétée trois fois à la
sonnerie de la cloche, et assurant en même temps une indulgence pour
ceux qui seraient fidèles à la coutume. Le concile de Paris,
en 1346, prescrivit l’observation inviolable du règlement papal, ajoutant
en faveur de tous ceux qui diraient alors, outre la prière de la Salutation,
l’oraison dominicale pour l’église, la paix, le roi, la reine et la
famille royale, une indulgence particulière attachée à
chaque jour, dans toute l’étendue de la province de Sens (R. P. Richard,
Analyse des Conciles généraux et particuliers,
Paris, 1777, t. II, pp. 41 et 273).
|
Il ressort des textes que le chœur proprement dit contenait au moyen
âge au moins deux autels (1), d’abord
le maître autel désigné parfois «grand autel
du chœur», «autel principal du chœur», et même «autel des saints
Martyrs», et le second probablement consacré à saint
Étienne, mais parfois simplement désigné «l’autel
du cueur» (2). Il est possible que,
durant les XVIIe et XVIIIe siècles, un ou deux autres autels aient
été ajoutés aux premiers (3).
Le maitre-autel, selon l’usage,
était en avant, en face de la porte du jubé. Je suppose qu’il
était placé au commencement ou au milieu de la seconde travée,
[p.20] c’est-à-dire
près de la ligne tracée par la grille actuelle.
|
(1)
Il n’y a pas d’erreur possible à cet égard, car les deux autels
sont cités eu même temps, et d’ailleurs la chose était
habituelle: «Pour l’achat de quarante-trois aulnes de roulleaux
pour faire des custodes entous (entour) l’autel du cueur avecques ung tapis
pour couvrir le maistre autel» (Compte de fabrique, manuscrit
cité, p. 107).
(2) L’autel saint Étienne,
«au cueur de ladite esglise» (Ibid., p. 106. Voir aussi
la note ci-dessus).
(3) Cependant les deux
premiers autels peuvent avoir ete déplacés et prêter
ainsi à des erreurs. Il faut egalement se méfier des appellations
trompeuses. Nous savons par le pouillé du diocèse de Sens rédigé
par Amette, secrétaire de l’archevêché, dont la copie,
commencee en 1695, fut
terminée en 1732, que, au XVIIe siècle, on employait couramment
le terme chapelle du chœur pour désigner une chapellenie à
la collation du Chapitre. C’est ainsi que le pouillé mentionne «dix-sept
chapelles du chœur» et ajoute «et en outre les dix-sept chapelles
cy dessus il y en a encore
quatre qu’on nomme royales étant à la collation du roy,
mais ne sont pas du chœur» (Ernest Menault, Essais historiques sur
les villages de Beauce, Morigny, Paris, 1867). Justement les deux autels
auxquels ces quatre dernières chapellenies étaient affecés,
étaient situés dans une dépendance du chœur, le bas-côté
nord un autre auteur aurait donc pu fort bien dire qu’elles étaient
«du chœur». Un pouillé rédigé vers 1350
et publié par Longnon (Pouillés de la province de Sens,
Paris. 1904, p. 45) fournit quelques détails de plus. Toutefois
M. Longnon doit avoir commis une erreur en appliquant aux quatre chapellenies
en question la phrase: «ad collationem capituli predicte ecclesie».
|
ANNEXE 2
Acte de décès du portefaix Claude Vezard survenue pendant
la démolition
Registre paroissial de Notre-Dame d’Étampes
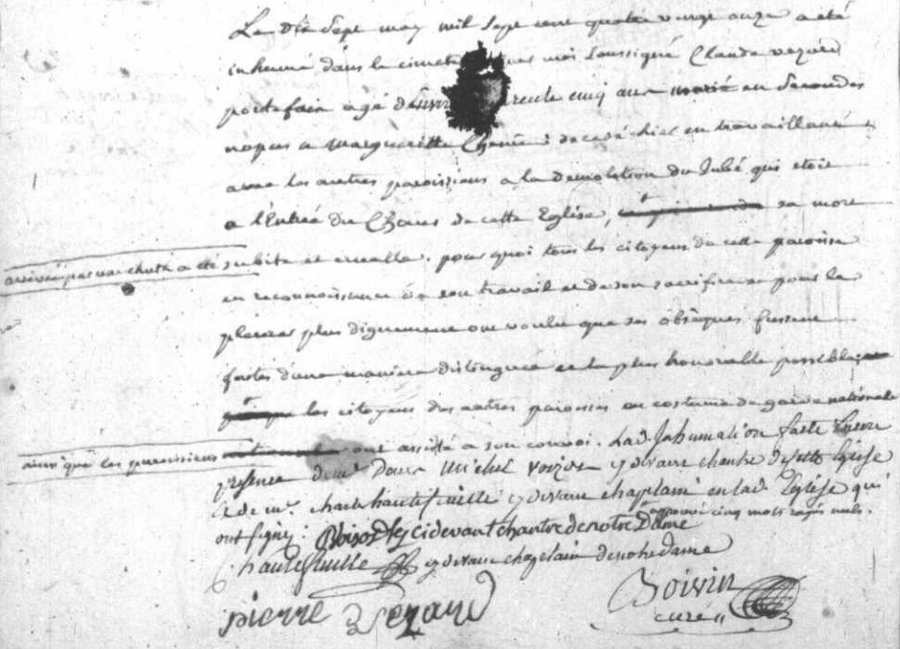
ANNEXE 3
Le parallèle du Jubé
de l’église de Brou (XVIe siècle)
Quatre clichés
Nous
donnons ici une série de quatre photographies du jubé heureusement
conservé de l’église de Brou, en Eure-et-Loir, tirés
de diverses cartes postales anciennes. Bien qu’il date du XVIe siècle,
tandis que celui d’Étampes remontait probablement au moyen âge,
ce jubé donne une idée du volume que pouvait occuper celui d’Étampes.
|
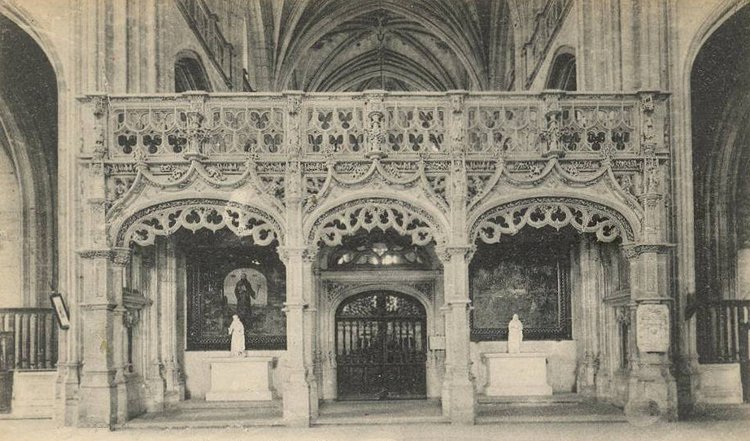 1. Le jubé de l’église de Brou, vu
depuis la nef
1. Le jubé de l’église de Brou, vu
depuis la nef
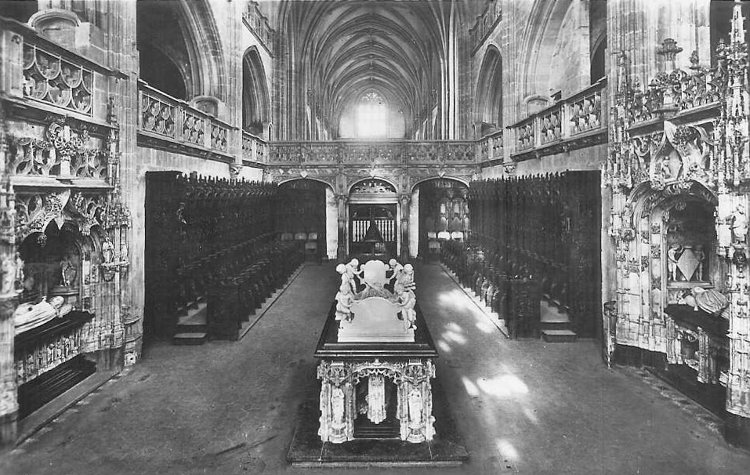
2. Le jubé de l’église de Brou, vu depuis le chœur
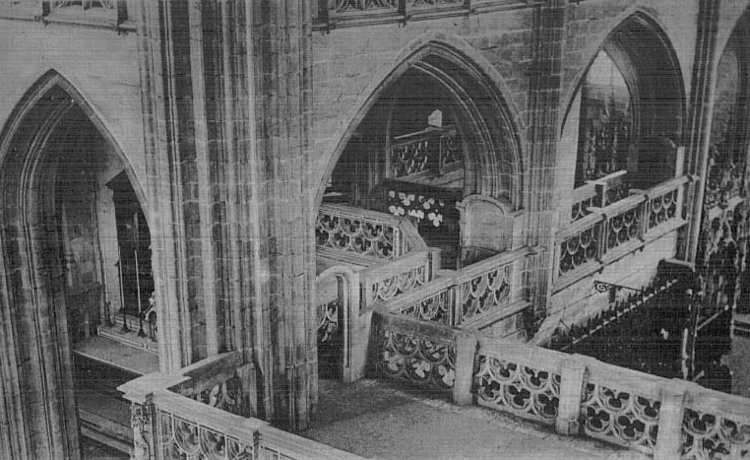
3. Galerie du jubé de l’église de Brou

4. Stalles et jubé de l’église de Brou vus du chœur
|